
Accusée d’avoir collaboré avec le régime nazi, l’entreprise de Louis Renault devient propriété de l’Etat en 1945….
Lire la suite sur le site de Libération


Accusée d’avoir collaboré avec le régime nazi, l’entreprise de Louis Renault devient propriété de l’Etat en 1945….
Lire la suite sur le site de Libération
Pour toute référence à ce texte, merci de préciser : Laurent Dingli, avec Jacky Ehrhardt pour la traduction des sources allemandes, “Schneider : de l’exode à la collaboration (été 1940)”, louisrenault.com, 28 novembre 2020. Dernière mise à jour 7 septembre 2021.
 Schneider était non seulement l’un des plus imposants groupes industriels français, mais également l’un des plus anciens et des plus prestigieux. Entreprise de réputation mondiale bénéficiant d’une concentration verticale et horizontale assez développée, la société et ses filiales disposaient également d’un savoir-faire et d’une expérience éprouvés dans la fabrication de très nombreux types de matériels militaires, de l’obus au sous-marin en passant par les engins blindés. Même s’il n’était pas un ancien combattant de la Grande Guerre, aucun officier supérieur allemand ne pouvait ignorer que l’entreprise avait conçu et livré l’un des premiers chars d’assaut en 1915-1916, à peu près au même moment que le Mark I britannique, et quelques mois avant le Renault FT-17 ; tous savaient qu’elle avait joué un rôle de premier plan dans l’équipement de la Marine et des chemins de fer français. Avec ses filiales, Schneider était capable de construire des centrales hydrauliques et thermiques complètes mais aussi différents types de moyens de transport (locomotives, navires, engins de traction et de halage) sans oublier les ouvrages d’art édifiés par sa division de Travaux public (DTP). La société, qui possédait des mines de fer et de charbon, jouissait d’une autonomie relative pour ses approvisionnements en matières premières – un atout non négligeable en temps de guerre, d’autant plus que la pénurie de charbon allait très rapidement constituer un handicap majeur pour l’Allemagne dans sa gestion de l’Europe occupée[1]. Enfin, les ingénieurs allemands connaissaient le procédé industriel et, pour l’essentiel, la nature des productions des sociétés du groupe dont ils allaient prendre le contrôle.
Schneider était non seulement l’un des plus imposants groupes industriels français, mais également l’un des plus anciens et des plus prestigieux. Entreprise de réputation mondiale bénéficiant d’une concentration verticale et horizontale assez développée, la société et ses filiales disposaient également d’un savoir-faire et d’une expérience éprouvés dans la fabrication de très nombreux types de matériels militaires, de l’obus au sous-marin en passant par les engins blindés. Même s’il n’était pas un ancien combattant de la Grande Guerre, aucun officier supérieur allemand ne pouvait ignorer que l’entreprise avait conçu et livré l’un des premiers chars d’assaut en 1915-1916, à peu près au même moment que le Mark I britannique, et quelques mois avant le Renault FT-17 ; tous savaient qu’elle avait joué un rôle de premier plan dans l’équipement de la Marine et des chemins de fer français. Avec ses filiales, Schneider était capable de construire des centrales hydrauliques et thermiques complètes mais aussi différents types de moyens de transport (locomotives, navires, engins de traction et de halage) sans oublier les ouvrages d’art édifiés par sa division de Travaux public (DTP). La société, qui possédait des mines de fer et de charbon, jouissait d’une autonomie relative pour ses approvisionnements en matières premières – un atout non négligeable en temps de guerre, d’autant plus que la pénurie de charbon allait très rapidement constituer un handicap majeur pour l’Allemagne dans sa gestion de l’Europe occupée[1]. Enfin, les ingénieurs allemands connaissaient le procédé industriel et, pour l’essentiel, la nature des productions des sociétés du groupe dont ils allaient prendre le contrôle.
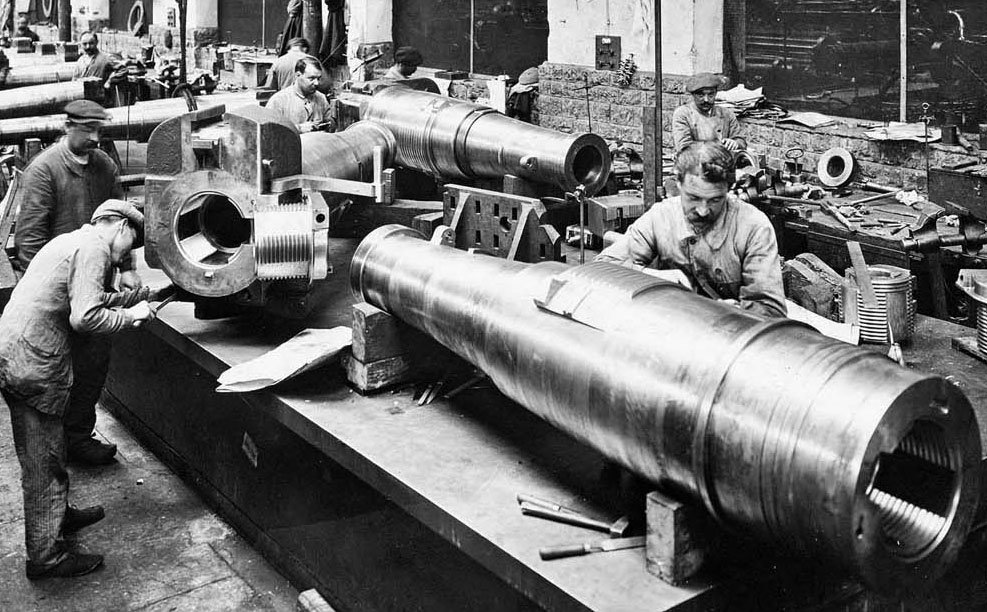
Établissements Schneider, usine du Creusot, 1916 – Montage des mortiers de 220 © Ministère de la Culture – Médiathèque Architecture et patrimoine, diffusion RMN
Tout contribuait donc à faire de Schneider l’une des cibles privilégiées du pouvoir nazi, dès l’invasion de la France et le début de l’occupation allemande. Dans l’exposé des motifs de son ordonnance de non-lieu du 16 juin 1949, le commissaire du gouvernement sut parfaitement résumer cette particularité : « En envahissant le pays, les Allemands devaient trouver divers établissements constitués par Schneider, un ensemble industriel de la plus haute importance dont l’activité, déjà orientée vers les fabrications de guerre, ne pouvait qu’attirer leur convoitise. Dans le but de faire passer les plus importantes des usines sous leur contrôle matériel, ils exigèrent que la ligne de démarcation des deux zones soit tracée de façon à englober Le Creusot dans celle de l’occupation. Ce fait indique déjà quelles allaient être les exigences de l’ennemi[2]. »
Schneider était un groupe gigantesque aux multiples ramifications. Même sur une très courte période comme l’été 1940, il est impossible d’en retracer l’histoire de manière exhaustive. Nous nous bornerons donc à évoquer la société mère, Schneider et Cie, ainsi que trois de ses principales filiales ou société parentes : la Société d’outillage, de mécanique et d’usinage d’artillerie (SOMUA), la Société d’optique et de mécanique de haute précision (SOM) et enfin la Société Le Matériel électrique SW (SW).

Le Matériel électrique SW – Négatif sur verre © Bibliothèque municipale de Lyon – Coll. Jules Sylvestre
Quelles furent les modalités de la reprise de cet ensemble industriel, la pression exercée par les autorités d’occupation, les attentes précises de ces dernières, la nature des premières commandes passées par l’occupant, l’attitude des dirigeants de Schneider à cet égard, mais aussi celle du gouvernement français, replié à Bordeaux puis installé à Vichy ? Enfin, quelle conclusion peut-on tirer de cette première phase de l’Occupation qui débute avec la débâcle de juin 1940 et s’achève au cours des premières semaines de septembre ?
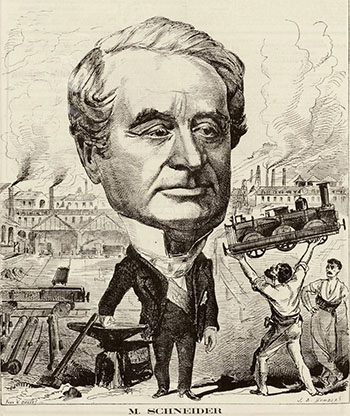 Pour tenter de répondre à ces questions, nous disposons de sources abondantes contenues dans trois fonds principaux. Parmi les plus importants figurent ceux des Archives nationales, plus précisément les dossiers d’instruction de la cour de justice de l’ancien département de la Seine. En effet, les quatre sociétés étudiées dans cet article furent poursuivies à la Libération pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État, comme la quasi-totalité des grandes entreprises métallurgiques françaises. Le chercheur dispose en outre du fonds imposant des archives de l’entreprise, dont la majeure partie a été réunie au Creusot par l’Académie François Bourdon. Enfin, les archives militaires allemandes complètent les fonds précédents et fournissent des indications que nous n’avons trouvées nulle part ailleurs[3].
Pour tenter de répondre à ces questions, nous disposons de sources abondantes contenues dans trois fonds principaux. Parmi les plus importants figurent ceux des Archives nationales, plus précisément les dossiers d’instruction de la cour de justice de l’ancien département de la Seine. En effet, les quatre sociétés étudiées dans cet article furent poursuivies à la Libération pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État, comme la quasi-totalité des grandes entreprises métallurgiques françaises. Le chercheur dispose en outre du fonds imposant des archives de l’entreprise, dont la majeure partie a été réunie au Creusot par l’Académie François Bourdon. Enfin, les archives militaires allemandes complètent les fonds précédents et fournissent des indications que nous n’avons trouvées nulle part ailleurs[3].
La bibliographie se révèle d’un bien moindre secours. Les périodes ultérieures ont été étudiées à travers certains thèmes précis tels que les Travaux publics, les réquisitions de main-d’œuvre, le bombardement de 1942 ou la résistance d’Henri Stroh, directeur du Creusot[4]. Mais la phase initiale de l’Occupation demeure très mal connue[5].
Pour comprendre les enjeux de cette période, il nous a paru indispensable de sortir du cadre chronologique strict que nous nous étions fixé – c’est-à-dire l’été 1940 – afin de résumer les 104 premières années de l’histoire du groupe Schneider (1836-1940), puis de présenter, de manière sommaire, ses dirigeants, ses installations et son organisation.
L’origine d’établissements industriels au Creusot remonte au XVIème siècle, époque où commença l’exploration des gisements aux affleurements houillers, mais l’aventure débuta réellement en 1781, lorsque François-Ignace Wendel, seigneur d’Hayange, et William Wilkinson, qui cherchaient alors un site de production pour alimenter les forges royales d’Indret, arrêtèrent leur choix sur Montcenis[6]. Wilkinson y trouva un charbon donnant un coke d’excellente qualité et du fer à proximité, espérant pouvoir produire de la fonte « à la manière anglaise » pour le service de la Marine. En 1782 fut ainsi créée, sous le patronage de Louis XVI et sur les plans de l’ingénieur et architecte Pierre Toufaire, la « Fonderie royale de Montcenis » ; quatre hauts-fourneaux y furent élevés, de nouveaux puits à houille creusés et la première coulée eut lieu le 11 décembre 1785.
Deux ans plus tard, « La Manufacture de Cristaux et émaux de la Reine » du domaine royal de Saint-Cloud, à Sèvres, fut transférée au Creusot (l’actuel bâtiment du Château de la Verrerie) où elle fonctionna jusqu’en 1832[7]. Réquisitionnée par le Comité de salut public, la fonderie produisit des canons de fonte de qualité médiocre et surtout des projectiles pour les armées révolutionnaires et impériales. Mais la paix de 1815 interrompit son activité. En 1836, les usines furent achetées par une société en commandite par actions au capital de 4 millions créée sous la raison sociale « Schneider frères et Cie » et dont les gérants étaient Eugène et Adolphe Schneider[8].
Les frères Schneider arrivèrent au Creusot au moment où l’application de la vapeur aux chemins de fer et à la navigation allait donner une formidable impulsion à l’industrie métallurgique. Dès 1839, ils créèrent les Chantiers de Chalon à Chalon-sur-Saône pour développer les constructions navales, profitant de la situation du site au point de vue des communications terrestres, ferroviaires et fluviales[9]. Deux ans plus tard, un ingénieur du Creusot, François Bourdon, inventait le marteau-pilon à vapeur qui allait permettre la fabrication de grosses pièces de forge en fer puis en acier[10]. La société, qui fournissait revêtements de ponts métalliques et machines à vapeur pour bateau, devint l’un des premiers constructeurs de locomotives en France, tout en investissant progressivement les marchés européen et mondial[11].
Dès lors, les installations et le potentiel industriel de l’entreprise ne cessèrent de se 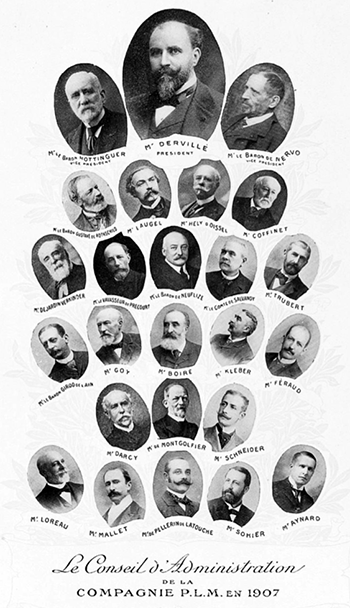 développer : achat des concessions houillères de Decize et Montchanin (1869), conversion de la fabrication à la production d’acier, suivant les procédés Bessemer et Martin (1867-1873)[12], installation d’un marteau-pilon de 100 tonnes (1875) et d’un premier convertisseur Thomas permettant la déphosphoration de la fonte, elle-même obtenue dans un haut fourneau à partir de minerai phosphoreux. Le dernier quart du siècle fut marqué par la fin des commandes de rails et la réorientation progressive vers les fabrications d’armement, notamment grâce à la production du célèbre canon de 75 : création d’ateliers d’artillerie au Creusot (1880 et 1885), achat d’ateliers au Havre appartenant à la Société des Forges et chantiers de la Méditerranée, du polygone du Hoc et de son champ de tir (1897), puis création d’un atelier à Harfleur (1905). Parallèlement, l’entreprise, qui équipait les navires des marines françaises et étrangères en plaques de blindage, participa à la création des Chantiers et ateliers de la Gironde (1882). La branche Travaux public fut organisée au sein d’un service dédié (1895) puis d’une direction (1906)[13]. Le tournant du siècle fut aussi celui de l’application à la métallurgie et à la mécanique d’une invention relativement récente : l’électricité. Les premiers ateliers de constructions électriques datent de 1898 et l’usine de Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne, de 1903. A partir de 1908-1909, les installations de tests et de fabrication de matériel d’armement gagnèrent le Sud-Est avec la construction sur la presqu’île de Saint-Mandrier, en rade de Toulon, d’une batterie d’essai, la « batterie des Maures », qui était alors alimentée par les torpilles fabriquées dans l’usine d’Harfleur en Seine-Inférieure. Le dispositif fut complété en 1912 par l’édification d’une base de lancement de torpilles à La Londe-les-Maures dans le Var, à une quarantaine de kilomètres de distance.
développer : achat des concessions houillères de Decize et Montchanin (1869), conversion de la fabrication à la production d’acier, suivant les procédés Bessemer et Martin (1867-1873)[12], installation d’un marteau-pilon de 100 tonnes (1875) et d’un premier convertisseur Thomas permettant la déphosphoration de la fonte, elle-même obtenue dans un haut fourneau à partir de minerai phosphoreux. Le dernier quart du siècle fut marqué par la fin des commandes de rails et la réorientation progressive vers les fabrications d’armement, notamment grâce à la production du célèbre canon de 75 : création d’ateliers d’artillerie au Creusot (1880 et 1885), achat d’ateliers au Havre appartenant à la Société des Forges et chantiers de la Méditerranée, du polygone du Hoc et de son champ de tir (1897), puis création d’un atelier à Harfleur (1905). Parallèlement, l’entreprise, qui équipait les navires des marines françaises et étrangères en plaques de blindage, participa à la création des Chantiers et ateliers de la Gironde (1882). La branche Travaux public fut organisée au sein d’un service dédié (1895) puis d’une direction (1906)[13]. Le tournant du siècle fut aussi celui de l’application à la métallurgie et à la mécanique d’une invention relativement récente : l’électricité. Les premiers ateliers de constructions électriques datent de 1898 et l’usine de Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne, de 1903. A partir de 1908-1909, les installations de tests et de fabrication de matériel d’armement gagnèrent le Sud-Est avec la construction sur la presqu’île de Saint-Mandrier, en rade de Toulon, d’une batterie d’essai, la « batterie des Maures », qui était alors alimentée par les torpilles fabriquées dans l’usine d’Harfleur en Seine-Inférieure. Le dispositif fut complété en 1912 par l’édification d’une base de lancement de torpilles à La Londe-les-Maures dans le Var, à une quarantaine de kilomètres de distance.

Schneider et Cie, Chantiers de Chalon-sur-Saône : “Marine ottomane : quatre contre-torpilleurs d’escadre – lancement d’un contre-torpilleur”, In : Schneider et Cie, Chantiers de Chalon-sur-Saône, “Constructions navales”, [ca 1911] (planche 19) cote 3041 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
Ce succès était dû aux qualités des Schneider – mélange de prudence, de faculté d’adaptation et d’un sens remarquable de l’organisation –, mais aussi au talent des ingénieurs dont ils avaient su s’entourer et au travail des milliers d’ouvriers qui s’étaient succédé dans leurs usines. A cette époque, la vie au Creusot était dure comme d’ailleurs dans tous les grands centres industriels. Avant 1910, il n’y avait pas d’électricité dans les ateliers et la pollution atmosphérique régnait au milieu de la Plaine des Riaux, cuvette naturelle qui abritait une grande densité d’installations – puits de mine, cokeries, hauts fourneaux, aciéries, fonderie, chaudronnerie, ateliers de constructions… Il fallut attendre les années 1940 pour que cesse le fonctionnement des hauts-fourneaux et des fours à coke avec leurs rejets de poussières et de fumées toxiques[14].

Le Creusot : vue d’ensemble – Détail de la partie droite du tableau : la plaine des Riaux, Photogravure d’après le tableau exécuté par André Gambey pour l’Exposition universelle de Vienne en 1873 : intitulé “Vue pittoresque” dans le catalogue des objets exposés par Schneider et Cie – Paris, imp. Goupil et Cie, cote 2572-5 Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
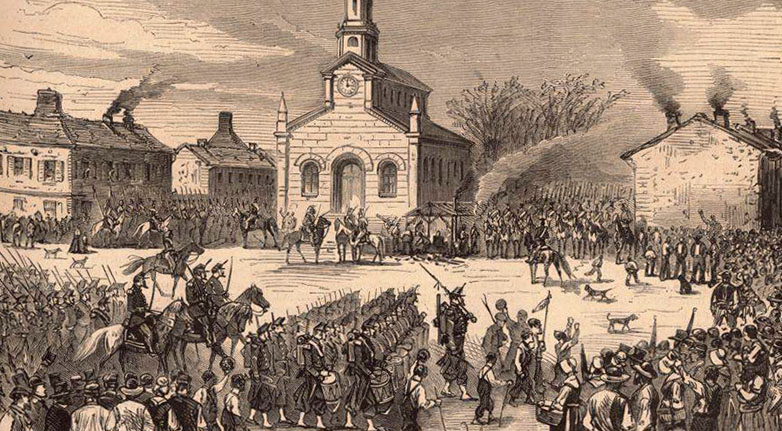
Une du Monde Illustré, 29 janvier 1870, montrant les troupes de Napoléon III envoyées au Creusot afin d’intimider les ouvriers en grève © Gallica-BNF

Le Creusot : Ecoles Schneider – groupe spécial, le 27 mars 1908″ : au premier rang, Henri-Paul (à gauche) et Jean (à droite) Schneider ; un prêtre ; debout derrière, vraisemblablement l’équipe dirigeante et enseignante des écoles, cote 3997-4 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
Sur le plan social, l’ouvrier évoluait dans un univers de dureté, de surveillance et de contrainte, « tempéré par un paternalisme intelligent et habile », nuance Marcel Massard. « Les Schneider ont été les auteurs de réalisations hardies et précoces, à une époque où de telles actions étaient pratiquement inconnues en France : caisses de secours en cas de maladie ou d’accident, hôpitaux, soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, caisses de retraite. Le tout, il est vrai, financé par des retenues substantielles sur les salaires des employés[15]. » Les écoles Schneider délivraient une solide formation technique et professionnelle, ainsi que des règles morales, à la fois simples et rigides. Entre 1885 et 1900, les enseignants de Schneider contribuèrent à faire admettre 76 élèves à l’École des Arts et métiers d’Aix[16]. En 1914, les écoles de l’entreprise instruisirent 1 250 élèves. Lors d’une conférence organisée par le Musée social en mai 1926, Frédéric Bidaut, architecte départemental de Saône-et-Loire, affirma que le taux de mortalité infantile était de 5,4 % au Creusot contre 12 % en moyenne au niveau national, grâce à l’ensemble des mesures sociales mises en place par l’entreprise[17].
Pendant le premier conflit mondial, Schneider joua un rôle industriel de premier plan, malgré des débuts hésitants[18]. Dès avant la guerre, la société prit des participations dans diverses entreprises comme la Société d’optique et mécanique de haute-précision (SOM), la Société d’outillage mécanique et usinage d’artillerie (SOMUA)[19], mais aussi dans plusieurs sociétés d’armement russes (1912-1914)[20]. C’est dans l’une d’elles, l’usine Poutilov de Petrograd, qu’éclata la grève de février 1917[21].
L’entreprise française créa aussi de nouvelles installations : usine à Bordeaux pour l’étirage des métaux et la fabrication des douilles, installation au Breuil d’une tôlerie-fonderie et aciérie Martin, nouveaux ateliers à Harfleur, cokerie à Montchanin… En 1916, Schneider poursuivit partiellement l’ambitieux projet qu’avait élaboré dès 1910 le magnat allemand de l’acier, Fritz Thyssen, en participant à la création de la Société normande de métallurgie[22]…
Quelques chiffres permettent de mesurer l’ampleur de la production de guerre. Pendant le conflit, les usines du Creusot et du Breuil produisirent l’équivalent de 5 713 600 obus explosifs de 75, 4 055 440 shrapnels du même calibre, 1 175 571 obus de 155 et 4 806 000 obus de 120. Il faut ajouter à cela le chiffre colossal de 7 000 pièces d’artillerie fabriquées et les 1 600 canons dont l’entreprise assura la réfection ou le retubage[23]. La production des 400 chars commandés pendant la guerre fut réalisée en partenariat avec la SOMUA qui fabriqua la majorité des blindages. Entre 1908 et 1920, Schneider réalisa 23 sous-marins (19 à Chalon, 2 à Bordeaux, 1 aux Chantiers de la Loire, 1 aux Chantiers de la Gironde)[24].

Établissements Schneider, usine du Creusot, 1916 – Presses et pilons © Ministère de la Culture – Médiathèque d’architecture et du patrimoine – diffusion RMN

Eugène II Schneider, portrait réalisé lors des grèves de 1899-1901, cote 1927-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
L’entreprise, dont le gérant était député à la Chambre et gouvernait l’ensemble de la vie locale[25], pouvait donner le sentiment de constituer une État dans l’État ou, pour reprendre le mot d’un militant socialiste, une sorte de « dictature féodale » moderne. Alimentant la légende noire du maître de forges, l’écrivain, poète et instituteur Georges Riguet, écrivit en 1933 à propos du Creusot, « bastion du capitalisme » :
« La ville, grise, encombrée d’ateliers, se tasse au pied d’un hémicycle de coteaux trapus. Des nuées sombres s’appesantissent sur elle. Tableau symbolique d’une cité opprimée, étouffée, quasi ensevelie. Dix mille ouvriers travaillent là, brimés, asservis par le plus cynique des patronats. Dieu ici n’est point une fonction. Il existe. Sa toute puissance éclate partout, se révèle aux yeux du plus incrédule ! Les usines sont à lui, les maisons sont à lui, les âmes sont à lui !… Ce garçonnet qui passe, coiffé d’une casquette pareille à un képi, vêtu du liturgique blouseron à carreaux bleus, c’est un soldat du Seigneur, un futur desservant du culte… La plaque de cuivre de son ceinturon porte le S., sceau du Tout-Puissant, avec les deux petits canons entrecroisés… Et il y a la moitié des enfants du Creusot qui sont harnachés du même hiératique ceinturon. Ce monument devant lequel vous vous attardez est à l’effigie du Seigneur… (…) Ce château, ce parc, ces bancs, ces écoles, ces cités ouvrières, ces terrains de jeux, ces champs, ces jardins, ces étangs, ces routes, tout cela est l’apanage, l’héritage, le fief, du Seigneur du Creusot, le signe temporel de sa magnificence et de sa richesse.
« Dieu ici se nomme Schneider, et malheur à qui l’ose défier ![26] »
Après la Grande guerre, Schneider se reconvertit en partie sa production vers des fabrications civiles et poursuivit ses prises de participations et acquisitions en France, avec la concession de mines de fer de Droitaumont dans le bassin de Briey en Meurthe-et-Moselle, la Société de l’énergie électrique Rhône et Jura, la société métallurgique de Knutange en Moselle désannexée, mais aussi à l’étranger avec les charbonnages de la Campine belge, les aciéries luxembourgeoises de Burbach-Eich Dudelange (ARBED) et la création de la Société métallurgique des Terres rouges (1919)[27]. Schneider profita de la défaite de l’Allemagne et de la chute de l’empire austro-hongrois pour essaimer en Europe orientale et centrale grâce à un outil privilégié : l’Union européenne industrielle et financière (UEIF) créée en 1920[28] avec la Banque de l’union parisienne (BUP) dont Eugène Schneider était administrateur[29]. L’UEIF écrit Claude Beaud, « s’est efforcée de tisser à travers l’Europe centrale un véritable réseau en toile d’araignée. » :

Société métallurgique de Knutange – Coulée du laitier dans les poches – Hauts-Fourneaux de l’usine du Haut © F. Mésière
« Les deux plus beaux fleurons sont les dépendances tchèques : les Ets Skoda et leurs nombreuses filiales, les Ets Réunis de Constructions mécaniques absorbés par Skoda en 1922, représentent avec Berg und Hütten un ensemble d’éléments complémentaires (mines, métallurgie et constructions mécaniques très diverses), comparable à celui de la Société Schneider en France (…)[30] »
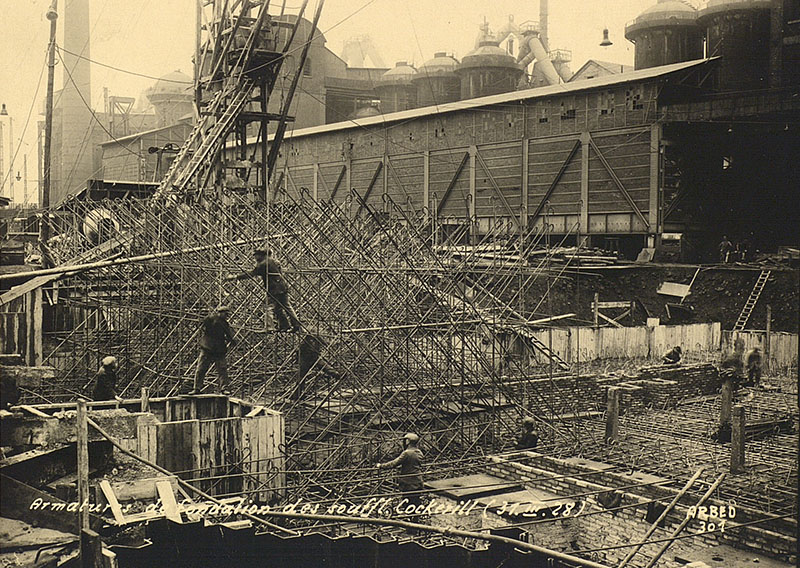
Armature de fondation des armatures de soufflantes Cockerill de l’usine de Dudelange © Archives Nationales de Luxembourg
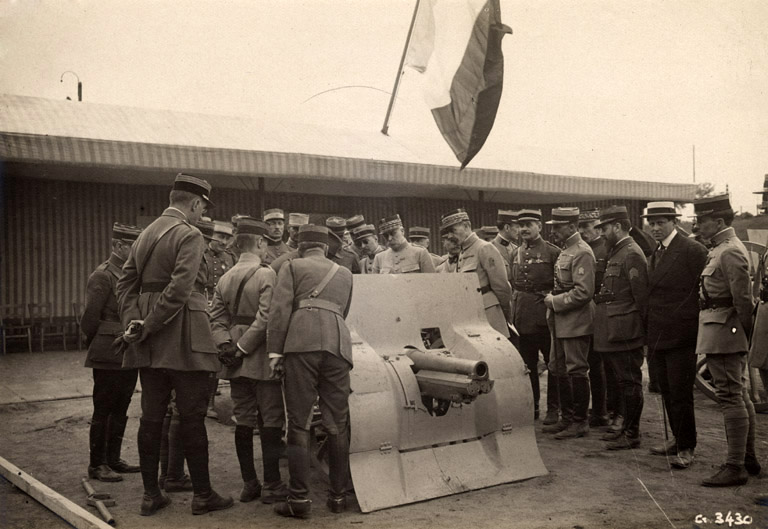
Le Creusot : Établissements Schneider et Cie, polygone de tir, 4 juin 1920 : “Visite de M. le Maréchal Pétain, de M. le général Debeney et de MM. les officiers du Centre des hautes études militaires : présentation du canon de 75 mm de montagne.” Cote 1838-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
Il n’est pas surprenant que le maître de forges devînt rapidement, pour une partie de la Gauche et des milieux ouvriers français, le symbole du marchand de canons, le profiteur et fauteur de guerre, l’éminent représentant des « deux cents familles », l’équivalent d’un Armstrong ou d’un Vickers avec lequel le maître de forges français fut d’ailleurs en affaire, autant de clichés forcément « réducteurs et manichéens » remarque Agnès d’Angio[31]. Après l’Armistice de 1918, alors que les mouvements pacifistes attiraient de nombreux contemporains traumatisés par la guerre, ce type d’images frappait l’opinion et rencontrait un certain écho[32]. Après sa défaite aux municipales face au candidat de Schneider, l’avocat Victor Bataille, le socialiste Paul Faure, élu de Saône-et-Loire (1924-1932) et maire du Creusot (1925-1929), lança à la Chambre de virulentes attaques contre l’industriel, accusant ce dernier de financer indirectement le parti nazi d’Adolf Hitler et le régime hongrois de l’amiral Horthy. Afin de prouver l’ancienneté de ces trahisons, l’élu socialiste brandit dans l’hémicycle de vieilles photographies d’avant-guerre où l’on voyait le maître de forges sur le yacht de l’empereur Guillaume II ou en compagnie du ministre de la Marine ottomane en juillet 1914[33]. Le communiste belge Auguste Habaru écrivit avec autant de pondération dans Le Peuple, le 15 juin 1936, que Schneider était « l’un des plus grands marchands de mort de l’univers », pire encore que Zaharoff et Krupp réunis[34]. La longévité de ce discours, quasiment stéréotypé, est frappante, et en 1947 encore, le communiste André Marty vint dénoncer au Creusot les liens du général de Gaulle, « commis salarié et parent de Schneider », avec la « famille-pieuvre »[35].

Eugène II Schneider lors d’un voyage aux Etats Unis (conférence d’Atlantic City) en 1919, cote 1844-3 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
La Saône-et-Loire fut touchée par les grandes grèves de l’été 1936 comme le reste du pays. Plus de cent trente mouvements éclatèrent dans le département en juin et juillet[36]. A Chalon-sur-Saône, le conflit de la métallurgie dura près de six semaines[37]. Le candidat de Schneider, Victor Bataille, l’avait cependant emporté aux Législatives. Mais, contrairement au pays de Montbéliard où François Peugeot fut élu, il n’y eut pas de sursaut du mouvement ouvrier dans les semaines suivant l’élection et la greffe ne prit pas dans les usines métallurgiques Schneider. Le 1er août 1936, le Courrier de Saône-et-Loire put se réjouir de « l’échec complet que l’état-major de CGT a subi au Creusot »[38].

– Montceau-les-Mines : Manifestation du 14 juin 1936 (8000 manifestants), carte postale photographique, cliché L. Hériot, cote 2750-1, collection particulière de La Physiophile © La Physiophile / reproduction Ecomusée Creusot Montceau

“Pas de flaques d’huile sur le sol de l’atelier” : Affiche de sécurité du travail éditée par l’Association des Industriels de France (affiche n° 138) – Dessin de 1935 – Parution : 1936, dessinateur : Olivier, cote 2795-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
Pas plus de succès pour la grève du 30 novembre 1938 organisée par la Fédération des Métaux-CGT contre les décrets lois Reynaud. Le Progrès de la Côte d’Or titra avec satisfaction : « 10 grévistes sur 10 000 au Creusot ». Chez Schneider, « on a seulement enregistré dix absences anormales, dont celle du secrétaire du syndicat des métallurgistes ». Quant à l’atelier nationalisé, sur plus de 600 personnes employées, « on n’a constaté aucune défection[39] ». Comme en 1936, le mouvement fut davantage suivi aux Chantiers de Chalon où il y eut 231 absents sur un effectif de 970 ouvriers. L’usine de Dijon de la SOM avait dû fermer ses portes, les ouvriers refusant de faire des heures supplémentaires : 50 d’entre eux, sur un effectif de 150, ne rentrèrent pas à l’usine le 30 novembre 1938[40].
Les nationalisations de 1937 concernèrent différentes installations de la société et firent l’objet de nombreux incidents entre les pouvoirs publics et l’industriel qui tenta en vain de faire annuler l’expropriation par le Conseil d’État. Les usines du Havre, d’Harfleur, de La Londe ainsi que la Chaudronnerie du Creusot furent transformées en arsenaux. Pour ne pas délaisser totalement les fabrications de guerre, et alors que se précisaient les menaces d’un nouveau conflit, Schneider conclut un accord avec les frères Simard de la Marine Industries Limited (MIL) canadienne, propriétaire des Chantiers et ateliers de Sorel dans la province du Québec, l’objectif étant de construire une usine d’armement. Celle-ci ne fut achevée qu’en septembre 1940 mais Schneider put contribuer à la fabrication de canons anglais de 85 et 100 mm anti-aériens. En octobre 1939, le gouvernement français constitua avec l’entreprise une société mixte, la SOFMA (Société pour la fabrication de matériel d’armement) qui reprenait à son compte les ateliers nationalisés du Creusot et s’installa dans les anciens ateliers de Bacalan de la Société des Forges et chantiers de la Gironde. Étant donné la longue expérience qu’avait Schneider, sa reconversion dans les fabrications de guerre s’effectua rapidement. En mai 1940, à l’instar de nombreuses entreprises métallurgiques françaises, elle atteignit un record de production mensuelle pour la défense nationale.

Entrée de la Wehrmacht à Grundhof (Luxembourg) en mai 1940 © Luxemburger Wort/Archives Nationales de Luxembourg
Entre l’invasion de la Bohême-Moravie, en mars 1939, et l’offensive victorieuse de la Wehrmacht à l’ouest en mai-juin 1940, le IIIème Reich s’empara de plusieurs sociétés liées à Schneider notamment la Skoda, en Tchécoslovaquie, dont elle utilisa aussitôt le potentiel pour son industrie de guerre, l’ARBED au Luxembourg ou encore la société des Forges et aciéries de Huta-Bankowa à Dobrowna-Gornicza en Pologne – entreprise française fondée en 1877 et contrôlée par le partenaire historique de Schneider, la Banque de l’union parisienne (BUP). Le groupe reprit d’ailleurs la plupart de ses participations après la défaite de l’Allemagne. En 1946, le portefeuille titres de Schneider comprenait des participations dans plus de trois cents quatre vingt sociétés de métallurgie, de mécanique, d’électricité, de transport, d’énergie, de Travaux public, mais aussi immobilières, bancaires, de presse et d’édition.
La société, dont le capital était de 100 millions de francs depuis le 11 février 1924, possédait ou exploitait à bail les usines suivantes :
Tableau 1 – Usines Schneider et leur effectif au 31 mai 1940 :
| Usines | Personnel ouvrier | Personnel employé |
| Usines du Creusot, du Breuil et Henri-Paul | 12 956 | 1828 |
| Chantiers de Chalon à Chalon-sur-Saône | 1364 | 140 |
| Usine de Bordeaux à Lormont (Gironde) | 627 | 24 |
| Houillères de Decize à La Machine (Nièvre) | 1 653 | 132 |
| Mines de Droitaumont par Jarny (Meurthe-et-Moselle) | 342 | 45 |
| Total | 16 599 | 2 124 |
Entre 1899 et 1942, à la tête de ce groupe monumental, se trouvait un seul homme, le gérant Charles, Prosper, Eugène Schneider[41], appelé communément Eugène Schneider suivant son prénom usuel ou Eugène II pour le différencier de son grand-père. Il avait eu trois fils dont l’un, Henri-Paul[42], pilote-observateur à la Spad 49, grièvement blessé lors d’un combat aérien qu’il mena aux côtés de son frère Jean contre les Allemands, mourut quelques heures plus tard, au cours de la nuit du 23 février 1918. Dans une lettre écrite à Madame Schneider, Edmond Rostand évoqua « cet affreux rayon de gloire »[43] à propos de la disparition d’Henri-Paul. Afin de lui rendre hommage, son nom fut donné à un bombardier de nuit, une rue de la cité ouvrière des Bormettes, un boulevard et une usine du Creusot.

Charles, Jean, Henri-Paul, les trois fils ; Antoinette, l’épouse d’Eugène II Schneider, Eugène II Schneider et May (Marie-Zélie) Schneider (Cours la Reine, avril 1917) © AD Saône-et-Loire/Wikipedia
Peu de temps après la guerre, ses deux frères, Jean et Charles, entrèrent en conflit avec leur père qui leur avait accordé la gérance mais sans la signature. Dessaisis par décision de l’assemblée générale du 29 novembre 1924 de leur cogérance, Jean[44] et Charles Schneider[45] furent finalement rétablis dans leur droit par arrêt de la cour d’appel de Paris le 16 novembre 1926[46]. Mais les deux hommes préférèrent s’écarter des affaires et ne revirent leur père qu’au lendemain du bombardement du 17 octobre 1942 sur le Creusot. Ils lui succédèrent après sa mort survenue quelques semaines plus tard, le 7 novembre. Jean Schneider, alors inspecteur général d’Air France, rejoignit aussitôt Alger et fut tué au cours de son retour en France métropolitaine le 14 novembre 1944 avec son épouse Françoise lors d’un accident d’avion. Dès lors, Charles Schneider restait le seul gérant de la société.
Lorsque le 5 juin 1946, le commissaire Perez y Jorba, chef de la section financière de la police judiciaire, et Paul Caujolle, expert-comptable mandaté par le juge, vinrent perquisitionner au siège de l’entreprise, 42, rue d’Anjou, André Vicaire, directeur-général de l’entreprise, leur expliqua brièvement l’organisation des services : « La Société Schneider & Cie est une société en commandite simple dont le gérant est M. Charles Schneider. Sous les ordres de la direction générale sont placés : un directeur, M. de Boissieu, plus spécialement chargé des questions financières, deux secrétaires généraux, M. Litzellmann et Nicolas, une direction des Travaux publics et une direction d’Exploitation[47]. » Cette dernière est elle-même subdivisée en quatre divisions : Mécanique spécialisée (DMS), Constructions navales, Mines et Métallurgie[48]. « Ces divisions ont sous leurs ordres toutes les mines et toutes les usines de la société ainsi que les services commerciaux s’y rattachant. »
La direction générale bicéphale était occupée par Armand de Rafélis, comte de Saint-Sauveur[49], beau-frère d’Eugène II Schneider, fils et petit-fils des 6ème et 5ème marquis de Saint-Sauveur, barons d’Empire et Grands d’Espagne. Saint-Sauveur s’était occupé entre autres des affaires de l’entreprise en Russie avant la Grande Guerre et demeurait officiellement le représentant du Creusot dans ce pays, même après la Révolution bolchevique.
Le second directeur-général était André Vicaire[50] ; ce polytechnicien, ingénieur des Mines, fut l’un des plus influents responsables du groupe, à la fois homme de dossiers, de décisions et de terrain. C’est à lui que s’adressèrent la plupart des dirigeants des filiales au début de l’Occupation allemande pour déterminer leur attitude face aux Allemands.
Maurice Nicolas[51] n’entra chez Schneider qu’en 1944, mais l’ingénieur Albert Litzellmann dirigeait le secrétariat général de la société depuis de nombreuses années au moment de la débâcle de juin 1940[52].
Albert de Boissieu, en charge des questions financières était également l’un des principaux dirigeants du groupe[53]. Croix de guerre 14-18, commandeur de la Légion d’honneur, polytechnicien, il entra à l’inspection des Finances en 1922. Sept ans plus tard, en 1929, à 33 ans, il fut directeur de la Compagnie générale transatlantique, puis intégra l’année suivante le groupe Schneider comme directeur-général adjoint de l’Union européenne industrielle et financière[54]. Directeur de Schneider en 1937, il fut mobilisé au mouvement général des Fonds pendant la drôle de guerre. A partir de 1940, Albert de Boissieu présida les deux outils financiers du groupe : la Banque des pays du Nord et l’Union européenne[55].
Victor Benezit[56], polytechnicien (1900), ingénieur des Ponts et chaussées (1902), professeur du cours de Travaux maritimes à l’École des Travaux publics, avait pris la succession de Charles Laroche à la direction des DTP de Schneider en 1924. Il était entré à la Société des forces motrices de Chancy-Pougny le 1er janvier 1921 après s’être mis en congé hors cadre. D’après Agnès D’Angio, il avait sans doute dirigé une partie des travaux du chantier franco-suisse et peut-être supervisé l’élaboration des plans. En 1922, il étudia avec Charles Laroche les plans de la jetée Mustapha du port d’Alger – ce qui allait constituer une référence d’ingénierie[57]. Au printemps de la même année, il reçut le président de la République, Alexandre Millerand, sur le chantier Schneider du port de Casablanca, initié dès 1904 avec la Compagnie marocaine mais qui avait été interrompu, en 1907, en raison d’une « insurrection indigène »[58]. Benezit était un gestionnaire qui jouissait de pouvoirs très étendus en raison de la puissance du bureau d’études de la DTP. En avril 1931, il fit partie, avec Jacques de Neuflize et Aimé Lepercq, des premiers administrateurs de la Compagnie franco-polonaise de chemin de fer, chargée de l’achèvement de la ligne Silésie-Baltique et de son exploitation par une concession d’État[59]. En 1937, il défendit le projet d’un tunnel routier sous le Mont-Blanc au sein d’un syndicat franco-italien où figuraient l’X-Ponts Albert Caquot, qui présida l’année suivante les sociétés nationales de constructions aéronautiques, le baron Charles Petiet, président de la Chambre syndicale des constructeurs d’automobile, Antoine Bron, ancien conseiller d’État du canton de Genève, et enfin l’ingénieur et sénateur Piero Puricelli, créateur des autoroutes italiennes[60].

Vue d’ensemble du port de Casablanca [Maroc], 1930, cote 3037-2 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
Le chef de la direction d’Exploitation, François Walckenaer[61], était le descendant d’un célèbre entomologiste, ennobli par Louis XVIII sous la Restauration. Il était le petit-fils du baron Charles-Guillaume Walckenaer, chef du cabinet du ministre de l’Intérieur du gouvernement Émile Ollivier sous le Second Empire, conseiller général de l’Aude, sous-préfet de Lisieux (1864-1870), et le fils de Charles Marie Walckenaer, major de l’école Polytechnique (1877), ingénieur, inspecteur général des Mines, commandeur de la Légion d’honneur[62]. François Walckenaer suivit les cours du collège Stanislas avec son frère aîné Charles[63] et devint ingénieur des Mines en 1908, puis sous-directeur de Schneider, directeur des usines du Creusot et enfin chef de la direction Exploitation. A l’instar des Schneider, d’Albert de Boissieu et de milliers de familles françaises, il perdit un frère au cours des combats de la Grande Guerre.
L’animateur de la Société Le Matériel électrique SW était Pierre de Cossé-Brissac[64], le gendre d’Eugène II Schneider dont il avait épousé la fille May en 1924. Ancien élève de l’École polytechnique (1918), il avait été lieutenant d’artillerie puis ingénieur chez Schneider de 1924 à 1939 et occupait alors le siège d’administrateur de plusieurs sociétés du groupe en France et à l’étranger dont la SOM depuis 1931. Il était administrateur-délégué et directeur-général de SW depuis mars 1939. Capitaine d’état-major de réserve au corps d’Armée de Metz, fait prisonnier le 21 juin 1940, il fut libéré dès la fin du mois d’août, d’après une source militaire allemande, en reconnaissance de la bonne volonté du groupe Schneider vis-à-vis des exigences du Reich[65] ;
Malgré des différences d’âge notables entre la génération des dirigeants nés dans les années 1875-1880 (Saint-Sauveur, Litzellmann, Vicaire, Benezit et de Beaumarchais), et les plus jeunes (de Boissieu, de Cossé-Brissac), il existait une réelle cohésion à la tête du groupe Schneider. Celle-ci régnait également parmi les cadres et une grande partie du personnel des usines, un atout en période de crise. A part Vicaire, Litzellmann, Benezit et les Schneider, les hauts dirigeants étaient issus de la noblesse, qu’elle soit récente ou d’antique extraction comme celle des Rafélis-Saint-Sauveur – maison d’ancienne chevalerie originaire d’Italie, ou celle des ducs de Brissac[66]. Ces hommes avaient surtout été formés dans les mêmes écoles : parfois ingénieurs des Mines, ils étaient presque tous polytechniciens (Vicaire, Walckenaer, de Boissieu, Benezit, de Beaumarchais et de Cossé-Brissac).
L’une des plus importantes entreprises contrôlées par le groupe était Le Matériel électrique SW (« S » pour Schneider, « W » pour Westinghouse »). Cette société anonyme au capital de 100 millions de francs fut créée le 26 juin 1929 par Schneider & Cie et les sociétés américaines Westinghouse Electric & Manufacturing Company de Pittsburgh et Westinghouse Electric International Company de New York. Schneider fit l’apport à SW d’une usine de 285 000 m2 de superficie (dont 40 000 couverts à la Libération) située à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne) que l’entreprise avait créée en 1903 ; de son côté, Westinghouse concéda le bénéfice d’exploitation de divers brevets qui concernaient la construction de matériel électrique[67]. Peu de temps après sa création, SW acheta l’usine de la Société des constructions électriques de Lyon et du Dauphiné, située 220, route d’Heyrieux à Lyon, installation d’une superficie de 55 000 m2 dont 17 400 couverts en 1945. Le siège social de SW était au 32, cours Albert 1er à Paris (8ème), dans l’immeuble où résidait Pierre de Cossé-Brissac, dirigeant de l’entreprise. Il se situait non loin de l’habitation des Schneider qui résidait au numéro 34 (ancien cours la Reine), dans l’hôtel construit sous le Second Empire pour le marquis de La Ferronays, qu’Eugène II avait acheté en 1901[68].
L’effectif de l’usine de Champagne oscilla entre 1 100 et 1 200 personnes pendant la drôle de guerre, et s’éleva même à 1 500 unités en mai 1940, avant de plafonner à 800 employés et ouvriers sous l’Occupation ; celle de Lyon dépassa rarement une moyenne de 500 personnes au cours de ces deux périodes, ce qui correspondait à un effectif « normal » d’après la direction. SW jouissait par ailleurs de la stabilité relative de son personnel d’encadrement. Un certain nombre d’ingénieurs et de collaborateurs, recrutés lors de la fondation en 1929, étaient toujours en fonction sous l’occupation allemande : ainsi Louis Rouvray, chef du service Gros matériel ; Charles Rossignol, chef de la section Matériel de traction électrique ; Charles Roidot, creusotin entré chez Schneider en 1913, chef de service puis directeur de l’usine de Lyon au début de l’Occupation[69]…

Le Matériel électrique SW – Deux négatifs sur verre © Bibliothèque municipale de Lyon – Coll. Jules Sylvestre
La société produisait à Lyon du petit matériel électrique courant, des gaines relais pour obus et usinait de pseudo-tourelles pour torpilleur. L’usine de Champagne-sur-Seine se chargeait du gros matériel de traction ferroviaire. Elle fabriquait également des installations complètes de stations centrales thermiques et hydroélectriques, et procédait à l’équipement électrique des navires, notamment des sous-marins. Sous la direction du groupe Schneider, l’usine de Champagne-sur-Seine avait fabriqué pendant la Grande Guerre des obus de 75 dont elle reprit partiellement la fabrication en 1939.
Depuis sa création, la SW était le principal fournisseur de moteurs pour les fabrications de la SOMUA, notamment pour équiper les machines-outils que produisait l’entreprise de Saint-Ouen. De leur côté, la SOMUA et Schneider se chargeaient de fabriquer la partie mécanique du matériel électrique de SW – partenariat qui se poursuivit sous l’occupation allemande[70].
Schneider possédait 4/5ème du capital social, et Westinghouse 1/5ème. Au sein du conseil d’administration figuraient cinq représentants du groupe : le directeur-général Pierre de Cossé-Brissac, les deux directeurs-généraux de Schneider, André Vicaire et Armand de Saint-Sauveur ; le polytechnicien et inspecteur des Finances Albert de Boissieu, président, représentant de l’Union européenne industrielle et financière (UEIF) ; Charles de Beaumarchais[71], administrateur de SW depuis sa création en 1929 et président du conseil d’administration à partir d’août 1940, également administrateur de nombreuses sociétés dont la SOM, la SOMUA, et les Forges et chantiers de la Gironde ; enfin Fernand Cordier[72], président de la Société des forces motrices dauphinoises et Henri Milon, P-DG de la SA L’Énergie électrique Rhône et Jura, administrateur de la Société Forces motrices de Chancy-Pougny et Président de l’Union technique des syndicats de l’Électricité.

Champagne-sur-Seine, Usine Schneider et Cie. Service SW : “Montage de 13 locomotives électriques – Chemins de Fer de Camargue – avril 1932”, cote 4021-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil
La Westinghouse Electric International Company de New York était représentée au conseil par son vice-président et administrateur, George H. Bucher, vice-président de la SW (jusqu’au 26 juillet 1945) ; et son président pour l’Europe, Paul Guercken, administrateur de la SW (démissionnaire le 28 mai 1941)[73].
Schneider détenait plusieurs sièges du conseil d’administration de la Société d’optique et de mécanique de haute précision, dont celui de président. « Cette entreprise (la SOM, ndr), dans laquelle le groupe Schneider possède une participation de 15 % du capital social et qui est en fait sous le contrôle industriel et financier de ce groupe, est spécialisée dans la fabrication de télémètres, gyroscopes, hélices de torpilles et goniomètres, tous appareils à destination purement militaire », constatait le commissaire du gouvernement dans son ordonnance de non-lieu[74].
Co-inculpé à la Libération avec Antoine Castellani, directeur-général de la SOM, Jean-Louis Bach[75] en était administrateur depuis 1921 mais aussi le conseil juridique du groupe Schneider. C’est lui qui dirigea vraiment l’affaire comme l’expliqua au juge d’instruction Marcel Martin un autre administrateur et co-inculpé, Pierre de Cossé-Brissac : « D’autre part, vous connaissez l’organisation du groupe Schneider. Dans chaque filiale, un haut fonctionnaire de Schneider y est administrateur ou directeur-général et chargé des fonctions de titulaire, c’est-à-dire de responsable de la politique générale de l’affaire[76].»
Pierre de Cossé-Brissac était, nous l’avons vu, administrateur de la SOM depuis 1931 ;
Jean Carron[77], l’était pour sa part depuis avril 1939. Membre du conseil d’une société appartenant au groupe Schneider[78], il entra à la SOM à la demande même du groupe[79].
Georges Fontaine[80], ingénieur, directeur des établissements Schneider depuis le 1er juillet 1931, fut administrateur de la SOM à partir de décembre 1940.
Schneider contrôlait un nombre conséquent de sociétés, même lorsque son taux de participation dans le capital social demeurait modeste. C’était le cas de la SOMUA qui avait été constituée le 14 mars 1914. Héritière de la Société anonyme des Usines Bouhey, créée vingt ans plus tôt, elle avait absorbé en 1913 la Société française de machines-outils, située 146 avenue Victor-Hugo à Saint-Ouen où la SOMUA avait transféré son siège social. En 1917, après la fusion avec les établissements Farcot de Saint-Ouen, et Champigneul de Paris, elle devint la Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie, usines Bouhey, Farcot et Champigneul. L’objet en était la construction mécanique générale (machines-outils, pièces hydrauliques, tracteurs, etc.). Le capital social, primitivement fixé à trois millions de francs, en atteignit 44 en 1924 et fut porté à 80 millions en 1943[81].
 L’ingénieur Jean Pérony en était le président[82]. Sur les 8 à 12 administrateurs que compta la société pendant la drôle de guerre et l’Occupation, cinq représentèrent Schneider et Cie, les plus hauts placés dans la hiérarchie du groupe étant Armand de Saint-Sauveur, administrateur de la SOMUA dès juin 1940, et l’ingénieur Paul Delahousse[83], chef de la Division de la mécanique et des constructions navales de Schneider, administrateur à partir du 18 novembre 1943. Citons encore Charles de Beaumarchais, déjà mentionné, Henri de Soulce de Freycinet[84], et Léon de Laborde[85].
L’ingénieur Jean Pérony en était le président[82]. Sur les 8 à 12 administrateurs que compta la société pendant la drôle de guerre et l’Occupation, cinq représentèrent Schneider et Cie, les plus hauts placés dans la hiérarchie du groupe étant Armand de Saint-Sauveur, administrateur de la SOMUA dès juin 1940, et l’ingénieur Paul Delahousse[83], chef de la Division de la mécanique et des constructions navales de Schneider, administrateur à partir du 18 novembre 1943. Citons encore Charles de Beaumarchais, déjà mentionné, Henri de Soulce de Freycinet[84], et Léon de Laborde[85].
Schneider & Cie était une société en commandite par actions. A ce titre, elle ne pouvait avoir d’administrateurs communs avec la SOMUA ; tel n’était pas le cas de l’Union européenne industrielle et financière (UEIF), représentée à partir du 4 avril 1940, comme pour la SW, par Albert de Boissieu. L’UEIF apportait à la SOMUA « son concours pour les questions financières et de trésorerie[86]. » Notons enfin, qu’en dehors du  conseil, un certain nombre de cadres de la SOMUA avaient appartenu à la société Schneider.
conseil, un certain nombre de cadres de la SOMUA avaient appartenu à la société Schneider.
L’usine principale de la société se trouvait 146, boulevard Victor-Hugo à Saint-Ouen (Seine). L’entreprise avait en outre des ateliers 45 à 51 rue de Clichy dans la même ville.
L’usine de repli se trouvait à Périgueux, dans le quartier de Chamiers qui n’était pas encore totalement aménagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous lisons à propos de la débâcle allemande à Périgueux au cours de l’été 1944 : « Au matin nous reçûmes l’ordre de nous porter à l’ouest de la ville, dans le quartier de Chamiers. A cette époque, ce quartier n’était qu’un vaste terrain qui servait à l’occasion de champ de course de chevaux. Il y avait très peu de constructions, les plus importantes étant le dépôt des chemins de fer puis l’usine de tracteurs SOMUA. En contrebas, entourée de jardins, coulait l’Isle (…) Depuis l’usine de tracteurs, partait une route qui rejoignait la RN 89[87]. » L’usine fut mise en route en mai 1940.
Une seconde installation de repli fut ouverte à Bordeaux[88]. En effet, le 20 mai 1940, après la première phase de l’offensive allemande, l’entreprise loua une usine dans les faubourgs de la capitale girondine pour y effectuer la réparation des chars de combat. Le travail y débuta dès le début du mois suivant et, le 14 juin, alors que la Wehrmacht entrait dans Paris, le premier char réparé fut livré à l’Armée française[89].
La SOMUA avait également une usine à Montzeron par Toutry (Côte-d’Or) dont le personnel s’élevait à environ 300 ouvriers. Tout avait débuté en 1835, quand le comte de Guitaut avait lancé sur le site l’exploitation d’une mine de fer ainsi que l’installation de forges et de laminoirs. Vers 1855, un industriel venu de Paris, Étienne Bouhey, acheta l’usine et lança la production de machines-outils qui se développa rapidement. Montzeron devint même à cette époque la première usine de fabrication de machines-outils en France. Des bâtiments furent construits pour accueillir les nombreux ouvriers : réfectoire, cantine, école d’apprentissage, église, et même un hôpital. Jusqu’en 1913, l’usine resta au sein de la famille Bouhey, date à laquelle elle fut reprise par la SOMUA[90].
En 1939, le site avait deux séries de fabrication : des machines-outils et des fraiseuses, mais aussi des organes destinés aux tracteurs à chenilles que l’usine de Saint-Ouen fabriquait pour le compte de l’Armée française[91].
Depuis 1920, l’usine de Vénissieux, Chemin des Charretières, était presque entièrement spécialisée dans la réparation des wagons et voitures de chemins de fer de la Cie PLM. Les conditions d’exploitation furent toutefois profondément troublées par la création de la SNCF en janvier 1938. Les dispositions prises par la société nationale se traduisirent par une baisse très sensible des commandes au point qu’à partir du 1er janvier 1939, le volume des travaux représentait moins de 20 % de l’alimentation normale antérieure[92]. Mais les besoins de la défense nationale vinrent rééquilibrer la situation. Pendant la drôle de guerre, l’usine de Vénissieux fabriquait des carrosseries de tracteurs MCG et MCL ainsi que leurs accessoires. Elle était titulaire de commandes de ces divers éléments pour l’aménagement de 1 008 tracteurs, dont 778 MCG et 230 MCL[93].
Depuis 1929, la société SOMUA avait réalisé un certain nombre de matériels militaires. En 1935, elle mit au point un prototype de char de cavalerie, le S-35, destiné à équiper les divisions légères mécaniques, modèle qui fut adopté par l’Armée française. Ce char présentait en effet des caractéristiques de vitesse, de maniabilité et de puissance de feu supérieures à celles de ses concurrents allemands. Malgré ces qualités, les commandes de l’État furent nettement insuffisantes : le S-35 fut donc construit à faible cadence (10 par mois) jusqu’en septembre 1939, ce qui rendait impossible l’organisation d’une fabrication en grande série. A cette date, 250 chars seulement avaient été produits. Les commandes étaient en outre remises trop tardivement pour assurer l’alimentation régulière des ateliers. Ce n’est qu’après la création du ministère de l’Armement, sur l’intervention de son titulaire, Raoul Dautry, que des commandes massives furent enfin lancées : la production atteignit 65 unités pour le seul mois de mai 1940 avec l’objectif de construire 100 chars pour décembre[94].
La SOMUA avait réalisé un nouveau prototype, dérivé du S-35, le S-40, plus maniable que le précédent, ainsi qu’un canon automoteur le 75 SAU-40. La construction en série de ces deux engins allait débuter lors de la signature de l’Armistice.
Comme d’autres entreprises engagées dans l’intense bataille industrielle de la drôle de guerre, la SOMUA reçut une lettre de félicitation du ministère de l’Armement, le 3 juin 1940, pour l’effort réalisé en faveur de la défense nationale, citation qui fut remise solennellement par le maréchal Pétain en personne à l’usine de Saint-Ouen, le 7 juin 1940[95].
Après la première phase de l’offensive allemande et le début de la bataille de France, tout le Nord et l’Est, puis la capitale, furent directement menacés par les troupes d’invasion.

Le polytechnicien Raoul Dautry, ancien président du réseau des chemins de fer de l’État, membre du CA de la SNCF, président de la société Hispano-Suiza, puis ministre de l’Armement (20 septembre 1939-16 juin 1940) © Rail Passion
Le 9 juin 1940, l’avant-garde de Rommel se trouvait à une centaine de kilomètres de Paris et des combats eurent lieu dans l’Eure, à Pont-de-l’Arche. Charles Rochette, ancien dirigeant de la Skoda[96], alors directeur technique du cabinet de Raoul Dautry, réunit les chefs d’industrie de la région parisienne intéressés dans la fabrication de matériel blindé pour fixer avec eux les modalités du repli du personnel et du matériel. Il ne s’agissait pas de ralentir la production des usines mais au contraire de l’augmenter tout en évacuant les pièces terminées, les machines rares ou non encore montées. Charles Rochette précisa nettement « qu’aucun moyen ne serait mis, en principe, à la disposition des industriels pour effectuer ces expéditions, les wagons étant réservés en priorité pour l’Aviation[97]. » Tous les camions disponibles dans les usines furent cependant réquisitionnés pour servir au repli. La question des secrets militaires touchant des fabrications sensibles fut également abordée, les dirigeants d’entreprise devant évacuer les dessins et les archives des sièges sociaux[98].
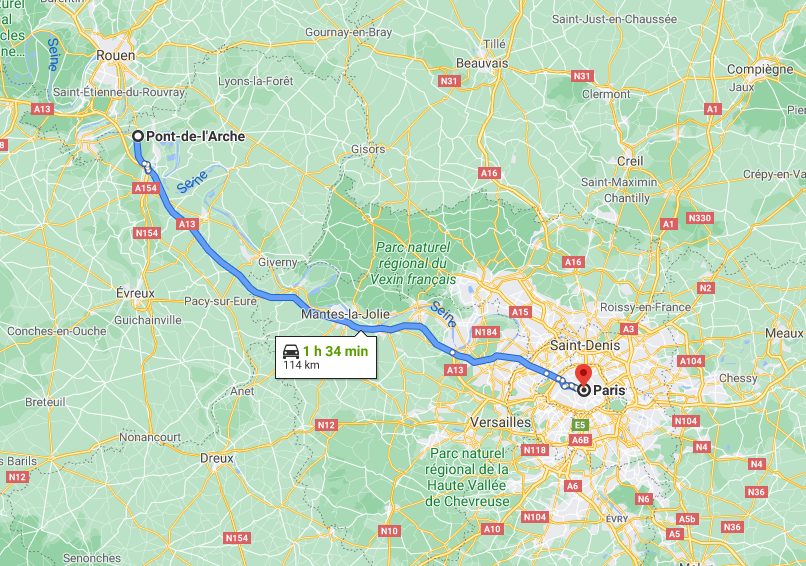
Cette capture d’écran d’une carte moderne permet de visualiser la courte distance qui séparait l’avant-garde de Rommel de la capitale. Bien entendu, les distances-temps actuelles ne sont pas comparables à celles du 9 juin 1940 © Google
Sur des renseignements alarmants émanant du comité des Forges, les directeurs de Schneider se réunirent le même jour, dimanche 9 juin, afin de prendre les dispositions pour le départ et de se procurer les wagons et camions nécessaires. Les bureaux d’études de l’Artillerie et des Constructions navales furent transportés à Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre où une partie des archives de ces deux services avaient déjà été entreposée plusieurs semaines auparavant[99]. En outre, de très nombreuses valeurs et archives furent dissimulées dans les caves du château d’Apremont-sur-Allier qu’Eugène Schneider avait acheté quarante ans plus tôt à sa belle famille, les Rafélis-Saint-Sauveur[100].
Le départ débuta le lundi 10 juin au Creusot où tout le personnel fut réuni le lendemain à l’exception d’un petit détachement demeuré à Paris sous les ordres d’un ingénieur. Jusqu’à l’arrivée des Allemands, d’incessantes navettes par camion évacuaient les pièces en cours de fabrication pour les sauver du pillage de l’ennemi.

Les troupes d’occupation entrèrent dans Paris le 14 juin 1940. Parade d’une unité de la Wehrmacht aux Champs-Élysées vers 1940-1941 © Bundesarchiv
Le 15 juin, des officiers de l’Armement, chargés d’organiser le repliement et les destructions dans les usines métallurgiques, vinrent au Creusot conférer avec les dirigeants de la société. D’un commun accord, il fut décidé que la gérance, la direction générale et les secrétaires généraux partiraient pour Bordeaux où se trouvaient trois usines dépendant du groupe Schneider : la laitonnerie et douillerie de Bordeaux, la Société des Forges et chantiers de la Gironde et la société mixte SOFMA. François Walckenaer, directeur de l’Exploitation, et Henri Stroh, directeur de l’usine du Creusot, restèrent sur place. Dès lors les fabrications étaient arrêtées, les lignes de transport de force et toutes les communications coupées. Les affectés spéciaux qui risquaient d’être arrêtés et le détachement marocain furent expédiés sur leurs dépôts[101]. Les ouvriers polonais, qui n’étaient pas jugés indispensables au fonctionnement des usines, avaient été invités à rejoindre les forces polonaises qui luttaient sur le sol français.
Au cours de la même période, le personnel de la SOM reçut l’ordre d’évacuer les usines de Paris et de se replier sur Dijon et Le Creusot. Le directeur-général, Antoine Castellani, demeura dans la capitale jusqu’au 13 juin afin d’obtenir des autorités françaises le moyen de procéder à l’enlèvement des appareils qui se trouvaient encore dans les ateliers et dont la valeur atteignait 50 millions de francs. Devant l’insuccès de ses démarches, il se replia avec ses principaux chefs d’atelier à Bléré en Indre-et-Loire où il avait une propriété.
L’évacuation de l’usine de Saint-Ouen de la SOMUA eut lieu dès le 9 juin conformément à l’ordre de Charles Rochette. Ce dernier appela au téléphone Jean Pérony et lui demanda de venir de toute urgence au ministère de l’Armement où il lui donna les instructions suivantes : « Évacuer en 36 heures toutes les fabrications chars, envoyer les chars prêts à Montlhéry par la route, ceux en cours de montage ainsi que les groupes montés (…) les pièces détachées et en général tous les éléments de chars par wagons ou camions à Périgueux[102]. »
Dès qu’il eut quitté Rochette, Pérony se rendit au restaurant où ses principaux collaborateurs prenaient leur repas. Ils mirent au point ensemble un plan d’évacuation aussitôt soumis au directeur de l’usine de Saint-Ouen et aux principaux chefs de service.
La SOMUA se trouvait donc en pleine effervescence quand le lundi 10 juin, vers 19 heures, Jean Pérony fut convoqué par téléphone à une conférence qui devait se tenir une demi-heure plus tard au siège du syndicat des Industries mécaniques de France, 11 avenue Hoche, à Paris. Il s’y rendit avec Jacques Cheysson[103], chef de service chargé des questions d’armement. Sur place se trouvaient déjà une vingtaine de dirigeants d’entreprise de la région parisienne. Paul Chaleil[104], président du syndicat patronal et directeur-général de la société Rateau, informa l’assistance de la gravité exceptionnelle de la situation. Il annonça qu’avant de quitter Paris, à 16 heures, Raoul Dautry lui avait donné des instructions qu’il devait transmettre au plus tôt à ses collègues. Aucun homme affecté à la production ou mobilisable ne devait tomber entre les mains de l’ennemi. En attendant le rétablissement de la situation militaire sur la Loire – on croyait encore en effet à un nouveau « miracle de la Marne » – les entreprises regrouperaient leur personnel afin de reprendre la production dans les usines de repli. Le ministre prescrivait d’organiser le départ dès le lendemain, 11 juin avant 13 heures, en utilisant tous les moyens de transport encore disponibles et, si ces moyens étaient insuffisants, il fallait partir à pied, par détachement de 300 hommes, placés sous le commandement d’un ingénieur, officier de réserve[105].
A 22 heures, Jean Pérony réunit une conférence nocturne à laquelle assistèrent, outre les chefs de service, de simples employés, dessinateurs, comptables… Au cours de cette conférence qui dura jusqu’à 2 heures du matin, les modalités du départ furent arrêtées, les chefs des détachements désignés, les véhicules capables de rouler affectés. Pendant ce temps, les équipes de nuit, volontairement maintenue dans l’ignorance de la situation suivant les ordres reçus du ministère, continuaient de travailler pour la défense nationale. On décida d’annoncer le départ à 7 heures du matin, profitant du moment où les équipes de nuit et de jour se relayaient.
De retour à l’usine, le mardi 11 juin à l’aube, Jean Pérony donna l’ordre d’évacuation au personnel visé par les instructions ministérielles. En quelques heures, les 2 200 personnes composant le personnel de Saint-Ouen furent dirigées vers la province, 1 800 environ sur l’usine de repli de Périgueux, dans laquelle une chaîne de montage de chars avait été préparée, et environ 400 sur le site de Montzeron où la fabrication des machines-outils devait être poursuivie – l’effectif total étant alors de 2 897 personnes. « Grâce à une activité fébrile maintenue sans interruption pendant 36 heures, de jour comme de nuit, 57 wagons et 41 camions représentant un tonnage de 800 tonnes environ furent chargés et expédiés et tous les matériel pouvant rouler furent envoyés par la route[106]. » En même temps, des spécialistes de l’entreprise continuaient de prêter leur concours aux militaires du dépôt d’Arpajon pour la mise en route des chars et l’instruction du personnel combattant. La société évacua également du dépôt de repli de Saumur tous les chars qui y étaient entreposés et les ramena à Périgueux. Les directeurs et chefs de service quittèrent Paris dans l’après-midi. Seuls un directeur provisoire, Jean-Baptiste Dumay[107], chef des services administratifs, et un personnel de garde demeurèrent à Saint-Ouen[108].
A l’issue de la conférence du 9 juin, les contrôleurs militaires détachés auprès de la SOMUA reçurent l’ordre du ministère de la Guerre de faire disparaître les documents intéressant les fabrications secrètes en dépôt dans leurs bureaux. L’ordre fut exécuté le 10 juin. Un contrôleur rassembla tous les dessins et tracés qu’il pu trouver et les plaça dans un sac qu’il jeta dans la Seine, à la hauteur du pont de Clichy. Mais cette destruction fut limitée et ne concerna pas les plans des chars S-40 et SAU-40 (automoteur de 75 CAM), dont il resta un millier de clichés environ. Il fallut en outre évacuer les deux prototypes dont l’aménagement intérieur n’était pas achevé au moment de l’exode[109]. Ils furent dirigés sur Saumur, puis sur Périgueux où ils arrivèrent le 19 juin, et enfin sur Montauban et Bergerac à la fin du mois.
En raison de la rapidité de l’offensive allemande, le personnel de l’usine de Montzeron par Toutry en Côte-d’Or n’eut pas le temps de se replier et dut rester sur place, mais interrompit les fabrications en raison de l’absence de la direction, du manque de courant électrique, de matières premières et de numéraire[110]. L’usine de Vénissieux, qui allait se trouver par la suite en « zone libre », ne fut pas évacuée[111].
Le logement et le ravitaillement du personnel replié ne fut pas chose aisée, particulièrement à Périgueux, en raison de l’afflux massif de réfugiés. Les camions de la SOMUA permirent cependant à la préfecture de la Dordogne de résoudre les difficultés logistiques.
Quand Bordeaux et Périgueux furent à leur tour menacées par les troupes allemandes, l’entreprise évacua le matériel à Montauban où il fut pris en charge par l’armée française[112].
Les troupes allemandes occupèrent Le Creusot, le 17 juin 1940, à 12 heures 30. A cette date, la direction générale était toujours repliée à Bordeaux où elle demeurait en contact étroit avec les autorités françaises[113]. L’effectif du Creusot s’élevait alors à environ 4 800 personnes, employés et ouvriers, contre plus de 13 000 avant l’exode : plusieurs départs étaient intervenus, notamment celui des requis, des affectés spéciaux, d’une partie des coloniaux, des étrangers et des embauchés récents[114].
Les Allemands prirent possession de l’hôtel particulier de la société, la Petite Verrerie [115], puis se rendirent auprès de la direction de l’usine où le maire fut convoqué. Arrivés « la main tendue », les officiers du Reich furent reçus par François Walckenaer, directeur de l’Exploitation, et Henri Stroh, directeur de l’usine du Creusot :
« La conversation a été menée par M. Stroh, en raison de sa grande connaissance de la langue allemande, relate un membre de la direction après-guerre. L’un des officiers s’est présenté comme étant le fils d’un des directeurs généraux de la firme Krupp.
« M. Stroh a accepté la main qui lui était tendue, mais M. Walckenaer l’a refusée, en disant : « on ne serre pas la main d’un vaincu ». Devant la réaction des Allemands, M. Stroh leur expliqua que M. Walckenaer, ex-officier au GQG en 1918, était particulièrement affecté par la débâcle[116]. »
Abel Borel, chef-adjoint de la division de la Mécanique et des Construction navales de Schneider, était lui aussi présent lors de l’arrivée de la Wehrmacht au Creusot :
« Au moment de l’invasion allemande, je suis resté sur place. Les Allemands sont venus à cinq ou six pour visiter la maison (c’est-à-dire l’entreprise, ndr). Ils ont demandé des précisions sur l’organisation de la maison et se sont retirés. Deux ou trois jours après, ils sont revenus en nombre plus grand, officiers et interprètes, en demandant des renseignements sur les archives. Nous avons répondu très évasivement, et nous avons pris la précaution de ne pas leur faire visiter les locaux où subsistaient celles des archives que nous n’avions pas eu le temps d’évacuer.
« Dès cette deuxième visite, les Allemands nous avertirent qu’ils nous passeraient des commandes, sans spécifier qu’il s’agirait de commandes de guerre[117]. »
Le 18 juin, le courant hydroélectrique fut coupé et la centrale thermique mise en marche. Le 20 juin, les Allemands installèrent des postes de garde à toutes les portes de l’usine tandis que la Kommandantur prenait ses quartiers dans les locaux de l’hôtel de ville[118]. L’usine ferma le lendemain, 21 juin, à 16 heures 30[119].
L’arrêt fut de courte durée car tout militait pour une reprise rapide de l’activité[120]. Débutant vingt-quatre heures seulement après l’arrivée des troupes d’occupation dans la ville, les visites d’officiers allemands se succédèrent à un rythme soutenu – plus de vingt-cinq en cinq semaines, presque toutes dirigées par de hautes personnalités de la Wehrmacht et de l’industrie lourde du Reich. Pour ne pas publier une énumération fastidieuse, nous avons rassemblé dans le tableau suivant celles que nous avons pu identifier grâce à différentes sources :
Tableau 2 : Visites de personnalités allemandes aux usines Schneider du Creusot du 19 juin au 30 juillet 1940.
Sources : Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 41-42. AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie). Note manuscrite, s. n. s. d. « Visites reçues au Creusot les 12 et 13 juillet ». AFB SS1130-07. Calendrier des relations avec les autorités allemandes, [texte manuscrit] s. n., s. d. AFB 01MDL040-16. Kriegstagebuch Nr. 1 – Rü-In C (Nordostfrankreich) Begonnen 8.7.1940 Abgeschlossen 31.12.1940. BA-MA RW/24/181. Ferngespräch [Appel téléphonique de] Anruf Oblt [Oberleutnant] Gerhardi bei [au] Major Worm, du 3.7.1940. BA-MA RW/46/96.
| Visiteurs | Date | Objet |
| Commission Bureau de l’Armement (Kommission des Waffenamt) dirigée par le Major Varenhorst[121] de l’OKH + 2 ingénieurs civils, [Spielvogel et Elsenberg] | 19-06-1940 | Envisage la fabrication de locomotives |
| General von Kleist | 20-06-1940 | NP [Non précisé] |
| Oberstleutnant Wendt de l’AOK[122] [stationné à Chagny] | 22-06-1940 | Rétablir les services extérieurs |
| Major Svoboda et Dr Walter Rohland de la DEW et du ministère de l’Armement et des munitions | 27-06-1940 | Visite de l’usine – chars et blindages de chars |
| Oberstleutnant Oberhas (commandant de la place) et von Lissay | 30-06-1940 | Rétablir l’ordre économique |
| Hauptmann Steinberger | 30-06-1940 | Signale qu’il n’a trouvé aucun ouvrier disponible pour des réparations aux Chantiers de Chalon toujours fermés |
| Major Ram et Oberst Wosch, nouveau commandant de la place | 05-07-1940 | Évoque la possibilité d’un enlèvement de certains stocks par le GQG allemand |
| Ing. Oberbaurat Hartmann de la Reichsbahn | 05-07-1940 | Consultation pour 50 locomotives avec rechanges |
| Hauptmann von La Roche, directeur de la BAMAG | 06-07-1940 | Réclame la livraison de tôles en acier et de chaudières pour acide sulfurique |
| Idem | 07-07-1940 | Visite l’aciérie du Breuil |
| Oberst Sturm [+ indication illisible] | 09-07-1940 | Visite du Polygone et de CM[99] |
| Mission Marine[100] dirigée par le Fregattenkapitän Bach | 10-07-1940 | Demande d’offres pour éléments de presses Wagner |
| General Bührmann du RWM | 12-07-1940 | Exige une liste des stocks de métaux |
| Generaloberst Ritter von Leeb[101] | 13-07-1940 | Visite « minutieuse » de l’usine |
| Oberstleutnant Schricker du RWM | 13-07-1940 | Programme de fabrication Schneider |
| Major von Hofacker et Rittmeister von Falkenhausen | 13-07-1940 | Programme de fabrication Schneider |
| Arrivée du Generalmajor Dietinger et de Richard Nagel | 16-07-1940 | NP |
| Missions techniques de Fry de l’OKH et du Baurat Steinhart de l’OKM[126] | 20-07-1940 | Réquisition d’éléments de blindage et de canon pour étude |
| Beckhäuser gérant de Wagner Dortmund | 20-07-1940 | Visite en vue de la commande de presses |
| Fry de l’OKH et Baurat Steinhart de l’OKM | 21-07-1940 | Visite sous la direction du Freg. Kap. Melins et de l’Ing. von Knudson |
| Dir. Gerlenberg et Ing. Knetsch de l’OKH | 22-07-1940 | NP |
| Baron von Schmidt du RWM et von Daniels du Wirtschaftsrüstungsstab de Berlin | 22-07-1940 | Visite de l’usine |
| RüstungsInspekteur Graf Vitzthum, Major von Sybel et Major Gerhardt[127] | 22-07-1940 | Visite de l’usine |
| Rünstungsinspektion de Dijon | 23-07-1940 | Visite de l’usine |
| La Roche et le dir. Schmidt (Mineralölbau) | 25-07-1940 | Visite de l’usine. Demande de corps creux |
| Retour du General Dietinger | 25-07-1940 | NP |
| Commission technique du Generalluftzeugmeister conduite par Günther Tschersich | 28-07-1940 | Visite de l’usine |
| Baurat Stellenrecht | Visite de l’usine (tours à bombes et à corps creux) | |
| Trois officiers de la Luftwaffe + Richard Nagel | 30-07-1940 | Visite de l’usine |
Un certain nombre de visiteurs mentionnés dans ce tableau figuraient parmi les plus éminents représentants de la Wehrmacht et de l’industrie lourde allemande. Le général Ewald von Kleist, qui visita l’usine en personne dès le 20 juin, était pour ainsi dire, avec Heinz Guderian[128], et Erwin Rommel, l’un des vainqueurs de la France, l’officier supérieur qui, avec ses cinq divisions de chars (Panzergruppe Kleist) avait constitué le fer de lance de la campagne de l’Ouest en mai 1940.
Willibald Spielvogel, l’un des deux premiers ingénieurs allemands à visiter l’usine du Creusot avec son collègue Elsenberg, dès le 19 juin, était l’un des dirigeants de la Rheinmetall-Borsig (RMB)[129] de Düsseldorf, entreprise qui allait prendre le contrôle des usines Schneider le mois suivant[130].

Canon anti-char Pak-40, résultat du projet liant depuis 1939 Rheinmetall-Borsig, Krupp et la Wehrmacht. Il s’agit d’une amélioration des modèles 36 et 38 utilisés pendant la guerre d’Espagne © Werner Haupt/Podzun Pallas Verlag
Le Dr Ingénieur Walter Rohland, présent le 27 juin, était l’animateur de la Deutsche Edelstahlwerke (DEW) de Krefeld dont il fut administrateur jusqu’en 1940[131]. Membre du NSDAP depuis 1933, il dirigeait le “Comité spécial des chars d’assaut” (Sonderauscshuss puis Hauptausschuss Panzerwagen) au sein du ministère de l’Armement et des Munitions du Reich où il était responsable de la rationalisation et de l’organisation de la production des panzers. Walter Rohland continuait d’assurer conjointement le développement de la DEW, grande entreprise d’armement qui fournissait à la Wehrmacht blindés, canons, grenades et jusqu’aux casques d’aciers.
Notons également la présence les 6 et 7 juillet du Hauptmann Udo Freiherr von la Roche-Starkenfels. Cet aristocrate d’origine huguenote dirigeait la Bamag-Meguin[132] AG de Berlin qui faisait partie du puissant groupe Julius Pintsch ; il dirigeait aussi la section Fabrication des équipements (Fachgruppe Apparatebau) du Groupe économique de l’ingénierie mécanique (Wirtschaftsgruppe Maschinenbau), l’une des subdivisions du Groupe Industrie du Reich (Reichsgruppe Industrie).
Le Generalmajor Robert Bührmann (1879-1940), signalé au Creusot le 12 juillet, était Inspecteur chargé de la collecte et de l’utilisation des matières premières en Belgique et en France. Comme le précise le compte rendu d’une réunion qu’il eut avec le général Barckhausen à Paris quelques jours plus tard, cet officier supérieur était directement missionné par le Reichsmarschall Göring[133].
Les autorités d’occupation dépêchèrent également au Creusot d’autres responsables de l’organisation militaro-industrielle du Reich en la personne du Major von Hofacker[134] et du Rittmeister von Falkenhausen[135]. Caesar von Hofacker fut le collaborateur (1927) puis le fondé de pouvoir (1936) des Vereinigte Stahlwerke de Düsseldorf, consortium constitué sous la République de Weimar avec l’aide des finances américaines[136]. Officier de réserve de la Luftwaffe, il était alors chargé de la division “Fer et acier” du commandant militaire allemand à Paris. Quant à Alexander von Falkenhausen, il était commandant de l’administration militaire en Belgique et dans le nord de la France depuis le 22 mai 1940. Tous deux étaient membres de l’état-major du général Alfred Streccius (1874-1944), nommé le 1er juin 1940 commandant des troupes allemandes aux Pays-Bas, puis le 27 juin et jusqu’en octobre, chef de l’administration militaire allemande en France, hôtel Majestic à Paris[137].
Günther Tschersich (1899-1953) – mentionné au Creusot le 28 juillet – faisait partie du groupe d’ingénieurs qui travaillaient alors sous les ordres du Generalluftzeugmeister (GL), Ernst Udet. Affecté ou employé directement par le ministère de l’Air du Reich (RLM), l’ingénieur-général (Generalingenieur) – grade qui correspondait à celui de général de division – se voyait confier le plus souvent une mission technique particulière comme l’approvisionnement ou la fabrication des moteurs, et dans le cas de Tschersich, le département de la planification (Chef der Planungsabteilung). Günther Tschersich était également président du conseil de surveillance de la Deutsche Luftfahrt- und Handels AG de Berlin, membre du conseil de surveillance de la Bank der Deutschen Luftfahrt, c’est-à-dire l’organe de financement de l’aéronautique allemande, de la Hansa-Leichtmetall de Berlin, entreprise qui avait pour but de drainer les ressources d’aluminium et de bauxite nécessaires à la Luftwaffe, du Junkers Group de Dessau et enfin de la Messerschmitt AG d’Augsbourg[138]. A noter que Tschersich vint au Creusot muni d’une autorisation de la commission française d’Armistice de Wiesbaden, signée par le général Huntziger, et que le but affiché de sa visite était « touristique », Le Creusot ne constituant en effet qu’une étape du voyage qui le menait dans le Midi, très certainement pour y inspecter les usines aéronautiques[139].
Pendant que les missions allemandes se succédaient, les dirigeants français ne demeuraient pas inactifs. Ils effectuaient des tournées d’inspection des mines et des usines du groupe pour en assurer la remise en route. Les premières difficultés à résoudre étaient le franchissement de la ligne de démarcation, le rétablissement de la force motrice et des moyens de transport, le manque de trésorerie, enfin l’obtention de commandes. Le directeur d’Exploitation François Walckenaer visita ainsi Montceau-les-Mines, le 20 juin, les houillères de Decize, le lendemain, puis les Chantiers de Chalon, et une nouvelle fois Décize, respectivement les 1er et 2 juillet[140].

Les ateliers centraux de la mine à Montceau en 1927 ©-CUCM – Document-Ecomusée – reprod. D. Busseuil
L’un des deux directeurs-généraux du groupe, André Vicaire, accompagné par Henri Faucillon[141], directeur de la division Métallurgie des établissements Schneider, se rendit à Paris, le 26 juin, muni d’un ordre de mission du ministère du Travail, André Février, afin d’assurer la reprise. Il s’arrêta en chemin à Decize et au Creusot où il présida une conférence deux jours plus tard. A Paris, il rencontra deux représentants de la SNCF afin d’obtenir des commandes de matériel ferroviaire, puis s’entretint avec Armand de Saint-Sauveur, l’autre directeur-général du groupe, qui était rentré à Paris vers le 10 juillet[142]. Au cours de la même période, André Vicaire fut convoqué par les généraux allemands Schubert, Barckhausen et von Leeb. Il revint le 17 juillet au Creusot et visita Chalon le lendemain. Pendant ce temps, des missions dirigées par des ingénieurs de l’entreprise furent envoyées à Cize-Bolozon dans l’Ain, à Lyon et à Clermont, pour des suivis ou des prises de commande.
Le 24 juin, les dirigeants français demandèrent la reprise des « relations ferroviaires ». Les agents des bureaux de Paris purent emprunter les chemins de fer le 26 ; le premier train en direction d’Étang-sur-Arroux partit le même jour et le trafic entre Nevers et Chagny fut rétabli le 28. Les Allemands remirent en marche la centrale de Chancy-Pougny au cours de la même période[143]. La mine de Decize était prête à fonctionner : en effet, comme dans toute la région du Centre, les destructions ordonnées par l’Administration française pendant l’exode s’étaient réduites à peu de choses[144]. Les chantiers de Chalon n’étaient pas encore libérés car les Allemands s’en étaient servis pour entreposer les fruits de leur pillage dans la région lyonnaise.
L’usine du Creusot rouvrit ses portes le 7 juillet avec un effectif d’environ 2 500 personnes. Une fois leur tâche accomplie, le directeur d’Exploitation et le directeur de la division de la Mécanique et des constructions navales rentrèrent à Paris[145]. Vers le 10 juillet, Eugène Schneider et le détachement de Bordeaux regagnèrent le siège, 42, rue d’Anjou à Paris (8ème) où les services furent progressivement réorganisés grâce au retour des détachements du Creusot et de Saint-Honoré-les-bains.
Dix-sept jours seulement s’étaient donc écoulés entre l’arrivée des troupes allemandes au Creusot et la réouverture de l’usine, un temps relativement court si l’on songe aux nombreuses difficultés pratiques qu’il avait fallu surmonter pour y parvenir. Quant aux prises de commandes, françaises et allemandes, elles furent également souscrites rapidement. Le démarchage que l’ingénieur Hartmann des chemins de fers allemands avait effectué au Creusot le 5 juillet porta vite ses fruits, d’autant plus que le gérant, Eugène Schneider, tenait particulièrement aux commandes de matériel ferroviaire comme nous le verrons plus loin. Dès le 22 juillet 1940, deux représentants de l’entreprise, l’ingénieur Paul Delahousse, chef de la division de la Mécanique et des constructions navales à Paris [146], et Paul Thomassot, chef d’études Locomotives et Chaudronnerie[147], furent convoqués à l’office central des chemins de fer du Reich [Reichsbahn Zentralamt – RZA], à Berlin. A notre connaissance, il s’agit de la première visite effectuée par des représentants de l’industrie française en Allemagne sous l’Occupation. Le voyage avait pour but de négocier le contrat et de permettre aux ingénieurs français de se familiariser avec la technique de soudure et les méthodes d’usinage utilisées en Allemagne. En outre, il était envisagé de construire 150 locomotives par un pool industriel composé notamment de sociétés allemandes dont Siemens et Robert Bosch[148].
La direction de Schneider ne put reprendre possession des chantiers de Chalon, transformés par la Wehrmacht en dépôt de butin, que le 18 juillet 1940. En quittant l’usine, les Allemands emportèrent une grande partie des matières premières en magasin ainsi que des pièces montées sur des fournitures en cours d’exécution, en particulier sur le sous-marin Antigone[149]. Autre difficulté : les Chantiers se trouvaient sur la rive gauche de la Saône, alors en zone libre, tandis que la ville est située sur la rive droite, en zone occupée ; les ouvriers avaient donc besoin d’un laisser-passer pour aller travailler[150].
Les filiales et entreprises contrôlées en partie par Schneider reprirent également le travail. Ce fut le cas de la SOMUA ou encore de la Société d’optique et mécanique de haute précision (SOM).
Dès le 15 juin 1940, et en raison même de la notoriété de SOMUA en matière de constructions de chars, les Allemands prirent possession de l’usine de Saint-Ouen qui fut occupée militairement le 29 juin. Un commissaire, ou plus précisément un mandataire industriel (Industribeauftragte ou IB) fut nommé et entra en contact avec le directeur provisoire. Des réparations de chars et de tracteurs français ramenés des champs de bataille furent entreprises sur l’ordre des Allemands avec le peu de personnel demeuré sur place. Le directeur-général Pérony ne rentra d’exode que le 21 juillet 1940. Il alla tout d’abord prendre des instructions auprès du conseil d’administration « dont les membres me firent connaître la situation de l’usine et me demandèrent de reprendre mon poste à l’effet de ne pas abandonner le personnel aux occupants, et d’empêcher si possible le transfert de l’outillage en Allemagne[151]. ». Il se rendit ensuite à Saint-Ouen : « Lorsque je me suis présenté à l’usine, je trouvai un commissaire allemand installé dans mon bureau (…) Celui-ci m’a déclaré que nos usines ”travailleraient uniquement d’après ses instructions”, ajoutant que si ”la direction française n’apportait pas la bonne volonté nécessaire, elle serait remplacée par une direction allemande, l’outillage et le personnel pouvant même être envoyés à Cassel (aux usines Henschel[152]), où un bâtiment était prêt à les recevoir. »
Les recherches que nous menons sur le sujet depuis vingt-cinq ans confirment en partie les affirmations du directeur-général. La contrainte exercée sur les sociétés de construction de matériel blindé comme la SOMUA, Renault, Panhard et Hotchkiss fut effectivement très forte puisqu’elle s’exprima par le biais d’un véritable ultimatum lancé sur ordre du général allemand Karl Zukertort le 1er août 1940. Toutefois, avant cette mise en demeure à laquelle il était pratiquement impossible de se soustraire, la SOMUA et Hotchkiss avaient déjà cédé aux exigences allemandes, la première ayant même souscrit un premier contrat de réparation, le 12 juillet 1940, alors que le directeur-général n’était pas rentré à Paris et donc, très certainement, avec l’accord d’un membre du conseil d’administration resté sur place.
L’usine de Montzeron en Côte-d’Or fut occupée par l’armée allemande dès le 16 juin. Le travail y reprit progressivement au cours du mois de juillet, d’autant plus facilement qu’elle n’avait subi aucun dégât. A partir de la reprise, Henri Fleury, directeur de l’usine, alors gravement souffrant, fut assisté (et de fait remplacé dès cette date) par Henri Jungblutt[153], directeur-général adjoint de la SOMUA, un ancien de Schneider, ingénieur diplômé de l’École des Arts et Métiers de Cluny, lui-même fils d’un ouvrier professionnel creusotin[154]. Quant aux usines de Vénissieux et de Périgueux, qui se trouvaient en zone libre, elles n’avaient jamais cessé de travailler[155].
La situation de la SOM fut similaire à celle de la SOMUA. Quand le directeur-général, Antoine Castellani[156], rentra d’exode le 8 juillet 1940, il trouva les ateliers de Paris occupés par l’armée allemande. Quelques jours plus tard, il se mit en rapport avec les autorités d’occupation et avec la société Zeiss qui, d’après sa déposition à la Libération, aurait exigé le concours de la société française.
La reprise fut difficile à l’usine principale de la SW, qui fut fermée du 14 juin au 8 juillet 1940 inclus, la situation étant particulièrement grave en Champagne, coupée de toute communication par fer, en raison de la rupture de deux ponts de voies ferrées et d’un pont route ; la communication avec Paris ne pouvait alors s’effectuer que par de longs détours[157]. Charles de Beaumarchais rentra d’exode à la fin du mois de juillet.
L’usine de Champagne-sur-Seine de SW reçut plusieurs missions allemandes dont une dirigée par le général Wilhelm Schubert, chef de l’Inspection de l’Armement pour la France. Les visiteurs s’intéressèrent plus particulièrement au matériel électrique disponible, à l’usinage et au montage de carcasses de chars et à la construction des appareils moteurs de plongée pour sous-marins[158]. Comme dans le cas du Creusot, certains officiers connaissaient parfaitement l’industrie. Le capitaine Holtmann de la Kommandantur de Fontainebleau, qui visita l’usine le 6 juillet, avait travaillé avant-guerre à la société Préparation industrielle des combustibles (PIC) d’Avon[159]. La fréquence de ces visites ne signifie pas cependant que la pression se concrétisa unanimement et immédiatement. Louis Rouvray, chef du service Gros matériel (machines d’une puissance supérieure à 300 cv hors traction et Marine), rentré d’exode début août sur ordre de la direction, ne fut en contact avec les Allemands qu’à la fin de l’année 1940[160]. Le chef de la Comptabilité, Pierre Nectoux, ne rentra à Paris que fin octobre.
Tableau 2 : Visites de personnalités allemandes aux usines de Champagne-sur Seine de la Société Le Matériel électrique SW du 1er juillet au 10 août 1940.
Sources : Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d. AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 43.
| Visiteurs | Date | Objet |
| Deux officiers | 02-07-1940 | Visite de l’usine |
| Deux autres officiers | 03-07-1940 | Réquisition des matériaux pour la réparation du viaduc de Moret |
| Hauptmann von Vitaly | 04-07-1940 | Enquête sur les fabrication et constatation de l’existence de l’atelier d’obus |
| Hauptmann Holtmann, attaché à la Kommandantur de Fontainebleau | 06-07-1940 | Remarque l’atelier de bobinage, les moteurs de sous-marins et les pompes |
| Deux officiers | 07-07-1940 | Fabrication de chars |
| Hauptmann Ortner, commandant des forces d’occupation de Champagne | 09-07-1940 | Demande la reprise immédiate du travail « dans l’intérêt des travailleurs » |
| Inspecteur Hartenstein | 14-07-1940 | S’intéresse aux fabrications de chars |
| Hauptmann Ortner, commandant des forces d’occupation de Champagne | 15-07-1940 | Vient vérifier la suite donnée à ses instructions du 9 juillet |
| Inspecteur Hartenstein et General Karl Zukertort | 17-07-1940 | Dans quelles conditions la fabrication de chars pouvait être reprise |
| General Wilhelm Schubert de la Rü-In Frankreich + 2 officiers et 1 ingénieur | 22-07-1940 | Le général s’intéresse aux commandes de chars et aux commandes civiles pour l’Allemagne |
| Fregattenkapitän Bach et Scheitler | 26-07-1940 | Enquête sur les sous-marins – 3 équipements seront réquisitionnés le 23 août |
| Leutenant x | 09-08-1940 | Constate l’existence de carcasses de chars et d’obus. Demande des renseignements sur les stocks |
| Conseiller Mayer de l’hôtel Astoria[161] « section Armements » + 1 ingénieur | 10-08-1940 | Viennent étudier les moyens de production et de reprise. Demande de nombreux renseignements |
Le 23 août, la Kriegsmarine réquisitionna trois ensembles de moteurs de propulsion et l’ensemble de pompes pour sous-marins que l’usine de Champagne devait terminer. Des convertisseurs pour électrolyse furent également saisis par Siemens mais SW parvint à éviter la réquisition de trois locomotives sur les quatre qui avaient été commandées par l’État et auraient dû être, de ce fait, considérées comme butin de guerre. La société réussit enfin à dissimuler une partie de ses stocks de cuivre en effectuant de fausses déclarations[162].
Pendant ce temps la mise sous tutelle de Schneider s’organisait. Le groupe du Creusot fut contrôlé, non pas seulement par un ou plusieurs IB comme les autres entreprises françaises de la zone occupée, mais par une Mission de surveillance allemande (Deutsche Aufsichtsbehörde). Le 10 juillet 1940, l’ingénieur métallurgiste Richard Nagel de la Rheinmetall-Borsig (RMB) de Düsseldorf reçut un appel téléphonique de Willibald Spielvogel, l’un des principaux dirigeants de l’entreprise, l’informant qu’il était mis à la tête d’une mission chargée de contrôler la société Schneider du Creusot et que celle-ci était placée sous la tutelle de la RMB. La mission serait dirigée par Richard Nagel et par le Generalmajor Robert Dietinger. Suivant les pouvoirs qui leur avaient été conférés le 10 juillet, les deux hommes devaient « organiser la mise en route immédiate des usines du Creusot, du Breuil et de Henri-Paul avec la collaboration des services de direction de la maison Schneider » et « veiller à l’exécution des commandes passées par les intéressées aux livraisons de l’industrie allemande. » Tous deux étaient en outre « autorisés à pénétrer dans les usines ci-dessus mentionnées et à se procurer auprès des cadres de la maison Schneider tous les renseignements concernant l’exécution de ces travaux[163]. »

Atelier des pièces d’artillerie de Düsseldorf-Derendorf de la Rheinmetall-Borsig, Années 1930 – © Zentralarchiv der Rheinmetall AG, Düsseldorf – Cote B 3111, F 26
Une seconde lettre, adressée le 26 juillet 1940 à Schneider par le haut-commandement de l’Armée de terre (OKH), précisait que Dietinger et Nagel avaient la mission « de remettre en marche, immédiatement, toutes les usines du groupe Schneider (…) et de veiller à l’exécution des commandes passées par les services et l’industrie allemands. Chacun d’eux (était) autorisé à entrer dans les usines et à demander aux membres du personnel de la maison Schneider les renseignements nécessaires à l’exécution de sa mission. Ils (avaient) en outre tout spécialement droit de regard dans les documents servant à l’établissement des prix de la direction du groupe ainsi que des diverses usines[164]. »
La mission allemande s’installa au Creusot le 30 juillet[165] dans les locaux mêmes de la direction ; sa branche civile déménagea par la suite à Paris vers le 1er octobre 1940, près du siège social de l’entreprise. Il existait par ailleurs un « service de Liaison » à Berlin, situé 56/57 Friedrichsstrasse.
Comme le remarqua l’expert-comptable Paul Caujolle en 1948 la mission de surveillance disposait d’un pouvoir quasi-absolu sur l’ensemble des usines du groupe Schneider.
Ce type de prise en charge (Betreuung), assez inhabituel, fit l’objet d’une discussion entre l’Inspection de l’Armement (Rünstungsinspektion – Rü-In) et le capitaine Bühring de l’état-major Rüstung à la fin du mois d’août 1940. D’ordinaire, les conseils d’administration des entreprises françaises dépendaient des Rü-In du secteur dans lequel se trouvait le siège administratif, à l’instar de ce qui se pratiquait dans le Reich. De même, la tutelle des différentes usines d’un groupe était assumée par la Rü-In du secteur dans lequel elles étaient implantées. Bien que la mission de surveillance ne répondît pas à ces critères, les responsables allemands jugèrent qu’il n’était pas judicieux d’apporter des modifications avant la conclusion des négociations en cours avec le gouvernement français à Wiesbaden. Les Allemands eux-mêmes n’avaient pas encore décidé de quelle manière s’effectuerait précisément la prise en charge de la société. Pour l’heure, les cinq principales usines du groupe relevaient de Nagel, chargé de mission spécial qui siégerait à Paris, tandis que les autres usines se trouvaient sous le contrôle du Generalmajor Dietinger installé au Creusot[166].
La décision de surveiller le groupe Schneider avait été prise par Adolf Hitler lui-même en juin 1940 et fut notifiée par le général Thomas, chef du département Économie du haut-commandement de la Wehrmacht et, incidemment, membre du conseil d’administration de RMB. Le chancelier persistait dans l’idée que la France ne devait pas fabriquer de matériel de guerre complet mais des pièces détachées afin de délester l’industrie du Reich sans toutefois représenter une menace pour l’avenir ni concurrencer l’industrie allemande.
« Le Führer et commandant suprême a décidé que l’ensemble du groupe Schneider-Le Creusot avec ses trois usines “Le Creusot”, “du Breuil” et “Henry Paul” (sic), continuerait à fonctionner sous contrôle allemand, mais pas pour la production de matériel de guerre.
« Conformément à cette décision, la société “Le Creusot” est à la disposition de différents donneurs d’ordre pour l’attribution de commandes de sous-traitance. L’ensemble du groupe est ainsi attribué pour tutorat à l’OKH (…) avec la participation de l’OKW et du Ministre de l’Air du Reich et commandant en chef de l’Aviation.
« Il a été demandé au Bureau de l’Armement de l’OKH (…) de mettre en place un spécialiste pour l’ensemble de la direction technique du groupe par la Rheinmetall-Borsig. Il conviendra par ailleurs de nommer un officier en tant que mandataire industriel (…)[167]. »

Le général Georg Thomas (à droite) avec le ministre de la Défense de Bulgarie à Berlin en 1943 © Paul von Hase/Wikipedia
Le 28 juin, l’Oberstleutnant Fach, Quartier-maître général de l’AOK 2, saisissait dans les caves voutées de la propriété d’Eugène Schneider, le château d’Apremont-sur-Allier, situé à 15 km de Nevers, 84 caisses « contenant probablement l’ensemble du trésor de la banque Schneider & Cie et de la société holding du groupe Schneider-Le Creusot »[168]. Fach réclamait à Berlin des instructions au sujet de ces avoirs conservés dans un coffre blindé sous la surveillance de l’état-major du 9ème corps d’armée de la Wehrmacht qui avait pris ses quartiers dans le château d’Apremont.
Le 30 juin, les caisses furent convoyées par une colonne de camions vers Troyes, de l’autre côté de la ligne de démarcation, par l’Oberstleutnant Gerhardi de l’état-major du quartier-maître général[169]. Un inventaire sommaire s’effectua avant le départ en la présence de M. Gauthey, secrétaire d’Eugène Schneider. Suivant la déclaration faite aux Allemands par ce dernier, les caisses contenaient essentiellement des actions, des obligations et diverses participations ; elles provenaient de Paris, du Creusot et de l’Arbed, et avaient été entreposées le mois précédent dans le château d’Apremont. Arrivées à destination le 1er juillet, elles furent confiées à l’Orstkommandantur de Troyes et placées dans les coffres du Crédit du Nord.
D’après un autre rapport allemand les valeurs, que la société française avait dissimulées dans une « cachette » pendant l’exode, atteignaient le montant de trois milliards de francs :
« Les 29 et 30.07 [1940], 176 caisses, sacs, coffres et corbeilles contenant des documents, des annexes, des titres de propriété, des archives, des livres de compte ainsi que des documents non identifiés concernant la société Schneider & Cie et Monsieur Schneider lui-même, ont été extraits des caves de la Ortskommandantur de Troyes[170] et pris en charge par deux représentants du DSK[171] (…) Les documents ont été acheminés vers Paris à l’aide de sept camions. En accord avec le Commissaire allemand de la Banque de France, ils ont été mis sous séquestre et entreposés dans les caves voutées de cette banque.
« Le DSK a pris en charge les valeurs estimées à au moins 3 milliards de francs.
« Le DSK démarrera aussitôt l’évaluation détaillée des valeurs et des documents. Dès que des documents laisseront présager un intérêt pour l’économie militaire, l’État-major de l’Économie de la Défense et de l’Armement sera associé à l’expertise[172]. »
Les autorités allemandes se demandèrent si ces biens pouvaient être considérés comme du butin et donc purement et simplement confisqués. Interrogé à ce sujet, le Groupe Rüstung répondit le 9 août 1940 que ces valeurs n’appartenaient pas à l’État français, qu’elles relevaient bien de la propriété privée et ne pouvaient à ce titre être considérées comme du butin de guerre destiné au Reich[173].
En décembre 1941, la mission de surveillance allemande de Schneider voulut par ailleurs s’emparer de l’importante « collection » de l’entreprise qui était constituée de matériel de guerre datant des années 1900 à 1923. La mission était d’avis qu’il fallait considérer cette collection comme du butin, la confisquer et la transférer à l‘école professionnelle du Ministère de l’Armement de l’Armée de Terre de Berlin-Treptow. Mais cette fois encore, l’état-major s’y opposa sur avis du groupe Rüstung : étant donné le caractère désuet des objets de cette collection, expliqua ce dernier, on pouvait difficilement les considérer comme du matériel de guerre ayant un quelconque intérêt militaire.
Grâce à la richesse du fond d’archives de l’Académie François Bourdon, nous disposons de renseignements sur les représentants allemands qui contrôlèrent les usines Schneider. Ces indications, réclamées en mai 1945 par la circonscription régionale de la direction des Industries mécaniques et électriques (DIME), furent rassemblées après la Libération dans le cadre des procès de l’épuration mais aussi de la politique de réparation des dommages de guerre[174]. Les documents fournissent à l’historien des données rares sur la formation professionnelle, le caractère et l’engagement politique des officiers affectés à la surveillance du groupe français. Ces portraits sont d’autant plus fidèles que l’ingénieur en chef Paul Delahousse, invité par « Monsieur S. » [Charles Schneider] à forcer le trait en ce qui concerne l’engagement nazi des membres de la mission, sans doute pour impressionner favorablement le juge d’instruction, tint toutefois à conserver son objectivité.
En plus de Nagel, le personnel civil de la mission allemande était composé des ingénieurs en chef Theodor Berkenkemper et Utsch, du fondé de pouvoir commercial Joseph Passau, de la secrétaire Molitor et du chauffeur Kötter[175].
Venu au Creusot en août 1940, le chef de la mission, Richard Nagel, chargé de la direction technique de toutes les usines du groupe Schneider, séjourna quelques mois en Saône-et-Loire, se fixa ensuite à Paris auprès du siège social, puis retourna à Düsseldorf, où il assuma les fonctions de directeur de l’usine métallurgique de Rheinmetall-Borsig. Dès lors, il ne fit plus que de brèves apparitions au Creusot. Nagel portait en permanence l’insigne à croix gammée. Il était considéré par les ingénieurs français comme un « métallurgiste distingué » et ceux-ci entretenaient avec lui des « relations assez correctes ». Il se montra certes plutôt « autoritaire », mais resta « toujours cantonné dans des questions strictement industrielles ».
Theodor Berkenkemper, venu au Creusot en même temps que Nagel, exerçait les fonctions de directeur de la mécanique à l’usine de Düsseldorf de Rheinmetall-Borsig. Il était également considéré dans les milieux français comme un « mécanicien distingué ». Plusieurs brevets de mécanique furent d’ailleurs enregistrés à son nom pendant la guerre[176]. Sur le plan politique, les notes de l’entreprise portent à son sujet la mention suivante :
« Nazi farouche [rayé au crayon, ndr] – A fait partie du putsch de Munich [ajout au crayon, ndr : Assez expansif, se vantait d’être un nazi de la première heure et d’avoir fait partie du putsch de Munich. Portait un insigne nazi numéroté].
« Etait fier de montrer une photo le représentant en compagnie d’Hitler.
« A quitté Le Creusot en 1941 pour rentrer à Düsseldorf[177]. »
Troisième membre de la mission civile, Josef Passau arriva au Creusot en même temps que Nagel, en provenance de Düsseldorf où il exerçait chez Rheinmetall-Borsig les fonctions de chef du bureau commercial « exportation-aciers ». Cet homme, qui n’était pas un technicien, s’exprimait parfaitement en français et parlait aussi l’anglais, ce qui n’avait rien de surprenant pour le représentant du service commercial d’une grande entreprise européenne. Il avait semble-t-il séjourné longtemps au Luxembourg et connu la France d’avant-guerre. Passau suivait Nagel dans ses déplacements et entretenait des « relations correctes » avec les Français bien qu’il portât lui aussi l’insigne nazi.
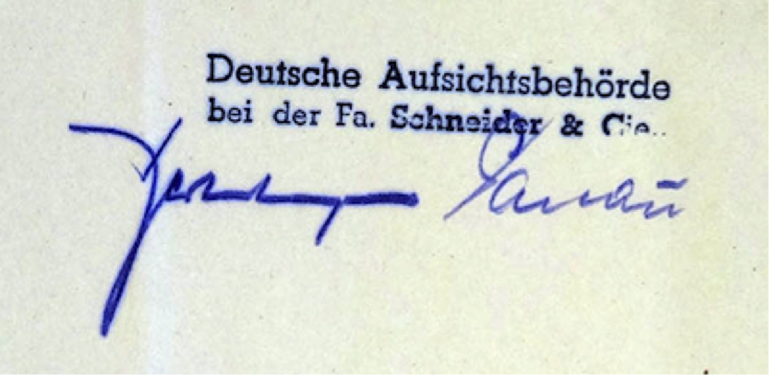
Extrait d’une note originale de la Mission de surveillance allemande de Schneider portant les signatures de Berkenkemper et Passau © Académie François Bourdon – Phot. Laurent Dingli
La mission était codirigée par le Generalmajor Ing. Robert Dietinger[178] en tant que « délégué industriel ». Arrivé au Creusot en août 1940, ce dernier y resta jusqu’au début de 1944. Colonel (Oberst) dans l’armée autrichienne, Robert Dietinger avait reçu les épaulettes de général au moment de son passage dans la Wehrmacht allemande après l’Anschluss. Les notes de Schneider précisent à son sujet :
« Militaire de carrière. Ingénieur diplômé. Habite Vienne – Son frère est professeur agrégé à l’université de cette ville.
« Personnage assez falot. Le zèle modéré qu’il déploie dans l’accomplissement de ses fonctions paraît surtout destiné à lui éviter des observations de la part de ses supérieurs.
« Relations très courtoises.
« Nous soupçonnons que certaines libérations de Français arrêtés par la Gestapo ont pu être dues à son intervention et qu’il a plutôt calmé certains de ses subordonnés.
« Ne paraissait pas avoir de convictions nazies.
« Ne parle pas français. »
Si Dietinger semblait plutôt modéré, tel n’était pas le cas de son gendre, le Sonderführer Max Rumpold, avec lequel Dietinger se brouilla en 1943 et dont nous reparlerons dans une prochaine publication.
Le contrôle de la SOMUA ne prit pas la forme qu’il eut auprès de Schneider, mais fut également exercé de manière très étroite, surtout à partir de septembre 1940. La direction de l’usine fut prise en main par un premier groupe de représentants de la société Henschel & Sohn de Cassel : le mandataire de l’Armée Ruge, l’agent administratif Heinz, le contremaître Fritz, les contrôleurs militaires Breitung et Bachmann, et quelques agents subalternes remplissant le rôle de vérificateurs. En septembre 1940, Heintz fut remplacé par Bernhuber. Condamné pour espionnage en 1936 par la France, ce dernier avait été libéré par l’avancée allemande de juin 1940. Le mois suivant, Ruge fut remplacé par von der Tann, qui arriva en compagnie de l’ingénieur Hess, chargé des questions techniques tandis que le contremaître Lingelbach prenait la place de Fritz[179].
Le personnel allemand installé dans l’usine de Saint-Ouen comprenait ainsi un mandataire de l’Armée, qui avait pleins pouvoirs pour assurer la production, et s’immisçait constamment dans le travail des ateliers ; plusieurs commissaires administratifs et techniques, chargés de l’approvisionnement des matières, éléments bruts et finis, nécessaires aux fabrications ; des ingénieurs et chefs de fabrication qui peuplaient constamment les ateliers, vérifiaient le rendement et examinaient la manière dont les services de la SOMUA résolvaient les problèmes de fabrication ; un et parfois deux contremaîtres contrôlaient les ouvriers et s’assuraient, en examinant les fiches de fabrication, que chacun d’eux travaillaient bien aux commandes allemandes ; des contrôleurs-vérificateurs inspectaient la qualité des pièces, leur emballage et leur expédition ; enfin une section d’infanterie, cantonnée dans l’usine, fournissait une garde armée permanente à l’intérieur des ateliers et dans les cours. Cette garde fut toutefois supprimée en mars 1942 lorsque la crise des effectifs se fit sentir en Allemagne[180]. Il faut encore mentionner les nombreuses visites effectuées par des officiels allemands et les mouchards qui renseignaient la police de Vichy, le SD et la Gestapo.
La société Le Matériel électrique SW bénéficia d’un régime très différent. Demeurant volontairement dans le flou à ce sujet devant le commissaire de police[181] et le juge d’instruction comme dans l’un des volumes de ses Mémoires, intitulé La Suite des temps, Pierre de Cossé-Brissac laissa penser que la direction n’avait fait qu’obtempérer à une coercition déjà en place. En réalité, l’usine de Champagne, qui dépendait de la Rü-In de Melun, ne reçut la visite d’une mission commerciale de Siemens que le 25 septembre 1940 et il ne fut nullement question alors de contrainte[182]. Le contrôle se resserra de manière lente et très progressive tout au long de l’Occupation, notamment sous la direction de von dem Knesebeck, qui avait été directeur de Siemens-France avant-guerre. Les ordonnances allemandes de saisie du siège et de l’usine de Champagne date du 16 mai 1941 et l’entreprise fut classée V-Betrieb, le 15 avril 1942[183]. Comme une partie du capital appartenait à la Westinghouse, un administrateur-séquestre des intérêts américains, Karl Herbst, fut nommé en juin 1942, remplacé par le baron von Falkenhausen, à partir du 16 octobre 1943, avec pouvoirs d’assister aux délibérations du conseil d’administration, de contrôler les actes administratifs et les décisions importantes, en jouissant d’un droit de veto. Siemens-France fut désignée « Patenfirma » (firme marraine) de SW le 8 octobre 1943 avec droit de contrôle de l’activité technique et commerciale. Enfin, en juin 1944, le droit d’embaucher ou de débaucher du personnel pour la fabrication des obus fut retiré à l’entreprise pour être confié à un ingénieur de la Rombacher Hüttenwerke[184].
Lorsque les premières commandes allemandes furent passées, en septembre 1940, la plupart de ces contraintes n’existaient pas. A en croire les témoignages de Pierre de Cossé-Brissac, les relations avec les représentants de Siemens furent d’ailleurs excellentes, d’autant plus que les dirigeants évoluaient dans le même monde, celui de la haute noblesse européenne dont une partie avait troqué l’épée pour l’industrie et le monde des affaires :

Pierre de Cossé, duc de Brissac, fut élu le 30 avril 1969 47è Grand Maître de l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem © Yonel
« Les Allemands avaient inventé d’accoler à chaque société française importante une firme allemande, la paten-firma, et l’idée, point déraisonnable en soi, me servit. Ma paten-firma était la société Siemens, fondée en 1847 par Werner von Siemens (1816-1892), en association avec Johann Halske (1814-1890), et qui était, comme nous, licenciée de la Westinghouse Electric américaine. Or le président de Siemens, M. von dem Knesebeck, était avant la guerre, le chef de Siemens-France – agence commerciale parisienne de Siemens-Berlin – et parlait parfaitement le français. Il était gentilhomme, et que l’on ne croit pas la remarque futile ou entachée de snobisme. La seule internationale qui ait jamais « marché » est celle des élites de naissance[185] (…) Mon Knesebeck était un « Herr von… » comme j’étais, moi, un « Monsieur de… », et pour ne pas être en reste avec mes quatre maréchaux de France, il me servait les colonels et généraux de sa famille dans l’armée de Frédéric de Prusse, lors de la guerre de Sept Ans (…)[186] »
La reprise était donc assurée, la mission de surveillance installée, les commissaires allemands nommés. Qu’allaient donc fabriquer les entreprises françaises ?
Les autorités françaises estimèrent très rapidement qu’il était indispensable d’assurer la reprise de l’industrie nationale afin de donner du travail aux chômeurs, de nourrir la population et de ne pas abandonner l’outil de production aux Allemands. A cet égard les consignes de Vichy furent toujours très claires. Dans une directive envoyée aux préfets le 24 juillet 1940, Léon Noël, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés (DGTO), alla même jusqu’à menacer les patrons récalcitrants de confisquer partiellement leur outil de production, ce que les Allemands eux-mêmes n’osèrent faire, à l’exception notable des biens juifs[187].
Littéralement débordée par les demandes des industriels, la délégation générale renvoya souvent ces derniers à leur chambre syndicale. Or les organisations patronales donnèrent à leurs membres des consignes similaires à celles du gouvernement : il fallait occuper le terrain. On peut lire ainsi dans le procès-verbal de la Chambre syndicale des Aciers fins spéciaux, à la date du 17 août 1940 :
« Les dirigeants doivent ”tenir”, s’accrocher à l’usine par tous les moyens, afin d’éviter la réquisition et le passage sous direction allemande.
« Si certains cadres sont remplacés par des cadres allemands, ils doivent rester sur place afin de garder le contact avec le personnel ouvrier et d’être prêts à intervenir si les circonstances nécessitent leur concours[188]. »
Une fois les usines ouvertes, qu’allait-on y fabriquer ? Dès les premières heures de l’Occupation, il était bien évident que les autorités allemandes n’allaient pas se contenter de laisser les usines françaises produire pour le marché civil et les impératifs de la reconstruction nationale. Parmi les fabrications exigées par l’Allemagne, celle du matériel de guerre se posa très rapidement. Quelles étaient les positions officielles à cet égard et qu’entendait-on précisément par matériel de guerre ?
Le 1er juillet 1940, en se référant à l’article 6 de la convention d’Armistice, la commission allemande (CAA) invitait le gouvernement français à lui soumettre d’urgence un projet de loi qui interdirait la fabrication des « matériels de guerre de toute sorte »[189]. Elle entendait par là « tous les matériels destinés à l’équipement, à l’armement et au ravitaillement de l’armée, à l’exception du ravitaillement en vivres, habillement et petit équipement individuel. » En fait, une disposition plus précise fut adoptée. On entendit par « matériel de guerre » tous moyens de combat prêts à l’emploi tenus à la disposition des forces armées.
Les services français rédigèrent alors un projet de loi portant interdiction de la fabrication de matériels de guerre. Pour éviter toute ambiguïté, une liste jointe énumérait les types de matériel et de pièces qui ne pouvaient être fabriqués sans une autorisation préalable. Un autre projet de loi prévoyait l’interdiction d’exportation, d’importation ou de transit, et un dernier texte portait sur la réglementation des produits chimiques. Les trois lois ne furent promulguées qu’après de très longues négociations, le 15 octobre 1940. Des dérogations pouvaient être accordées après accord des commissions d’Armistice. C’est dans ce but que fut créé au ministère de la Production industrielle, à la fin de l’année 1940, le Service des commandes étrangères de matériel de guerre (SCEMG) confié à l’ingénieur Jean Herck. Les Allemands avaient bien fait comprendre que, s’ils souhaitaient une loi, ils n’entendaient pas pour autant que celle-ci fît obstacle à leur pouvoir de décision. En d’autres termes le service de Jean Herck ne devait être qu’une chambre d’enregistrement.
En attendant ces clarifications tardives, les industriels ne pouvaient se fonder que sur les directives de la DGTO. Le 17 juillet, Léon Noël convoqua plusieurs constructeurs automobiles à l’hôtel Matignon et leur renouvela « les instructions de faire tourner les usines en acceptant les commandes allemandes, sauf pour les fabrications spéciales telles que : armes et chars, pour lesquelles il demandait qu’on lui en réfère spécialement.[190] »
Une note publiée le même jour précisait : « Dans les rapports avec les autorités allemandes, il ne faut pas perdre de vue que l’état de guerre subsiste et que toute tractation avec ces autorités prenant la forme d’un acte de commerce tombe sous la législation qui interdit le commerce avec une puissance ennemie. »
Dans la suite du document, la DGTO répondait aux cinq questions principales que les industriels étaient amenés à se poser :
« 1° – Quelle attitude prendre si les autorités allemandes demandent l’achèvement des commandes en cours d’exécution passées par les diverses administrations de la défense nationale ?
« Il faut demander préalablement l’autorisation aux administrations françaises intéressées et n’accepter d’exécuter sur ces commandes aucun travail sans avoir obtenu préalablement cette autorisation.
« 2° – Quelle attitude doit-on observer lorsque l’autorité allemande exige la livraison de matériels terminés et non encore livrés aux administrations françaises ?
« On ne peut s’y opposer, l’autorité allemande ayant droit de saisir ces matériels. Il y a lieu d’aviser immédiatement l’administration française intéressée.
« 3° – Doit-on se soumettre à l’obligation d’exécuter des réparations sur des matériels allemands pour le compte de l’autorité allemande ?
« Réponse affirmative.
« 4° – Doit-on prendre des commandes imposées par l’autorité allemande ?
« Il y a lieu d’obtenir préalablement un accord du gouvernement français, pour chaque cas particulier.
« 5° – Quelle attitude doit-on prendre lorsque l’autorité allemande demande des renseignements techniques sur les fabrications de matériel de guerre ou exige la remise d’une documentation qui est entre les mains de l’industriel ?
« Il y a lieu de répondre que ces renseignements sont secrets et ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation du gouvernement français (…)[191] »
Le 20 juillet, les dirigeants de Schneider mirent au courant l’ambassadeur Noël de la mission confiée à Richard Nagel. Comme d’autres industriels, ils voulurent savoir quelles étaient les limites légales et conventionnelles des prétentions allemandes. Quel type de commande pouvait-on accepter ? Fallait-il communiquer les plans des fabrications en cours, notamment lorsque ceux-ci pouvaient avoir des incidences sur le plan militaire, ainsi que le réclamaient les autorités d’occupation à la SOMUA[192] ? Le 23 juillet, ils reçurent la réponse suivante de Jacques Barnaud, membre de la commission d’Armistice :
« J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 20 juillet courant relative à la mission confiée au Creusot par l’autorité allemande au général Dietinger et à M. Nagel et de vos lettres des 18 et 19 juillet 1940, concernant les renseignements demandés à la société SOMUA à Saint-Ouen.
« Je tiens à préciser les points suivants :
« 1° – Aucune disposition de l’armistice n’autorise le gouvernement allemand à désigner le personnel dirigeant des usines et entreprises françaises des territoires occupés. Je suis décidé à protester toutes les fois que des abus précis, à ce sujet, me sont ou me seront signalés.
« J’admets, par conséquent que, jusqu’à nouvel ordre, les délégués allemands ne peuvent rechercher auprès de votre entreprise et de vos participations que des contacts et des renseignements et je vous prie de limiter à ce domaine les rapports que vous pourrez avoir avec eux.
« 2° – Les dispositions conjuguées de l’Armistice et des conventions de La Haye ne permettent pas à la puissance occupante d’utiliser l’industrie de la puissance occupée pour la fabrication de matériel de guerre proprement dit. En conséquence, des commandes de telle nature ne sauraient être acceptées par l’industrie française.
« Les commandes d’autres matériels ne sont pas actuellement interdites par le gouvernement français. Ce dernier envisage toutefois de les soumettre à une réglementation dont les éléments seront portés à la connaissance des chambres syndicales des différentes industries.
« 3° – Aucune disposition de l’Armistice n’autorise les autorités allemandes à obtenir des renseignements sur les procédés de fabrication des usines françaises. Il y a lieu de distinguer cependant celles des fabrications qui sont dans le domaine public et celles qui présentent, par opposition, un caractère confidentiel. Le gouvernement français n’a pas qualité pour vous interdire de donner des renseignements sur les premières fabrications ; en revanche, j’estime que pour les fabrications de guerre concernant le gouvernement français lui-même, la fourniture des renseignements ou la remise de documents ne saurait en aucun cas être admise sans l’accord préalable du ministère de la Défense nationale. Il y aurait lieu de refuser toute communication à ce sujet. [193]»
Enfin, le 30 juillet 1940, Léon Noël adressait aux groupements professionnels une note contenant des directives générales dont voici la conclusion :
« En aucun cas, un groupement ou un chef d’entreprise ne doit s’adresser directement à une autorité allemande sans avoir pris, préalablement, l’attache de l’autorité française qualifiée.
« Le gouvernement compte sur les organismes professionnels pour renseigner complètement et efficacement tous les intéressés qui, s’ils étaient obligés de s’adresser directement aux services publics, risqueraient de trouver ceux-ci débordés et donc impuissants[194]. »
Ces directives publiées à diverses reprises par le gouvernement français, les dirigeants de Schneider voulaient-ils ou pouvaient-ils les respecter ?
La remise en marche des usines soulevait de nombreuses difficultés dont l’une des plus aigües fut le manque de trésorerie. Suivant le témoignage postérieur d’Albert de Boissieu, chargé de la trésorerie et du rapport avec les banques, la société Schneider était débitrice d’environ 150 millions de francs au moment de l’Armistice. Ce n’est que plus tard, avec la liquidation des marchés de guerre passés au titre de la défense nationale française mais aussi grâce au paiement régulier des commandes allemandes par l’occupant, que la trésorerie de la société retrouva une véritable aisance[195]. Une note de la direction datée de 1946 précise encore :
« Après l’annulation des commandes de guerre (sous entendu pour la défense nationale française, ndr), les commandes en carnet ne permettaient d’utiliser qu’environ 2 500 ouvriers et employés et pendant quelques semaines seulement.
« La trésorerie était vide ; les banques fermées dans toute la région ; les sommes exigibles qui pouvaient être perçues immédiatement dans la zone non occupée ne s’élevaient qu’à quelques millions par mois, malgré la faiblesse des effectifs réintégrés et en ne payant aux employés qu’une fraction de leur traitement. Il fallut émettre des bons de caisse au Creusot et à Decize ; heureusement les commerçants de la région voulurent bien les accepter. Malgré cette émission, le déficit prévu pour fin juillet était de l’ordre de 14 millions.
« A Chalon, la situation était plus grave encore. Nos chantiers étaient fermés et nous n’avions que 140 000 francs en caisse[196]. »
Face à cette situation préoccupante, les dirigeants de Schneider tentèrent d’obtenir des commandes françaises. Dès leur retour d’exode, ils s’adressèrent tout naturellement à une entreprise avec laquelle ils avaient l’habitude de travailler : la SNCF. Début juillet 1940, André Vicaire et Henri Faucillon rencontrèrent à Paris des responsables de l’entreprise nationale dans le but d’obtenir des commandes de matériel civil. Mais la situation était alors particulièrement complexe. Certes, les dégâts causés par les combats du printemps et l’invasion laissaient espérer de nombreux chantiers de reconstruction. Schneider espérait donc fournir au plus vite des locomotives et des ponts de chemins de fer. Mais la SNCF se trouvait elle-même dans une situation difficile et ignorait encore largement quelles seraient les décisions prises à Wiesbaden ainsi que son propre programme de fabrication. Le 4 juillet, André Vicaire rencontra M. Poncet, directeur du service central du Matériel[197], pour les commandes de locomotives, et M. Lemaire, ingénieur en chef de la Voie, pour celles concernant les ouvrages d’art. De plus, le directeur-général de Schneider fit intervenir à Vichy le député-maire du Creusot, Victor Bataille, cousin de l’écrivain Georges Bataille, politicien anti-Front populaire et obligé de longue date des Schneider, qui avaient financé sa campagne de 1931[198]. Mais les résultats de toutes ces démarches se révélèrent médiocres et largement insuffisants pour faire tourner les usines. Seule une commande de 25 locomotives 121 P, réduite par la suite à 23 unités, fut obtenue. Quant aux ponts de chemins de fer, de longues études étaient nécessaires pour en effectuer la réparation[199].
Vers la mi-juillet, Richard Nagel fit d’ailleurs comprendre aux dirigeants de Schneider, qui tentaient encore d’obtenir des commandes françaises de matériel civil, que l’Allemagne était désormais prioritaire. Il en rendit compte en ces termes au comité de direction de son entreprise :
« La direction générale de Schneider (Paris, rue d’Anjou 42) Dir. Gén. Vicaire, s’efforce d’obtenir des commandes pour la France (cf. page 2). On a fait clairement comprendre au dir. gén. Vicaire, qui était aujourd’hui au Creusot, ainsi qu’à Messieurs Walckenaer et Stroh qu’en toutes circonstances les commandes allemandes ont la priorité. Une acceptation de commandes françaises n’est permise que dans le cas où le major général Dietinger et moi-même avons donné notre accord. Pour l’instant on ne doit pas s’attendre à des difficultés. Pour le cas où il devrait s’en produire, nous ferons prendre une ordonnance à cet effet par l’intermédiaire de l’Inspection de l’Armement ou du commandement militaire en France[200]. »
Ce diktat fut rappelé à la direction à plusieurs reprises. Celle-ci protesta vainement le 23 août dans les termes suivants : « Nous venons de prendre connaissance de la lettre que vous avez adressée le 20 août à notre usine du Creusot, et relative à la priorité à donner aux commandes allemandes (…) Nous ne pouvons nous déclarer d’accord (avec les) termes de cette lettre qui ne sont, d’ailleurs, pas conformes aux conclusions des entretiens qui s’étaient déroulés récemment sur cette question entre notre direction générale et la commission de contrôle[201]. » Il ne faudrait pas cependant forcer le trait comme le firent les dirigeants à la Libération car la réunion qui se déroula le 20 août au Creusot avec les membres de la mission allemande se fit sans heurts, les Français exprimant notamment le souhait que Chalon fût intégré dans la zone occupée par l’Allemagne (voir texte en annexe 2).

Atelier de fabrication des blindés dans la filiale Alkett Altmärkische Kettenwerke GmbH de la Rheinmetall à Berlin-Borsigwlade, 1942. – © Zentralarchiv der Rheinmetall AG – Cote B 324, F 44
Les archives militaires allemandes de Fribourg, le fonds de l’Académie François Bourdon ainsi que les archives nationales permettent de suivre quelques-unes des premières négociations menées à Paris, Berlin et au Creusot entre Schneider et les autorités d’occupation.
L’un des documents les plus importants sur le sujet est conservé à Fribourg. Il s’agit du compte rendu d’un appel téléphonique passé le 3 juillet 1940 à 10h 30 par l’Oberleutnant Gerhardi au Major Worm, appartenant au Détachement motorisé du renseignement aérien de l’Armée de Terre (Heer). Le document évoque en détail la première mission allemande qui visita Le Creusot, le 19 juin 1940, 24 heures seulement après l’arrivée des troupes d’occupation dans la ville. Ce texte, essentiel, contribue à remettre en cause un certain nombre de légendes et d’approximations forgées après la Libération. Lors de l’arrivée des Allemands, la priorité des dirigeants français – en l’occurrence du directeur de l’usine Henri Stroh – était d’assurer avec leur appui la remise en marche rapide de l’outil de production, de trouver de la trésorerie, de payer le personnel et d’obtenir des commandes. Dans ce but, Français et Allemands travaillèrent de concert afin de parer aux questions les plus urgentes comme le ravitaillement et les salaires. Voici le compte-rendu de cette première visite, avec le texte original en allemand pour certains passage-clés. On remarquera quelques erreurs d’appréciations, notamment sur le potentiel réel et le statut des usines du Havre :
« Le Major Worm fait un rapport de sa visite de la société Schneider & Cie au Creusot.
« Il existe quatre usines Schneider.
« Il n’y avait pas d’armes et de chars prêts à l’emploi.
« L’usine fabrique des plaques de blindage, des pièces brutes, des locomotives complètes, des pièces pour les canons de marine parmi les plus lourds. Elle a essayé de fabriquer des canons anti-aériens, mais ils ne sont pas terminés.
« Effectifs : 6 000. Le Creusot et ses environs comptent 44 000 habitants qui dépendent de l’usine. Le ravitaillement est assuré car un dépôt de ravitaillement, auquel la 12ème Armée n’a pas encore touché jusqu’à présent, est disponible.
« Le 19.06, une commission du Bureau de l’Armement était sur place, à savoir :
« – Major Vahrenhorst,
« – ingénieur Spielvogel,
« – ingénieur Elsenberg.
« Ces messieurs sont venus du Quartier-général et sont repartis à Berlin en avion.
« Selon une information émanant du Commissariat du port du Havre, le Major Worm affirme que l’usine principale se situe dans cette ville.
« Le directeur technique Stroh, qui parle l’allemand, reprendra le travail lundi prochain. Il exécutera dans un premier temps les commandes qui ont déjà été passées par le gouvernement français avant la guerre. Sont disponibles :
« – une installation électrique de 20 000 kW,
« – deux mines de charbon intactes sur la Loire,
« – et suffisamment de matières brutes.
« L’argent fait défaut. Il a en conséquence réclamé des secours d’urgence afin de pouvoir payer les arriérés de salaires des ouvriers. Stroh demande maintenant des commandes supplémentaires, de préférence des locomotives [Stroh bittet nun um zusätzliche Aufträge, möglichst Lokomotiven]. Capacité : 10 unités par mois.
« Il faut des commandes, soit de la France, soit de l’Allemagne (des commandes de réparations pour l’Allemagne ou pour la Pologne). La facturation pourra intervenir plus tard. [Benötigt werden Aufträge entweder von Frankreich oder Deutschland (für Deutschland oder Polen auf Reparation). Abrechnung kann später erfolgen].
« De plus, il (Stroh) peut vendre au gouvernement allemand des métaux précieux afin d’obtenir de l’argent (chrome-nickel, nickel, etc.) [Weiter kann er (Stroh) Edelmetalle an deutsche Regierung verkaufen, um Geld in die Hand zu bekommen (Chromnickel, Nickel usw)].
« Le plan de l’usine est conservé par le Major Worm.
« Commandes en cours : machines pour des turbines hydrauliques.
« Le travail doit reprendre bientôt car on ne travaille plus depuis le 19.06 et les gens attendent du travail.
« À l’occasion de la visite qui devrait avoir lieu prochainement, l’IV W[202] devrait tenter de rendre visite au préfet et, conjointement avec le directeur Stroh, s’adresser à l’IV A [Intendance] au sujet de l’affaire des moyens de secours financiers[203]. »
Les questions financières soulevées par Henri Stroh dès le 19 juin à ses interlocuteurs allemands trouvèrent une solution grâce à l’intervention de Richard Nagel ainsi que le directeur de la RMB en rendit compte à son comité de direction, un mois plus tard, les 18 et 19 juillet :
« A la suite de la visite faites par Messieurs Spielvogel et Elsenberg le 19.6.40, les 3 usines (…) ont encore travaillé quelques jours mais ont été ensuite arrêtées, pour mettre les choses en ordre, jusqu’au début juillet.
« Depuis ce moment-là 2 500 hommes travaillent et ce, de manière que la plupart d’entre eux est employé par roulement hebdomadaire de façon que, tout au moins les ouvriers mariés, ne se trouvent pas immédiatement dans la gêne. Grâce au déblocage d’avoir bancaires de la société, le règlement des salaires a été assuré jusqu’au début d’août. Grâce à ces dispositions 5 000 hommes environ dans l’ensemble peuvent gagner leur pain. L’approvisionnement en vivres marche bien maintenant dans l’ensemble, il n’est pas nécessaire d’intervenir. La fourniture d’énergie est assurée ; il y a du charbon pour 3 mois, de la ferraille pour 6 mois.
« D’après les déclarations de la direction de l’usine (Dir. Stroh) on peut assurer immédiatement au Creusot et dans la région 7 000 hommes
« Aux armées, il y en a 1 000
« En fuite ou renvoyés, qui reviennent 1 000
« Ces chiffres comportent environ 1 000 étrangers mariés ; les étrangers non mariés, principalement yougoslaves et luxembourgeois sont ou seront reconduits dans leur pays.
« La direction de l’usine ne voudrait pas renoncer aux étrangers précités (Russes et Polonais) dont la plupart sont employés dans l’usine depuis 15 à 20 ans, principalement dans l’exploitation à chaud et comme manœuvres. Mais ils ne sont pas encore occupés actuellement.
« Le personnel dirigeant, contremaître, etc. est là presque au complet[204]. »
La visite de Caesar von Hofacker et Alexander von Falkenhausen du 13 juillet 1940, mentionnée plus haut, s’inscrivait dans le cadre de la « mission Streccius » suivant la terminologie utilisée alors par les dirigeants de Schneider. D’après ces derniers, le général Streccius avait chargé le général Franz Barckhausen, de suivre personnellement le dossier Schneider. C’est dire, une fois encore, l’importance que revêtait la société aux yeux de l’occupant. Le compte rendu manuscrit de l’entretien indique que Français et Allemands cherchaient un compromis, les premiers pour sauvegarder l’un des plus prestigieux patrimoines industriels français, les seconds pour l’exploiter au plus vite dans le cadre de la lutte contre l’Angleterre. Avec l’assentiment du gouvernement français, on s’accorda sur un programme de fabrication où se mêlaient productions civiles nécessaires à la reconstruction de la France et éléments utiles à la Wehrmacht. Le 13 juillet, von Hofacker et von Falkenhausen proposèrent même adroitement aux dirigeants de Schneider d’intégrer les productions qui les intéressaient dans le programme d’outillage national mis sur pied par Vichy. La lecture des comptes rendus manuscrits des visites allemandes effectués au moment des faits par les dirigeants de l’entreprise ne donnent pas une impression de bras de fer et de résistance passive de la part de Schneider, mais plutôt celle d’une négociation courtoise où l’on tente, de part et d’autre, de trouver des points de convergence – négociation bien entendu asymétrique au cours de laquelle les Français agissaient sous l’effet d’une forte contrainte :
« Nous leur avons exposé notre programme actuel ferme », écrivirent les dirigeants de Schneider, sans doute Henri Stroh et François Walckenaer.
« Turbines hydrauliques de L’Aigle et Genissiat[205]
« Moteur (…) pour la Normande
« Machines d’extraction
« Produits métallurgiques
« Entretien de l’usine
« en outre les parties en discussion :
« Moteur du pétrolier 010
« Machines d’extraction (…)
« Locomotives pour la Reichsbahn
« Locomotives pour les chemins de fer français
« Éléments pour presses à forger Wagner (Dortmund)
« et ultérieurement
« Reconstitution de l’outillage national. Nous avons encore rappelé les demandes de la BAMAG. Nous avons insisté sur le rôle que les Chantiers de Chalon doivent remplir. D’après les derniers renseignements, ils seraient actuellement évacués par la Beutesammelstelle[206] mais M. Ducreux[207] n’est toujours pas autorisé à franchir la ligne de démarcation. Il nous est signalé que la ligne de démarcation sera un obstacle aux échanges ; il est nécessaire qu’en attendant le résultat des négociations en cours des autorisations provisoires soient données, non seulement en ce qui concerne Chalon mais pour toutes nos expéditions en zone occupée.
« Les deux officiers nous ont recommandé de faire inscrire dans le programme national les possibilités de l’usine du Creusot[208]. »
Les négociations se poursuivirent l’après-midi cette fois avec l’Oberstleutnant Shricker, représentant du Generalleutnant Hermann von Hanneken[209] sous-secrétaire d’État du ministère de l’Économie du Reich (RWM) :
« Il nous a indiqué que son ministre suivait, parallèlement à la mission Streccius, l’activité des usines et qu’il allait déléguer à cet effet un général accompagné de M. Nagel (ingénieur civil). En outre, la mission Streccius-Barckhausen doit venir examiner notre programme avec le concours de M. von Schmidt.
« Nous lui avons relaté les indications reçues le matin même ; il était bien d’accord de voir établir un programme français englobant les commandes déjà envisagées de l’industrie allemande, mais il nous a dit que si du disponible subsistait, l’économie allemande était disposée à l’absorber.
« Nous lui avons dit qu’il était trop tôt pour fixer ce disponible. »
Les dirigeants du Creusot nourrissaient apparemment quelques illusions sur leur marge de manœuvre et ces lignes ont certainement été écrites avant la mise au point de Nagel. Ils ajoutèrent que si les commandes françaises n’étaient pas suffisantes, des fabrications de moteurs, de turbine à vapeur et de machines d’extraction pour l’industrie chimique pourraient être envisagées.
« Ces possibilités pourraient tout à fait répondre à ce que l’on attend de nous.
« Il nous a été demandé si nous pourrions céder des machines-outils ; nous avons déjà établi à ce sujet la note dont copie ci-jointe. Nous poursuivons l’examen de la question. Nous pourrions proposer une partie des tours américains achetés en septembre ; il n’est pas certains qu’ils soient retenus. En tout cas, il serait nécessaire que nous sachions quelles machines sont recherchées par le gouvernement allemand[210]. »
Le Reich s’intéressait en effet de près au parc de machines-outils et aux possibilités de fabrication des entreprises françaises dont il avait rapidement commencé le recensement et parfois le pillage ou la réquisition, notamment dans les entreprises liées à Schneider (SOMUA à Saint-Ouen, De Dion Bouton à Paris et au Havre, Forges et chantiers de la Gironde à Bordeaux, SOM à Paris et Dijon). Les prospections furent souvent effectuées par des équipes composées de spécialistes du haut-commandement de l’Armée de terre (OKH), de la Marine (OKM) et de la société Krupp de Essen[211].
Des commissions régionales d’Armistice visitèrent les différentes usines de la zone sud, dont celles de la SOMUA (Périgueux et Vénissieux), ainsi que leurs fournisseurs et sous-traitants. Les Allemands réclamèrent à cette occasion l’inventaire des matériels en cours d’exécution, lors de la débâcle de juin, qui étaient stockés dans ces usines – c’était d’ailleurs la mission principale des commissions de contrôle d’Armistice[212]. Le site de Périgueux fut ainsi inspecté par celle de Toulouse en septembre 1940. D’après son directeur, l’usine de Lyon de Schneider-Westinghouse reçut deux fois la visite de la commission d’Armistice qui laissa toutefois les stocks en l’état [213].
L’enlèvement des machines-outils était un élément essentiel puisqu’il conditionnait l’avenir même des usines et de leur personnel. Il y avait un débat à ce sujet au sein des instances supérieures allemandes avant que la question ne fût momentanément tranchée par la décision de Hermann Göring du 14 août 1940 – le Reichsmarschall décidant d’utiliser le potentiel industriel de la France sur place, sous certaines conditions[214]. Dans ce contexte, les dirigeants de Schneider et les contrôleurs allemands avaient en quelque sorte un intérêt conservatoire commun : « L’enlèvement des machines-outils avant l’établissement du programme allemand de fabrication n’est pas défendable », écrivit Richard Nagel à son comité de direction les 18 et 19 juillet 1940. « L’Armement à Paris (Major général Schubert) et l’Armement à Dijon (actuellement encore Major v. Sybel) ont été mis au courant par moi à ce sujet, de même le Major général Dietinger et la direction des usines du Creusot[215]. »
Nagel fit donc comprendre aux dirigeants de Schneider que l’Allemagne avait désormais la priorité absolue. Dans son compte rendu des 18 et 19 juillet, le directeur de RMB détailla la plupart des fabrications qui était en cours d’achèvement au Creusot en juin 1940, ainsi que le programme de commandes françaises et allemandes. Sans surprise, la Rheinmetall-Borsig s’y taillait la part du lion, que ce soit pour ses usines de Düsseldorf, de Berlin-Tegel ou pour sa filiale, l’Hydraulik-Tegel, même si une part non négligeable était faite aux autres souscripteurs, Wagner (presses hydrauliques), BAMAG (fonte résistante aux acides) ou RZA (locomotives). Toutes les entreprises travaillaient bien entendu pour la Wehrmacht, mais l’esprit de concurrence entre sociétés allemandes n’avait pas disparu et le 9 août, la direction Exploitation « S » de la RMB demanda à Nagel de traiter les commandes de l’entreprise « par priorité[216] ». L’inquiétude de Nagel ne manquait pas de fondement. En effet, le ministère de l’Air allemand (RLM) venait de décider que la fabrication de machines-outils du Creusot lui serait réservée. A cette époque, un fonctionnaire du RLM se trouvait déjà sur place afin de faire transférer les commandes de matériel roulant souscrites par différentes firmes à la fabrication d’outillage. On se rappellera toutefois que la société Rheinmetall-Borsig était elle-même contrôlée par le groupe Göring.
Le comité de direction de la RMB travaillait en étroite collaboration avec le Bureau de l’Économie et de l’Armement (Wi Rü Stab). De retour à Düsseldorf le 21 juillet, Nagel avait d’ailleurs prévu d’assister à une réunion avec ce service, une seconde avec son propre comité de direction et une troisième avec les « services militaires RZA » de la ville.

Photographie prise pendant le cinquantenaire de Rheinmetall en avril 1939 – Düsseldorf © usmbooks.com
Le programme pour RMB et Hydraulik-Tegel comprenait toutes sortes de production, de l’acier spécial ou moulé, des matières laminées, des pièces de forge en tous genres, des presses hydrauliques, des bouteilles à air comprimé, ou encore des tubes de pièces et plaques de fondation pour l’allié soviétique… « L’état ci-dessus n’épuise pas les possibilités en ce qui nous concerne, déclara Nagel, Le Creusot peut venir au secours presque dans tous les domaines où il y a chez Rh-Bo (Rheinmetall-Borsig, ndr) de l’embouteillage. »
En fait le calcul de la rentabilité était simple et s’imposait de manière impérative, aussi bien aux Allemands qu’aux Français :
« L’usine a besoin, pour occuper 6 800 ouvriers, 60 000 heures à la tâche par mois et 1 200 employés – ce qui est considéré par la direction de l’usine comme l’extrême limite au-dessous de laquelle la rentabilité cesse –, d’un montant de commandes de 700 à 800 millions de francs sur lesquels environ 10 à 15 % existent actuellement. Les demandes énoncées page 2 (i. e. le programme des commandes, ndr) ont une valeur de :
« a) France : 150 à 200 millions de francs
« b) Pour l’Allemagne : 200 à 250 millions ” ”
« Si donc Rh-Bo veut encore participer avec des délais favorables, en dehors des commandes préparées par les services de l’armée allemande et même avec ajournement de l’exécution des commandes françaises éventuelles, à des commandes, la plus grande hâte est recommandée dans la préparation de ces commandes[217]. »
On trouve la même tonalité, mais pour des raisons diamétralement différentes, dans un courrier interne envoyé par Henri Stroh à François Walckenaer le 30 juillet 1940. La crainte de voir développer encore davantage le contrôle déjà très étroit des Allemands sur l’entreprise et d’assister au pillage des machines les plus modernes fit, côté français, l’effet d’un véritable aiguillon en matière de production et de collaboration :
« Référence : note du 30-7.
« M. Nagel est parti aujourd’hui pour Paris et doit vous rencontrer. Son action s’est bornée à nous remettre des demandes de prix très abondantes en pièces détachées pour machines mécaniques et hydrauliques, corps creux, barres d’aciers de diverses qualités, etc. Nous vous adresserons les éléments de réponse à mesure de leur réunion.
« M. Nagel désirerait entrer en possession de nos propositions le plus tôt possible ; il a reconnu que dans un avenir rapproché, il serait commode que son bureau principal fût fixé à Paris[218]. Néanmoins, il nous a demandé de vérifier quel serait, après confirmation des commandes en cours, l’engagement de vos usines tant au point du personnel que des moyens matériels. Sans exclure absolument cette hypothèse, je ne pense pas qu’il ait en vue l’envoi de personnel de renfort, mais nous devrons certainement chercher à tirer le meilleur parti de nos moyens et c’est aussi notre intérêt.
« Par contre, il nous a nettement indiqué qu’il s’occuperait de nous aider dans nos approvisionnements de matières premières et il est à craindre qu’il ne fasse réquisitionner certaines machines neuves si elles sont mal employées.
« Vous estimerez certainement comme moi qu’il faut l’encourager à se fixer à Paris…[219] »
On retrouve le même état d’esprit dans une note du 10 août 1940 probablement rédigée par François Walckenaer. Le texte illustre parfaitement le véritable jeu d’équilibriste, pour ne pas dire le tour de force auquel étaient astreints les industriels français :
« Demande de la Mission allemande
« Nous transmettons ci-joint une demande de la mission technique au Creusot concernant la situation de nos engagements.
« Nous ne nous attarderons pas à la discussion des droits de la mission pour envisager avant tout la situation de fait.
« La mission considère comme son devoir de placer des commandes au Creusot. Nous vous avons transmis les éléments de réponse pour le tiers des demandes reçues (70 environ) ; nous ne pensons décliner qu’une très faible partie du total. Enfin nous aurons soin de favoriser les demandes du groupe Rheinmetall-Borsig (Hasenclever, Hydraulik). Nous pensons donc que nous sommes en voie de donner satisfaction. Si aux affaires en étude nous ajoutons celles déjà acquises (Reichsbahn, Wagner) la moitié environ de la production du Creusot sera consacrée au Reich.
« C’est cette situation qu’il faut faire constater au plus tôt à la mission, de manière qu’elle puisse éviter des marques d’impatience de Berlin. Cette impatience pourrait se traduire par l’envoi d’agents de contrôle affectés à chacun de nos services, ce qui serait une servitude autrement plus grave.
« Nous pensons donc que nous pourrions montrer à la mission les documents que possèdent nos services commerciaux, documents qui sont pour la plupart annexés au rapport mensuel.
« Nous mettrions en évidence que tant que tout le personnel mobilisé, prisonnier ou absent, ne sera pas rentré, nous ne pourrons arriver à employer au mieux nos moyens.
« Il restera toujours qu’au total le personnel est insuffisant pour l’utilisation complète des appareils de l’usine ; mais par contre les approvisionnements n’étant pas assurés d’une manière certaine, il serait imprudent d’envisager un accroissement massif. M. Nagel a déjà paru admettre ce point de vue et a aussi reconnu le caractère spécial de notre industrie placée au milieu d’une région agricole qu’il importe de ne pas priver de ses cultivateurs.
« La présence de 2 à 3 000 hommes de troupe au Creusot est aussi une cause de gêne à divers points de vue ; il sera utile de faire réduire les effectifs dans la mesure du possible…[220]»
Non seulement les Allemands ne souhaitaient pas à cette date réquisitionner la main-d’œuvre, comme le feront croire les dirigeants français à la Libération, mais ils cherchèrent même à augmenter les effectifs de l’usine. Robert Dietinger demanda ainsi à Berlin de libérer les prisonniers français appartenant à l’entreprise[221] – régime de faveur que n’obtiendront pas d’autres sociétés travaillant pour la Wehrmacht, notamment Peugeot, malgré de multiples sollicitations adressées aux services allemands tout au long de l’Occupation. Lorsqu’il visita les usines du Creusot le 6 août pour y négocier une commande, le Dr Hentschel, directeur-général de la société Schloemann de Düsseldorf, proposa même d’envoyer d’Allemagne des ouvriers professionnels[222].
Les craintes d’un enlèvement des machines étaient alors la question d’actualité et la stratégie patronale visant à « occuper le terrain » permit, notamment en septembre 1940, de justifier l’emploi des tours que les Allemands projetaient alors de saisir dans les ateliers du Creusot[223].
Le 19 août encore, Henri Stroh tenta d’activer la mise en route des commandes destinées à la Reichsbahn. Il écrivit ainsi au capitaine Hartmann du RZA :
« Monsieur,
« Comme suite à notre lettre du 10 août, nous nous permettons de vous donner les deux informations ci-après :
« 1° – Nous avons le plus grand besoin de recevoir les plans des locomotives dont la construction doit être faite au Creusot ; leur envoi est tout à fait nécessaire pour la mise en train des fabrications.
« 2° – Nous verrions intérêt à étendre la mission de nos ingénieurs, et surtout celle de MM. Genty et Feuillant, à des usines autres que la maison Schwartzkopff. En particulier il serait utile qu’ils visitent les ateliers fabriquant les trains de roues en série et également ceux qui construisent les autres parties que Schwartzkopff fait venir de l’extérieur et que nous aurons nous-mêmes à construire dans nos ateliers.
« Veuillez agréer (…) »[224].
Il eût été intéressant de connaître la position du conseil d’administration sur les commandes allemandes à la fin du mois d’août 1940, mais l’expert Caujolle et le commissaire de police constatèrent, lors de leur perquisition rue d’Anjou, que la chemise censée contenir le procès-verbal était vide.
Suivant les déclarations faites à la Libération par les dirigeants de Schneider, la société n’aurait fait que réagir à la pression constante exercée par les autorités d’occupation et se serait contentée, lors de la reprise, de chercher exclusivement des commandes de matériel civil[225]. Ces déclarations furent reprises par l’expert du tribunal Paul Caujolle, le juge d’instruction et le commissaire du gouvernement – qui ne disposaient pas sur ce point de suffisamment d’éléments contradictoires – puis par des historiens et une partie de la presse française. Les archives militaires allemandes présentent une réalité très différente.
En effet, d’après le journal de guerre de la Rü-In, daté de la première semaine de juillet 1940, André Vicaire, qui était alors le seul représentant de l’entreprise présent à Paris, se montra complaisant à l’égard des demandes de l’occupant :
« Les entretiens avec le directeur-général de la société Schneider-Creusot, Monsieur Vicaire, étaient au premier plan. D’une manière générale, ces entretiens se sont déroulés d’une façon très prometteuse. Monsieur Vicaire s’est montré accessible aux souhaits allemands »[226].
A la Libération, le directeur-général déclara avoir refusé un financement proposé par les autorités d’occupation pour les commandes de matériel ferroviaire. Mais André Vicaire omit de préciser qu’il avait lui-même, le premier, fait part aux autorités d’occupation des difficultés financières liées à ces commandes, et non l’inverse :
« Le directeur général Vicaire (Schneider – Le Creusot) s’est à nouveau présenté [9 juillet 1940, ndr]. Il nous informe que ses revendications envers l’État français sont si importantes qu’il pourrait ne pas être en mesure de financer lui-même d’éventuelles commandes de locomotives[227]. »
Le Journal de guerre de la Rü-In précise encore à la date du 5 août au sujet d’une autre commande :
« Le directeur Beckhäuser de la société Wagner[228] de Dortmund nous informe ce jour qu’il s’apprête à conclure un contrat avec Schneider-Le Creusot pour la production de pièces pressées lourdes destinées à des bombes lourdes d’aviation.
« Malgré le fait qu’un spécialiste considérerait sans conteste ces commandes comme un contrat d’armement, le directeur Vicaire de Schneider-Le Creusot n’a pas d’états d’âme pour l’acceptation de ce contrat.
« Ce qui semble déterminant pour le directeur Vicaire, c’est que ce contrat d’armement ne soit pas identifiable en tant que tel par la majorité de son personnel [souligné par nous].[229] »
La réalité allait dépasser les espérances exprimées en juillet 1940 par le directeur-général car, après la Libération, ni la police, ni le juge, ni l’expert, n’identifièrent cette commande comme ayant un caractère militaire. [229 bis] En fait, il ne s’agissait pas de bombes destinées à l’aviation mais de presses hydrauliques servant à produire des obus lourds pour la Kriegsmarine. C’est pour cette raison que le capitaine de frégate Bach et la « mission Schubert » se déplacèrent au Creusot dès le 10 juillet. A aucun moment, les dirigeants de Schneider n’ignorèrent l’utilisation et la destination de ces presses lourdes[230].
Nous avons retrouvé le compte rendu des négociations commerciales qui eurent lieu le 5 août 1940 à Paris entre MM. Bekhaüser et Gaidetzka de la société Wagner de Dortmund d’une part, et les représentants de Schneider, Eugène Dequincey[231], responsable des ateliers au Creusot, et Abel Borel, chef des Affaires commerciales, division de la Mécanique – matériel fixe, d’autre part. Allemands et Français n’épiloguaient pas alors sur la nature militaire de cette commande mais se demandaient comment intégrer l’échelle mobile des salaires et des matières premières, clause qui figurait dans les contrats français type depuis une quinzaine d’années. Ils se préoccupaient surtout de hâter au maximum la production et la livraison. Le compte rendu est de Beckhaüser lui-même :
« Lors des tractations intervenues on a pris pour base (…) les offres préparées par la firme Schneider à la date du 1.8.
« Après avoir discuté à fond chaque poste, pris séparément, des 4 offres, il a été établi que la maison Schneider devait entreprendre immédiatement les travaux (…) » Et comme la matière première est disponible, « le travail préparatoire peut être commencé immédiatement dans les ateliers du Creusot. A cet effet, il a été remis à M. Dequincey un deuxième jeu de dessins (le 1er se trouvait déjà en possession de la maison Schneider, Le Creusot). Mais en outre, M. Dequincey a demandé qu’on lui envoyât par les voies les plus rapides [souligné dans le texte, ndr] un autre jeu de calques bruns avec la traduction française correspondante afin qu’il fût en mesure de confectionner immédiatement pour les différents ateliers, pris isolément, le nombre d’exemplaires nécessaires.
« Il fut en outre convenu que de notre côté, également, les pièces déjà brutes de forge ou de fonderie, dont la firme Schneider a pris en charge l’usinage, devraient être mises en route par retour afin que là, également, il n’intervienne aucun retard.
« Avant tout nous avons établi à la firme Schneider, sur notre papier à lettres, une lettre de commande sur place conçue en termes généraux de laquelle il résulte que nous sommes en principe tombés d’accord sur tous les points. Seulement, en ce qui concerne l’établissement des prix, nous avons fait cette réserve que nous ne reconnaissons à la maison Schneider la clause d’échelle mobile demandée par elle, que sous la condition qu’il ne serait pas soulevé d’objections par le service allemand du Reich compétent (…)
« Pour l’établissement de notre lettre de confirmation de commande, ces Messieurs de chez Schneider nous ont demandé d’employer un formulaire déterminé afin que, dans toute la mesure possible, il n’y ait pas de temps perdu inutilement pour la préparation intérieure dans les bureaux de la firme Schneider (…)
« Afin qu’aucun retard ne se produise dans l’envoi des pièces à livrer par nous à la maison Schneider et, inversement, dans celui des pièces que la maison Schneider doit nous expédier, il a été convenu que toutes les expéditions provenant d’Allemagne seront convoyées jusqu’à la frontière allemande par un de ses délégués et, là, un délégué de notre firme prendra en charge l’expédition.
« Comme les Messieurs compétents de la firme Schneider craignent que les expéditions ne soient soumises sur les voies françaises à de grands préjudices, attendu que jusqu’à présent les biens relevant de l’économie ne sont transportés que lentement, il serait désirable que l’Inspection de l’Armement de Paris ou Dijon accordât à cet effet l’appui nécessaire (…)[232].
La prise de commande officieuse de commande à caractère militaire ne posait alors aucun problème aux dirigeants de l’entreprise puisqu’ils suggéraient de faire intervenir les autorités allemandes pour en activer la production.
Le rapport du 1er août de la Rü-In France concernant Eugène Schneider stipulait déjà :
« Le directeur d’entreprise Monsieur Schneider de la société Schneider-Le Creusot a fait part à la Rü-In de son obligeance pour travailler avec l’Allemagne dans l’intérêt des 11 000 anciens employés faisant partie de son personnel.
« Monsieur Schneider attache la plus grande importance aux commandes de locomotives. Il a déjà accepté la commande de 50 locomotives allemandes et de 28 locomotives françaises.
« Pour les commandes de matériels de guerre, il demande que les oppositions et les résistances soient balayées par l’intermédiaire du gouvernement français.
« Il prétend disposer de suffisamment de charbon, de ferraille et de fer pour produire en continu.[233] »
Les autorités d’occupation étaient tellement satisfaites de la collaboration de Schneider que, dès août 1940, elles organisèrent une réunion avec des industriels allemands pour la célébrer à l’hôtel Ritz, sorte de préfiguration de ce qui deviendra un an plus tard, les célèbres déjeuners de la Table ronde :
« Sur la proposition de la Rü-In et en présence du Chef de l’Administration des Armées et de quelques dirigeants d’entreprises allemands, une rencontre a eu lieu en soirée à l’hôtel Ritz. Monsieur Schneider du Creusot et son directeur général Vicaire avaient également été invités. L’invitation a été adressée à ces derniers dans le but de récompenser la société Schneider qui s’est révélée depuis l’armistice comme la plus loyale parmi les sociétés françaises déterminantes[234]. »
Et le 24 août, les Allemands constatèrent que les « relations avec la société Schneider – Paris et Le Creusot – se développent tellement bien que le gendre de Schneider [Pierre de Cossé, duc de Brissac, ndr] a été libéré » et « placé en tant que directeur de la société Le Matériel électrique » à Champagne-sur-Seine qui travaille pour la Wehrmacht »[235].
On ne peut donc pas affirmer comme Agnès D’Angio qu’à partir de juillet 1940, le « rôle de la direction générale [de Schneider, ndr] se borne désormais à prêter son concours administratif pour servir d’intermédiaire entre la mission [de surveillance allemande, ndr] et le personnel. » En fait l’archiviste et historienne reprenait, probablement sans le savoir, les termes d’une note de la direction de Schneider remise par André Vicaire lui-même au commissaire Perez y Jorba, en juin 1946[236] ! Il est intéressant de constater à cet égard que l’expert Paul Caujolle modifia sensiblement son point de vue après avoir entendu les principaux dirigeants de l’entreprise. Dans une première note rédigée le 12 avril 1946, il commentait en effet bien plus sévèrement la correspondance commerciale franco-allemande du mois d’août 1940 :
« Il appert, toutefois, que la collaboration voulue par l’Allemagne n’a eu besoin pour s’exercer d’aucune contrainte. Schneider semble n’avoir manifesté absolument aucune opposition. Les propositions de commandes faites par les Allemands ont été traitées et débattues de gré à gré, les discussions portant uniquement sur des questions de prix et de délais, sans avoir besoin d’être imposées. La base est purement commerciale. Schneider apparaît vis-à-vis des Allemands dans l’attitude d’un fournisseur vis-à-vis d’un client qu’il serait intéressé à satisfaire[237]. »
Si la pression pesant sur la société est un fait indubitable, si elle s’est exercée de manière encore plus étroite que sur d’autres grandes entreprises de la métallurgie, la direction de Schneider fut loin d’être une simple courroie de transmission au début de l’Occupation. Bien que ses intentions fussent connues pour l’essentiel dès la mi-juillet, la Mission de surveillance allemande ne s’installa au Creusot que le 30 juillet 1940, soit trois semaines après les premières négociations menées directement à Paris par André Vicaire. Même après son installation, le gérant, Eugène Schneider, fit preuve d’un zèle singulier allant jusqu’à demander à l’occupant de faire pression sur le gouvernement de Vichy qui n’était pourtant pas, à cette époque déjà – c’est-à-dire avant Montoire –, un modèle de résistance.
En réalité, certains membres de la direction Schneider eurent un double discours au début de l’Occupation. Alors qu’ils informaient le gouvernement français de la mission Nagel et demandaient des consignes sur les fabrications de matériel de guerre comme le laisse supposer la réponse de Jacques Barnaud -, André Vicaire et Eugène Schneider pressaient officieusement et très discrètement les Allemands de balayer les obstacles qui pouvaient entraver ces mêmes fabrications[238].
En assurant la reprise de sociétés spécialisées dans le matériel blindé, l’optique militaire[239] ou l’équipement électrique de chars et de sous-marins, ne courait-on pas le risque de mettre des productions sensibles et un véritable savoir-faire technique de pointe au service de l’ennemi ? La réponse des dirigeants du groupe fut celle de l’extrême majorité des industriels français à la Libération. Un refus, expliquèrent ceux de la SOM, « risquait de provoquer la nomination d’un commissaire allemand et même la disparition de l’affaire[240]. » Pierre de Cossé-Brissac déclara le 22 décembre 1945, lors de sa première comparution devant le juge Jean Drapier : « Notre but à tous était d’éviter la mainmise allemande sur l’affaire et de défendre nos ouvriers[241]. » Pour Jean Pérony, directeur-général de la SOMUA, la société se trouvait devant « un véritable dilemme : accepter de travailler pour l’ennemi ou risquer par un refus de voir l’outillage expédié en Allemagne et le personnel déporté ou réduit au chômage. » La direction de la SOMUA écrivit ailleurs : « Devions-nous supporter cette situation (la mainmise de l’occupant, ndr) ou abandonner nos usines aux Allemands ? Cruel dilemme. Cependant, il est apparu alors, sans conteste, que, de ces deux alternatives, également désastreuses pour les Français, la première représentait le moindre mal pour notre pays et notre personnel[242]. »
Dans une note, datée du 16 avril 1949 et destinée à répondre aux allégations de l’expert judiciaire, Pierre de Cossé-Brissac insista au nom de la SW sur la nécessité d’employer la main-d’œuvre qui s’était retrouvée au chômage après l’exode et l’Armistice :
« L’usine de Champagne, qui occupait en temps de paix 1 100 à 1 200 personnes, dont l’effectif avait atteint, en mai 1940, plus de 1 500 ouvriers (…) voyait ce personnel refluer rapidement ; au 22 juillet, 700 personnes s’étaient inscrites pour reprendre le travail. Il fallait leur fournir les moyens de vivre ; il fallait également éviter la mainmise des Allemands sur les ateliers[243]. »
Le dirigeant de la SW s’insurgeait plus précisément contre un passage du rapport d’expertise dans lequel Robert Israël affirmait que les questions de réquisition de main-d’œuvre ne se posaient pas à l’été 1940 :
« Il apparaitrait ainsi que les autorités occupantes se seraient adressées d’elles-mêmes à la société Le Matériel électrique SW dans le but de placer chez elle des commandes, sans que celle-ci soit intervenue pour provoquer un tel état de fait.
« Néanmoins, il semblerait que la direction de la société aurait accueilli avec un certain intérêt ces sollicitations. Elle aurait alors considéré que l’obtention de commandes directes pour l’économie allemande pouvait, dans une certaine mesure, résoudre les difficultés rencontrées par l’usine de Champagne-sur-Seine, notamment dans le domaine de l’approvisionnement en matières premières, du fait que les commandes allemandes étaient assorties de bons d’attribution prioritaires en matières « rares » (telles cuivre, zinc, et en général métaux non ferreux) ; c’est ce qui ressort notamment du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 9 octobre 1940 (…)
« Il convient de rappeler ici que la position prise par la direction de la société sur cette question ne peut se justifier par le souci d’éviter des réquisitions de personnel dans l’usine de Champagne, cette menace étant totalement inexistante à cette époque[244]. »
Réagissant aux affirmations de l’expert, Pierre de Cossé-Brissac fit état d’une prétendue politique de refus qui aurait été alors opposée aux autorités allemandes :
« Dès les derniers jours de juin, les autorités allemandes voulurent imposer à MM. Schneider & Cie l’exécution de commandes d’ordre militaire ; sur refus de MM. Schneider, ils menacèrent du démantèlement des usines et du transfert du personnel en Allemagne. (Le général von [sic] Schubert avait dit que l’Allemagne manquait d’ouvriers). Il fut précisé qu’il ne s’agissait pas seulement d’une menace mais que des sanctions analogues avaient déjà été mises en exécution[245]. »
Toutes ces affirmations étaient le fruit d’une reconstruction opportune des faits. La SW insista d’ailleurs auprès de Schneider fin 1940 pour obtenir la rétrocession d’une commande de boggies de tenders destinée à la Reichsbahn qui, « sans permettre l’utilisation de tous les ateliers, constatait le conseil d’administration, fournirait néanmoins une amélioration sensible à la situation de l’usine de Champagne[246]. » Elle obtint rapidement satisfaction et les deux commandes d’un montant total de 7 millions de francs, passées les 27 novembre et 11 décembre 1940, furent intégralement livrées. SW insista également auprès de la SOMUA pour obtenir des commandes de moteurs dont elle fit hâter la fabrication.
C’est André Vicaire lui-même qui prit la décision d’ouvrir les ateliers de la SOM au début de l’Occupation. Le directeur-général de Schneider modifia sensiblement sa version des faits entre sa première déposition effectuée devant la police judiciaire, et la déclaration faite à l’expert du tribunal Bernard Fougeray. Le juge Marcel Martin lui demanda des éclaircissements sur ce point le 2 juin 1945 :
« Je vous donne connaissance du rapport de l’expert. Je vous fais remarquer que, d’après les déclarations que vous lui avez faites et celles de M. Castellani, lors du retour de ce dernier (à Paris, ndr), lorsqu’il alla vous voir, vous lui avez donné comme instructions de reprendre le travail, sans pour cela lui dire d’accepter des commandes allemandes et de reprendre les fabrications pour le compte des autorités allemandes. Cependant, lorsque vous aviez été entendu, ainsi que Castellani, par la police, vous aviez déclaré que vous lui aviez donné le conseil de travailler pour les Allemands, mais en réduisant la production au strict minimum. Castellani a précisé que vous lui aviez dit d’exécuter les instructions des Allemands, car il n’y avait pas moyen de faire autrement. Quelles instructions lui avez-vous donné exactement ? »
Voici la réponse d’André Vicaire :
« Ce ne sont pas à proprement parler des instructions que je lui ai données, mais des conseils. Je lui ai dit qu’il fallait reprendre l’activité des ateliers car, sans cela, les Allemands allaient s’en emparer et les remettre en route eux-mêmes. Je ne lui ai certainement pas dit d’exécuter les instructions des autorités d’occupation et je ne crois pas lui avoir dit d’accepter des commandes allemandes. La question ne devait pas encore se poser de façon précise à cette date. »
La première version donnée à la police judiciaire par André Vicaire est certainement plus proche de la vérité que la seconde.
D’après l’ingénieur Étienne Verheyden-Chaine, qui avait été sous-directeur de l’usine de Champagne-sur-Seine pendant l’Occupation, il y aurait même eu une sorte de politique de résistance passive opposée aux Allemands. C’est du moins ce qu’il affirma au juge Nicolas de Villedary, le 20 mai 1949 :
« Au début de l’Occupation, alors que nous n’avions pas encore repris le contact avec notre direction, j’ai été à Paris trouver M. Vicaire, de la société Schneider. Je lui ai demandé comment et jusqu’à quel point il fallait pousser l’opposition aux Allemands. Il m’a répondu qu’il fallait la conduire le plus loin possible, jusqu’à la limite où nous risquerions une occupation allemande de l’usine. Par la suite, ces mêmes instructions ont été confirmées par M. de Beaumarchais (…)[247] »
Les dirigeants de Schneider prétendirent également que l’éviction par les Allemands du directeur provisoire de la SOMUA donna corps aux menaces de dépossession qu’auraient brandies les autorités d’occupation :
« D’autre part, dès la fin de juin 1940, le directeur intérimaire de la SOMUA avait été expulsé de l’usine de Saint-Ouen de cette société parce qu’il avait refusé de réparer des chars d’assaut allemands. Il avait été remplacé par un commissaire allemand qui, jusqu’à la fin de l’Occupation, contrôla le directeur quand celui-ci put reprendre sa place[248]. »
Là encore, l’affirmation n’est fondée sur aucun document contemporain des événements. Pas la moindre source allemande connue n’évoque l’expulsion d’un directeur provisoire de la SOMUA, société dont les services de la Rüstung notaient au contraire qu’elle était, avec Hotchkiss, l’une des premières entreprises de matériel blindé française à céder à leurs exigences, contrairement à Panhard et Renault.
L’Union industrielle et financière, qui devint officiellement une banque le 23 octobre 1943[249], vendit aux Allemands les parts qu’elle possédait dans les entreprises d’Europe centrale à un prix tout à fait respectable comme ce fut le cas de son ancienne partenaire, la Banque de l’Union parisienne. Le produit de la vente des titres Skoda fut encaissé le 31 janvier 1939 par Schneider. Les établissements qui appartenaient à la Société tchécoslovaque des « Mines et Forges », passèrent en octobre 1939 sous la souveraineté polonaise, ce qui aboutit à la création en juin 1939 de la Société de mines et forges de Karwina-Trzyniec[250]. L’entreprise française fut approchée à la fin de l’année 1940 par la Bömische Union Bank de Prague, en vue de la cession des parts de la société polonaise. Les conditions offertes à l’UEIF lui permirent de rapatrier le montant des divers avoirs en couronnes tchécoslovaques qu’elle possédait encore en dépôt dans des banques ou des sociétés à Prague. Le produit de la vente fut encaissé en décembre 1940. Toutes ces négociations furent menées en liaison avec les services du ministère des Finances, et conclues après accord du gouvernement français.
L’UEIF fut également amenée à céder ses participations dans la Banque générale de crédit hongrois à Budapest – dont une partie des parts appartenant à Rothschild et Cie[251], ce qui entraîna un bénéfice d’environ 30 millions de francs tandis que la cession des parts de la société tchèque Banska A Hutni (qui allait redevenir la Berg-und Hüttenwerke AG) rapporta environ 205 millions de francs de bénéfice[252]. Les acquéreurs étaient réunis dans un groupe dirigé par la Dresdner Bank et la Deutsche Bank. Les avoirs échappèrent toutefois au contrôle du consortium Herman Göring en raison de l’acquisition faite par les industriels allemands de Haute-Silésie que dirigeait l’ancien ambassadeur Adolf von Moltke[253]. Elles n’en servirent pas moins les intérêts de l’Allemagne.
Enfin, la Société anonyme des Forges et aciéries de Huta-Bankowa, qui détenait d’importantes installations métallurgiques en Pologne, et dans laquelle l’UEIF possédait des parts (la BUP étant majoritaire), dut se résoudre à céder ses installations à un groupe allemand[254].
Ces opérations effectuées avec l’ennemi, pour les dernières d’entre elles[255], auraient pu être sanctionnées à la Libération par le 6ème comité de confiscation des profits illicites de la Seine dont dépendait l’entreprise. Toutefois, par ordonnance du 25 juillet 1945, le président du tribunal civil du même département constata la nullité des cessions effectuées au cours des années 1940 et 1941. Qui plus est, suivant arrêtés ministériels du 29 janvier 1946, l’État français renonçait à exercer le droit de se faire attribuer ces actions. Par conséquent, la société se trouvait à nouveau investie de la propriété pleine et entière des titres. C’était comme si l’opération illicite n’avait jamais existé pour la période antérieure à 1942. Elle ne fut donc pas intégrée dans le calcul de la confiscation par l’administration des Finances[256].
Avec les disponibilités libérées par ces opérations, l’UEIF put investir en France. Elle racheta ainsi la quasi-totalité du capital de la Société nouvelle des usines de la Chaléassière, société anonyme au capital de 50 millions de francs, qui possédait d’importantes usines de constructions mécaniques à Saint-Étienne (Loire) et à Anzin (Nord). L’UEIF prit également des participations dans différentes entreprises comme la Société pour le travail électrique des métaux (TEM) qui fabriquait des accumulateurs et transformateurs dans ses usines de Saint-Ouen et d’Ivry. Elle prit en outre le contrôle des établissements Barbet spécialisés dans l’exploitation des brevets, la distillation, le traitement de produits chimiques, et qui produisait des appareils nécessaires à ces industries dans son usine de Brioude en Haute-Loire[257]. A la Libération, l’UEIF contrôlait un total de dix-sept sociétés.
Autre élément soumis à l’épuration financière : les opérations boursières[258] ainsi que les découverts, cautions et crédit accordés par l’UEIF à des entreprises travaillant pour l’Allemagne. Même si la banque expliqua qu’il s’agissait pour l’essentiel de ses partenaires naturels – c’est-à-dire des entreprises du groupe Schneider – ces opérations illicites firent l’objet de taxation[259].
Enfin, comme à peu près toutes les banques françaises et notamment la Banque de l’union parisienne, dirigée par Pierre de Gaulle[260], frère du Général, l’UEIF et la Banque des Pays du Nord (avant la fusion) firent l’acquisition de biens juifs, participant ainsi à l’aryanisation mise en place par le IIIème Reich et le gouvernement de Vichy. Bien que le sujet nous entraîne hors du cadre chronologique de notre étude, nous allons brièvement l’évoquer.
Par ordonnance du commandement militaire allemand du 17 décembre 1941, une amende d’un milliard de francs fut imposée à la communauté juive en zone occupée. Pour réunir ces fonds dans les très brefs délais fixés par les autorités d’occupation, la Caisse des dépôts et consignations et un groupe de banques françaises firent des avances et, à la demande du gouvernement de Vichy, procédèrent à l’acquisition de valeurs mobilières appartenant à des juifs. Une partie de la dernière tranche de l’amende fut payée le 31 mars 1942 sur le produit de la vente de titres appartenant à des juifs et acquis par un groupement de trois banques, l’Omnium français d’études et de participations (OFEPAR) constitué par la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque de l’Union parisienne et la Banque des Pays du Nord, c’est-à-dire l’un des outils financiers du groupe Schneider (ces trois établissements pour un montant de 245 millions de francs), d’autre part par la Banque de France (environ 31 millions de francs) et une nouvelle fois la Banque de Paris et des Pays-Bas[261].
Pour les acquisitions de biens juifs, l’UIEF put prouver qu’il s’agissait d’une aryanisation de complaisance et qu’elle avait ou allait restituer dans leur intégralité ces biens à ses légitimes propriétaires, c’est-à-dire les parts que la Société Rothschild Frères et Édouard de Rothschild détenaient dans la TEM, et ceux que possédaient la Société Lazard Frères dans la SOVAC et Citroën. La direction générale des contributions directes du ministère des Finances accepta les explications de la société tout en précisant en interne que ce type de justification ne saurait être accepté à l’avenir qu’au cas par cas afin d’éviter une entente entre les acquéreurs et les spoliés visant à éviter une confiscation[262].
Conclusion : Quelques critères de la collaboration économique
La remise en route des usines au cours de l’été 1940 était probablement une nécessité pour une industrie qui, en raison même de son potentiel militaire, fut l’objet d’une pression particulière et d’un contrôle très étroit de l’occupant ; mais à la Libération, les dirigeants du groupe jugèrent utile de décorer a posteriori cette volonté de reprise d’intentions « résistantes » qui n’existèrent pas au cours de l’été 1940. Les principaux dirigeants, Eugène Schneider et André Vicaire, manifestèrent en outre, au moment des faits, une réelle complaisance à l’égard des premières commandes de matériel de guerre alors qu’il eût été aisé de se retrancher derrière la position, certes fragile, mais tout de même assez claire du gouvernement français[263]. Ce dernier eût sans doute fini par donner son aval, comme il le fit – parfois même de manière rétroactive, pour la quasi-totalité des commandes de matériel de guerre allemandes soumises au service de l’ingénieur Jean Herck dès la fin 1940.
Autre point remarquable : la rapidité avec laquelle s’affirme, non pas seulement la reprise elle-même, mais la volonté de reprendre le travail après la défaite. Le compte rendu de la visite du 19 juin au Creusot montre que ce désir, exprimé par Henri Stroh, existait déjà deux jours seulement après le célèbre discours de Philippe Pétain appelant à la cessation des combats, et trois jours avant la signature de l’accord d’Armistice avec le Reich, c’est-à-dire à un moment où persistait, non seulement l’état de guerre qui ne prendrait fin qu’avec la défaite finale de l’Allemagne, mais également, en théorie du moins, les hostilités entre les deux pays. On peut faire une remarque similaire à propos du retour d’exode d’André Vicaire, qui s’effectua le lendemain même de la signature de la convention d’Armistice avec l’Italie (25 juin), désir de reprise appuyé par le ministre du Travail[264]. Dans tous les cas, les Français voulaient occuper rapidement le terrain afin d’éviter le pillage de l’industrie nationale. A cet égard, l’exemple de Schneider n’avait rien d’exceptionnel et nous savons que les dirigeants de Peugeot et de Renault rentrèrent dans leurs usines respectives au même moment[265].
Il faut en outre mesurer l’état chaotique de la France au cours des mois de juin et juillet 1940, se rappeler que, pour beaucoup, il s’agissait de parer au plus pressé, qu’il n’y avait plus d’argent, plus de ravitaillement, plus de moyens de transport, plus de nouvelles, que, dans certaines régions, les routes, les villes, les campagnes, étaient littéralement peuplées de réfugiés et de chômeurs qui n’avaient plus aucun moyen de subsistance et souffraient parfois de la faim. A cet égard, le journal de François Walckenaer, dont nous citons des extraits en annexe 3, offre quelques images saisissantes comme celle de ces réfugiés luxembourgeois, bloqués plusieurs jours dans un train en gare du Creusot, et qui furent comme tant d’autres à la soupe populaire. Cette volonté de reprise rejoignait, mais pour d’autres raisons, celle d’Allemands littéralement hantés par le souvenir de la Révolution bolchevique et, plus encore, par celle manquée des Spartakistes. Il fallait remettre au plus vite la France au travail, à la fois pour alimenter les besoins de la Wehrmacht, mais aussi – et les choses étaient liées – pour éviter des troubles sociaux. Lorsqu’il convoqua le dirigeant de Schneider le 5 juillet 1940, le capitaine Eberhardt Ponndorf, commandant les troupes d’occupation à Saint-Honoré-les-Bains, et député de Prusse orientale au Reichstag, se montra affolé par la détresse matérielle de la population et les risques de « révolution » que celle-ci pouvait selon lui entraîner. Une inquiétude que nous avons déjà rencontrée chez les Allemands à propos de Renault et qui fut loin d’être rare, du moins au début de l’Occupation.
Nous l’avons précisé dans un article récent : l’attitude de Schneider de juin à septembre 1940 ne préjuge en rien du comportement ultérieur des dirigeants et du personnel de l’entreprise. La victoire du IIIème Reich semblait alors durable : la bataille d’Angleterre n’était pas terminée ; ni les États-Unis ni l’URSS n’étaient entrés en guerre. La volonté de reprise, quasiment unanime, était partagée par des acteurs aussi différents que le gouvernement de Vichy, les industriels, le personnel des usines, le Parti communiste clandestin. Divers facteurs allaient constituer de puissantes motivations à la résistance passive dans les périodes ultérieures, notamment les bombardements alliés, les premières défaites de la Wehrmacht, les réquisitions de main-d’œuvre, la pression exercée sur les entreprises par la Résistance française et les services secrets britanniques… Comme le constata avec raison Robert Israël pour SW, les causes de retards des commandes allemandes étaient multiples et ne sauraient être imputées à la seule volonté de la direction. L’expert remarqua entre autres l’impact de la chronologie : la quasi-totalité de commandes allemandes passées entre les mois d’août 1940 et décembre 1942, fut livrée, contrairement à celles souscrites après cette date[266]. Non sans fierté, le rapport de gestion de Rheinmetall-Borsig de 1941 nota que Schneider avait réussi à obtenir « un rendement supérieur à celui que les Français n’avaient jamais atteint avant l’invasion des troupes allemandes »[267].Les personnalités des dirigeants jouèrent également un rôle qu’il n’est pas toujours simple de mesurer. Tous les témoignages relevés à la Libération indiquent que des responsables comme Jean Pérony, directeur-général de la SOMUA, n’étaient pas enclin à collaborer activement avec l’occupant. La SW dirigée par Pierre de Cossé-Brissac fit preuve d’une mauvaise volonté évidente pour fabriquer des obus sous la pression allemande (à partir de 1943). Elle ne profita nullement de l’Occupation sur le plan financier et, à l’instar de Schneider & Cie, obtint un classement pur et simple du comité de confiscation des profits illicites ainsi qu’un non-lieu de la cour de justice[268].
Le changement assez net d’attitude de Schneider et de ses filiales, qui témoignèrent rapidement de réticences à l’égard des exigences allemandes, obéit aussi bien à l’évolution du contexte politique, industriel et militaire, comme ce fut le cas pour une majorité d’entreprises françaises, que des positionnements individuels et collectifs. Il est assez révélateur à cet égard qu’un homme comme Henri Stroh, qui allait payer chèrement sa résistance aux volontés allemandes et dont le patriotisme ne saurait être mis en doute, se concentra pendant l’été 1940 sur les moyens d’activer la reprise de l’usine du Creusot en obtenant des commandes, françaises et allemandes. Il fallait que l’entreprise survive. Après la disparition du gérant historique, Eugène II Schneider, en novembre 1942, l’affaire fut reprise par ses deux fils, Charles et Jean, ce dernier rejoignant aussitôt Alger et se mettant au service du général Giraud. Ce changement de direction a-t-il accentué la modification de comportement déjà perceptible dès l’automne 1940 ? En tout cas la succession s’effectuait au moment où intervenaient d’autres facteurs de rupture décisifs comme le premier bombardement, le début des réquisitions de main-d’œuvre, le débarquement allié en Afrique du Nord et l’invasion de la zone sud. Parmi toutes les données que l’historien doit prendre en compte, la diversité des personnalités, et donc celle des attitudes au sein d’une même entreprise, n’est pas l’une des moindres. La résistance d’Henri Stroh en est un exemple marquant. Déporté à Buchenwald en 1944, le directeur du Creusot disparut au printemps de l’année suivante au sein de la zone d’occupation soviétique dans des conditions qui ne furent jamais élucidées.
Pour toute référence à ce texte, merci de préciser : Laurent Dingli, avec Jacky Ehrhardt pour la traduction des sources allemandes, “Schneider : de l’exode à la collaboration (été 1940)”, laurentdingli.com, 28 novembre 2020. Dernière mise à jour 7 septembre 2021.
Annexe 1. Postes dans les conseils d’administration et/ou fonctions dans les entreprises des principaux administrateurs du groupe Schneider – A = administrateur. DG = Directeur-général. P = Président (du CA). VP = Vice-président. En rouge, postes occupés en 1946 et sans certitude pour les périodes antérieures (voir format PDF)
Annexe 2 : Réunion du 19 août avec la Mission allemande, Le Creusot, 20 août 1940, 5 p.
« Etaient présents : MM. Nagel, Berkenkemper, Passau, Utsh ; MM. Stroh, Lartaud.
« 1° – Offres de prix – La mission a insisté vivement pour que les offres de prix soient expédiées plus rapidement. Le bilan du 19 est finalement satisfaisant, certaines offres ayant pu être transmises directement grâce à la présence de M. Borel [Cf. demandes de remises par M. Nagel, etc., ndr] (…)
« Nous pensons qu’il sera très utile qu’un agent commercial revienne de temps à autre au Creusot avancer la discussion des affaires.
« Par ailleurs, il est très désirable de ne pas multiplier les spécifications, les difficultés d’approvisionnement de certains alliages spéciaux nous conduiront à peu près nécessairement à adopter certaines formules allemandes. Nous pensons que l’intérêt général de la normalisation est de chercher à étendre cette conception plutôt qu’à la restreindre.
« 2° – Plans de locomotives
« Un message téléphoné a été envoyé à M. Hartmann demandant un prochain envoi total ou partial des plans de locomotives. La Mission a insisté sur la priorité qui pourrait être éventuellement demandée pour les locomotives allemandes.
« 3° – Travaux en cours
« Cette priorité est susceptible d’être demandée également dans d’autres cas. Dans cette éventualité, M. Nagel nous engage à avancer le plus possible en ce moment nos travaux sur les commandes en cours. Les interdictions de livraisons qui nous ont gênés dans les derniers temps sont considérées comme tout à fait momentanées et pourront vraisemblablement être levées entièrement pour la zone occupée.
« 4° – Approvisionnements pour la marche de l’usine
« Nous avons insisté sur le fait que certains approvisionnements de base : fonte et coke, pourraient être trouvés en zone libre et qu’il y avait là l’occasion de montrer que le franchissement de la démarcation était nécessaire dans les deux sens. Cette argumentation est, pensons-nous, susceptible d’être développée. Pour le moment, seuls traversent la démarcation les éléments de gazogènes Berliet. Il convient de rechercher tous les motifs qui peuvent être avancés pour accroître les facilités d’échanges.
« 5° – Inventaire
« Les déplacements d’objets nécessités pour l’inventaire ont été très accélérés et, en ce qui concerne la Guerre, ils seront à peu près terminés le 24. La Commission de recensement des matières premières a également l’intention de recenser ces objets.
« En ce qui concerne la Marine, la concentration au Puits Soret demandée par la Mission allemande ne soulève pas d’objection de notre part, mais les emplacements sous ponts roulants seront probablement insuffisants, de telle sorte qu’une partie des blindages restera dans l’usine. Il serait intéressant de voir riblonner ou utiliser à d’autres usages une partie de ces éléments.
« 6° – Prisonniers
« M. Nagel nous remettra un modèle de demande individuelle, l’emploi des listes étant très peu pratique puisque les prisonniers sont appelés à se déplacer d’un camp à l’autre.
« 7° – Machines-outils disponibles
« Nous avons appelé l’attention de M. Nagel sur le fait que la liste des machines-outils en construction et dont nous n’insistons pas pour prendre livraison, a été remise à plusieurs autorités et que par conséquent certaines demandes peuvent se contredire.
« En ce qui concerne la demande du capitaine de frégate Bach concernant les tours SOMUA, nous maintenons qu’il est préférable de le satisfaire dans les tours en construction. Seulement dans le cas d’une urgence extrême nous acceptons une permutation, nous livrerions les machines parmi celles déjà installées au Creusot et nous prendrions en échange les machines en construction chez SOMUA. Ces machines sont d’ailleurs plus puissantes.
« Il est à noter que la semaine dernière M. Nagel nous a fait remarquer l’enlèvement d’un certain nombre de tours de l’annexe CM1 (bombes).
« Nous avons, en effet, réparti dans nos ateliers de réparations et à l’ébauchage ainsi qu’à l’annexe forgeage un certain nombre de ces tours qui sont en très bon état et remplacent très avantageusement les machines usées. Ces tours nous appartenant, nous avons maintenu qu’il ne pouvait y avoir aucune objection de la Mission à ce mouvement. M. Nagel l’a finalement admis.
« 8° – Quartier de Chalon
« La situation des Chantiers de Chalon est toujours à peu près la même, M. Nagel estime que nous devrions pousser la commission d’Armistice à régler cette question qui, à son avis, ne peut se dénouer que par le rattachement à la zone occupée. Ce rattachement a déjà été fait pour le poste Henri-Paul de la BTE ; nous y avons eu plutôt avantage, certaines susceptibilités allemandes ayant ainsi été supprimées.
« 9° – Liaison avec Paris
« Nous avons émis l’idée qu’un fil spécial reliant la mission Schubert à nos bureaux de Paris pourrait être très utile pour accélérer les relations toujours difficiles avec notre direction.
« 10° – Nouveaux ingénieurs de la Mission
Il nous a été demandé de préparer 5 nouvelles chambres pour la semaine prochaine. La question est à l’étude. Il n’est pas impossible que nous soyons conduits à sacrifier, non seulement la chambre de M. Walckenaer, mais également l’appartement de M. Vicaire. Nous essaierons de l’éviter.
« Annexe au paragraphe 4 – Métaux rares : M. Nagel nous a demandé quelle serait notre consommation de métaux rares (Cr, Ni, Mo, Va, Tu, Cu, Sn, Zn[268]) dans les 6 mois à venir.
« Nous lui avons indiqué les besoins de nos constructions mécaniques. En outre, s’ajoute la fabrication d’aciers spéciaux pour l’extérieur. Il a été convenu de prendre pour base de 6 mois 7 000 tonnes d’acier genre DFO et 500 tonnes d’aciers à outils ».
Annexe 3 – François Walckenaer, Témoignages et souvenirs des années difficiles, texte dactylographié, 1972 [Aimablement communiqué par Benoît Walckenaer, petit-fils de l’auteur, ndr] – Extraits :
Le Creusot en juin-juillet 1940
Occupation par les Allemands
De mon côté, pendant ce triste mois de juin 1940, j’eus à participer à l’exode et au retour à Paris de Schneider et Cie. Ci-après le texte du journal que j’ai tenu en juin-juillet 1940.
Dimanche 9 juin 1940. Décision est prise de replier sur Le Creusot les bureaux de Paris, sauf les directeurs qui resteront en liaison avec les ministres, particulièrement le ministère de l’Armement.
Les ministères démentent en effet tout projet de départ, ce qui est en contradiction avec les préparatifs que l’on y voit faire
Lundi 10 juin. Les archives indispensables des services de l’Exploitation sont emballés dans des caisses et des sacs par le personnel : elles constituent le chargement de deux camions que M. Vicaire a pu obtenir de MM. Ribière, marchands de fer.
La capacité est quelque peu réduit par la famille des conducteurs et leurs ipedimenta. Les camions partent à 16h 30 avec chacun un convoyeur (M. Drompt de DMT – Direction de la Métallurgie – et M. Mouron de DMN – Direction des Mines). Le personnel reçoit des billets de chemins de fer sans garantie de places retenues et prend le train Gare de Lyon avec la plus grande difficulté (certains ne partiront que le lendemain matin).
Comme le ministère de l’Armement déménage en totalité, la Direction du Creusot accompagnera l’exode au Creusot.
Le personnel supérieur ou sachant conduire utilise des voitures personnelles ou les voitures de la Maison. Partant dans la soirée, les plus favorisés font le trajet dans la nuit, les moins favorisés en 48 heures ou plus. J’utilise avec Monsieur Faucillon une Simon 8 appartenant à M. de Saint-Sauveur. Malgré une panne à Moret (la dynamo ne rechargeant pas), sous une pluie torrentielle, nous arrivons cependant au Creusot à 4 heures du matin quoique partis dans les derniers, sinon les derniers.
A 6 ½, je vais à la gare du Creusot accueillir le premier train amenant nos employés. Au bout de 4 jours, il ne manque plus que 3 ou 4 unités de personnel.
11 et 12 juin. Réception et installation du personnel par les soins de l’usine du Creusot. Installation des bureaux à la Direction, dans les bureaux de la régie, de l’ACT, mais aucun courrier commercial ou financier ne nous parvient de l’extérieur (…)
15 juin (…) Au début de l’après-midi, décision de départ est prise pour la Direction générale qui se repliera (très peu de personnes) sur notre usine de Bordeaux. J’indique qu’en ce qui me concerne, il ne me paraît pas possible, en qualité de directeur de l’Exploitation, d’abandonner le personnel de Paris qui ne peut que rester ici, et en tant qu’ancien directeur du Creusot d’abandonner l’usine, ses ouvriers et employés au hasard des événements.
Aussitôt que nous en aurons l’ordre des autorités militaires, nous ferons partir des affectés spéciaux. Il est impossible de prévoir ce que va devenir l’activité de l’usine, en tout cas celle des bureaux commerciaux va être nulle pendant quelque temps. En dehors de quelques agents qui constitueront le « détachement du Creusot », le personnel des bureaux de Paris est mis en disponibilité ; son mois de juin lui est payé plus 500 fr., notre trésorerie extrêmement restreinte ne permet pas de faire plus. En effet, après règlement des employés des bureaux de Paris mis en congé (au Creusot et à Saint-Honoré), et des avances faites aux affectés spéciaux, il ne reste que 4 millions en caisse environ.
Dans l’après-midi du 16, j’envoie M. Rebour à Autun, mais les Établissements de crédit sont partis. Je lui donne des instructions pour partir le lendemain à 4 heures du matin avec M. Boitier pour Vichy et, si nécessaire, Clermont-Ferrand, où il trouvera des représentants de la Banque des Pays du Nord et de chercher à rapporter 20 millions (…)
Pour le départ des affectés spéciaux, les ordres sont donnés dans l’après-midi et les départs commencent le soir et s’échelonneront pendant toute la nuit. Les Nord-Africains partent à pied, en colonne, sous le commandement d’un officier interprète, accompagnés par une camionnette de vivres. (Malheureusement, ils ont été, paraît-il, rejoints deux jours après et faits prisonniers. Beaucoup de Français partent individuellement, en bicyclettes ou en autos ; nous mettons à disposition de groupe d’ouvriers beaucoup de camions et voitures de l’usine, ne conservant que l’essentiel (…)
17 juin. Je me lève à l’aube et me retrouve avec Stroh à la Direction. Nous avons des guetteurs à Montcenis et à l’entrée du Creusot qui, pendant très longtemps, ne nous signalent rien. Vers 11 heures ½, une colonne de chars est signalée montant de Marmagne sur Montcenis. Quelques militaires français isolés dans des véhicules de rencontre (vilain spectacle). Nous sommes à la Direction, ayant fait mettre sous clef les revolvers de garde. A midi ½ nous sommes Stroh et moi dans le bureau de Roher au rez-de-chaussée ; nous ne savons pas du tout ce qui nous attend. « Au moins, lui dis-je, nous aurons essayé d’être des hommes de bonne volonté ». A ce moment l’huissier (Gronfier je crois) frappe et entre, et, du même ton qu’il annonçait des visiteurs de marque : « Ces Messieurs sont là. » Nous gagnons le vestibule. Devant la Direction des motocyclistes allemands descendent de leur machine ; d’autres arrivent en trombe, précédant une voiture légère sur les garde-boue de laquelle deux soldats sont couchés, mitraillette au poing ; un capitaine en descend ; il monte d’un pas délibéré les marches du perron de la Direction, suivi de deux types à mitraillette qui nous les pointent sur l’estomac ; derrière nous un petit cercle d’employés. Les deux mitrailleurs sont eux-mêmes suivis d’un demi-cercle de Fritz tenant des grenades.»
Le capitaine allemand, très homme du monde, s’avance avec son beau sourire et, la main largement tendue : « Capitaine X…, fils d’un directeur de la maison Krupp. »
Je reste muet et ignore sa main. Il change de ton et demande la raison de cette attitude. Je parle et comprends médiocrement l’allemand ; je préfère faire celui qui ne le parle pas du tout et dit à Stroh : « Veuillez dire à cet officier que la poignée de main constitue chez nous une marque d’égalité que je regrette profondément de ne pouvoir montrer à un officier ennemi. » Il se calme, demande à voir le maire. M. Bataille vient de la mairie. L’Allemand donne des ordres pour une réquisition de 3 000 kilos de pain.
Il nous dit que c’est la première fois qu’il voit les cadres et les autorités rester à leur poste, et ajoute : « Vous êtes responsables de l’ordre dans votre ville. » « La ville n’est-elle pas en ordre ? » répond Stroh. « C’est la première fois, répond le capitaine, depuis le début de la campagne que je vois une ville en ordre. » Toutefois, il s’étonne de voir les ouvriers circuler nombreux dans les rues. Nous répondons que l’usine n’a pas cessé son travail (ce travail est d’ailleurs très réduit car il est arrêté sur toutes les commandes de guerre et désorganisé par le départ des affectés spéciaux).
18 juin. A 8 heures du matin, la lumière s’éteint progressivement, ce qui semble indiquer un arrêt des machines aux stations hydroélectriques plutôt qu’une destruction des machines ou des lignes. Nous remettons la centrale en route pour 1 800 kw, l’usine étant arrêtée l’après-midi à l’effectif de 4 200 ouvriers et 800 employés. Suite de l’arrivée de troupes blindées donnant l’impression d’ordre et de discipline, les officiers mangeant la même soupe que les hommes, et tout le monde buvant de l’eau.
19 juin. Je me rends en auto aux Chantiers de Chalon avec qui (comme avec le reste du monde extérieur) toute liaison est coupée. Je passe sans trop de difficultés bien que les routes soient occupées par d’interminables colonnes blindées s’écoulant vers le Sud (chars, artillerie tractée, équipages de ponts).
Aux Chantiers de Chalon, le personnel s’est dispersé le 16 juin soit par ordre (affectés spéciaux) soit spontanément. Les Chantiers ont payé, avec ce qu’ils avaient en caisse et ce qu’ils ont pu retirer de la Société Générale au dernier moment, un à compte de 300 à 400 fr. à tout le monde, la caisse est pratiquement vide. Je décide la fermeture pour une période indéterminée (…)
Pendant ce temps est arrivée au Creusot une mission (reçue par Stroh) d’ingénieurs et d’officiers « en vue d’examiner un programme d’activité » (Major Varenhorst, MM. Spielvogel, Isenberg et quatre autres). Stroh essaie de les convaincre que l’outillage du Creusot se prête particulièrement aux fabrications civiles (locomotives).
20 juin. Sans nouvelles de nos voisins des mines de Blanzy, je me rends en auto à Montceau-les-Mines avec M. Duban. Vu le maire, M. Bailleau, qui paraît un peu débordé par la situation.
A l’arrivée des Allemands, tous les cadres de la mine sont partis, laissant le coffre fermé (et vraisemblablement vide) et la paye non faite. Les 10/11 000 ouvriers sont dans la rue depuis trois jours, manquent de numéraire et les approvisionnements sont difficiles (3 jours de farine). Le maire a fait faire des distributions de pain ; mais sans carte de pain, elles ont donné lieu à des abus (…)
Pendant ce temps, à l’usine, l’occupation militaire se développe. Les Allemands occupent, avec des postes de garde, toutes les portes d’entrée et sortie. La Kommandantur est à la mairie (lieutenant-colonel von Abentorff). Sont occupés en ville les écoles, la Verrerie, les quelques immeubles encore libres sont pris comme cantonnements (…)
21 juin. Les ouvriers qui sont dans l’usine sont très mal occupés par les quelques travaux d’entretien qu’il y à faire ; en plus nous n’avons pas d’argent pour les payer. Nous arrêterons l’usine le 21 au soir, ne maintenant que 330 personnes, chefs de service compris, chargées essentiellement de la mise en ordre des ateliers (…)
Je me rends en auto à La Machine, accompagné de M. Duban, pour voir la situation des Houillères de Decize. La mine et la station centrale de Champvert sont en marche. M. Charroux est resté à son poste ainsi que tous ses cadres et presque tous ses ouvriers ; il n’a pas encore de repli même pour les affectés spéciaux. Il fait face à la situation en bon accord avec le maire, M. Cornesse (…)
Au retour, je passe à Saint-Honoré-les-Bains. Les cadres des bureaux techniques, notamment M. Vierrt, qui est très dynamique, ont beaucoup aidé la mairie à prendre en main le service d’ordre, des cartes de pain, etc. à l’Hôtel Thermal, en faisant tout eux-mêmes et en se rationnant, ils dépensent environ 13 francs de nourriture par jour. Je ne puis faire grand-chose pour eux que de leur conseiller de durer le plus longtemps possible dans ces conditions en attendant une évolution de la situation ou la possibilité de gagner individuellement sa vie (…)
Au retour on examine avec la mairie (du Creusot, ndr) la question des bons de monnaie. Le maire, pour des raisons de régularité, veut des bons strictement municipaux, mais nous serons obligés de passer outre et de créer des bons-usine de 30 et 100 francs, signés par Stroh et moi, les comptables s’étant voilés la face. (Avec le tirage en plusieurs couelurs, le numérotage, les précautions prises pour la conservation des clichés, je crois que ces billets n’ont donné lieu à aucune irrégularité, ni à aucun abus) […]
22 juin (…) A 15 heures, visite du lieutenant-colonel Wendt de l’état-major d’une armée allemande dont le QG est à la Tuilerie de Chagny. Il s’enquiert des conditions de retour à une certaine activité. Je lui dis que le point le plus important est l’énergie électrique et que même que même pour les besoins indispensables (éclairage, pétrins, etc.), la centrale thermique du Creusot ne pourra faire face longtemps. Je lui indique la situation des usines hydroélectriques qui nous alimentent. Il décide d’envoyer dès le lendemain le capitaine Keller (qui est, en réalité, un ingénieur électricien), avec une voiture, faire la tournée des stations centrales (Bolozon) pour remise en route. Il demande des ingénieurs pour l’accompagner ; ce seront MM. Colin et Veron (…)
23 juin. Retour de M. Colin avec le hauptmann Keller. Ils ont pu aller à Cise-Bolozon et téléphoner à Chancy-Pougny. Dans l’ensemble, tout est en ordre ; on pourra sans doute avoir du courant dans quelques jours. Le hauptmann Keller est saisi de la question de l’évacuation des Luxembourgeois, ce qui nécessite le rétablissement des trains vers le Nord (…)
25 juin (…) Visite de l’usine par le Lieutenant-colonel Obenhaus, commandant de place, accompagné du lieutenant-colonel von Bissing (professeur d’économie politique). Nous leur répétons nos préoccupations principales : programme industriel de fabrication de pièces pour la France – ravitaillement (diminuer les effectifs allemands cantonnés) – énergie hydroélectrique – communications (poste, téléphone) – transports (chemins de fer). Ils nous disent que leur objectif est de rétablir le plus vite possible la vie économique, assurant du travail et du pain (…)
Stroh et moi recevons des autorités allemandes un laissez-passer valable pour les territoires occupés (…)
26 juin. J’autorise MM. de Borniol, Lacagne, Demangeon, à partir pour Paris le 27 pour voir la situation de l’usine de Dion, et leur remets un ordre de mission à cet effet.
Passage de M. Henri Vicaire, directeur général d’Aubrives-Villerupt, à la recherche de notre direction générale. Nous lui disons notre ignorance. Il va se rendre à Montluçon où il a sa fonderie de repli qu’il ne voit guère comment remettre en route (elle faisait des obus en fonte aciérée), puis il va voir la situation à Villerupt. A Saint-Étienne, nous dit-il, la sidérurgie est arrêtée.
Retour de M. Guenard, de la Division de la Métallurgie. Il arrive de Clermont-Ferrand où l’Occupation est, paraît-il, réduite et presque invisible. La situation est presque normale. Michelin travaille trois jours par semaine (…)
27 juin (…) M. Daudans va faire le point des sommes qui nous sont dues par l’État. A première vue, sur factures émises, on nous doit environ 120 millions [Note 1 : En réalité 185 – relevé du 29 juin, voir Annexe II]. Restent les factures de liquidation à émettre, pour cela un inventaire est nécessaire.
A 13 heures, arrivée de MM. Vicaire et Faucillon venant de Bordeaux. Tout le détachement de Bordeaux s’y trouve et envisage de regagner Paris (sans doute par Clermont-Ferrand) quand les règles de circulation seront établies. Monsieur Vicaire indique que Le Creusot est sans doute l’usine métallurgique la mieux placée pour remise en route ; d’où établissement d’un programme de fabrications métallurgiques portant sur les produits à priori les plus immédiatement nécessaires.
Le procès-verbal de cette conférence est envoyé à la Direction générale de Bordeaux, qui donne mission au colonel Fontaine et à M. Saffrey de se rendre à Clermont et à Vichy pour chercher à obtenir des commandes de la SNCF [Note 2 : Voir annexe II] (…)
28 juin (…) Visite de M. Ducreux qui a encore en caisse à Chalon environ 150 000 francs pour faire face aux avances et salaires dus. Depuis hier, l’entrée de l’usine lui est interdite par un détachement allemand ; les Allemands l’utilisent en effet comme « dépôt de butin » (Beuteammelstelle) ; il paraît que des wagons de cuir, tissus, etc. y arrivent constamment, notamment de la région de Lyon. Je donne à M. Ducreux une lettre pour le lieutenant-colonel Wendt, à Chagny, en vue de chercher à éviter cette utilisation d’une usine qui n’a jamais été abandonnée par sa Direction. . Je lui conseille d’instituer un détachement de 12 personnes environ pour la garde de l’usine, et de chercher à faire réparer sa sous-station par le service d’entretien de la Cie de la Grosne et de Formo-Centre.
29 juin. MM. Vicaire et Faucillon partent pour Paris dans l’intention de voir les possibilités industrielles ainsi que les possibilités de réinsertion du siège social (…)
Je vais à Autun avec M. Stroh. Aux Schistes bitumineux, quelques employés sont restés. Le directeur général, M. Schlumberger, vient d’arriver, et nous le trouvons avec l’ingénieur des Mines, M. Robert. Ils n’ont pas pu encore reprendre l’extraction, mais font de la distillation et vendent l’essence aux réfugiés sous le contrôle de la Kommandantur d’Autun à qui il faut faire viser les bons. Avec ce visa, nous pourrions obtenir de l’essence pour l’usine.
30 juin (…) M. Boitier arrive de Bordeaux avec M. Bataille, qui s’y était rendu, ainsi qu’à Clermont. Il nous apporte pour notre caisse 1 100 000 fr.. D’autre part, le receveur des Finances nous apporte, à valoir sur notre crédit à la Banque de France, 500 000 fr. dont 160 000 environ en marks allemands. C’est peu de choses au total.
Examen des mesures à prendre pour remise en route de l’usine (qui est toujours arrêtée) sur un programme minimum comportant les poursuites des commandes civiles en cours (notamment pour les usines hydroélectriques en construction) et les fabrications de métallurgie (magasin) avec un fou Martin.
Passage de MM. Guyon et Chaine, de la SW, retour de Lyon et se rendant à Champagne pour examiner la situation (…)
Le train de rapatriement des ouvriers luxembourgeois a attendu plusieurs jours en gare, les gens n’osant pas quitter le train – ce qui lui donnait l’aspect d’un campement de romanichels. Il a fini par partir pour Chagny samedi 29 après-midi, mais a été refoulé sur Le Creusot dimanche matin. Il y aurait embouteillage de réfugiés à Dijon et on ne doit, paraît-il, envoyer personne au-delà de la ligne Genève-Rivet. Nous nourrissons ces malheureux à la soupe populaire de la caserne qui rend les plus grands services grâce, notamment, à l’actif dévouement de M. Palot. Lundi matin 1er juillet, le train est toujours en gare avec ses passagers (…)
2 juillet. Je me rends à Decize avec Duban. Les Houillères travaillent trois jours par semaine avec 1 500 ouvriers et 150 employés environ. Le lavoir marche aussi. On n’a vendu que 200 tonnes (ventes locales). Ils vont prospecter dans un rayon plus étendu.
1 million de bons de caisse ont été mis en circulation sans grandes difficultés. Je remets 350 000 fr. prélevés sur la caisse du Creusot ; ainsi auront-ils en caisse 650 000 fr., et en circulation 1 million de bons qui s’accroîtront dans quelques jours de 650 000 fr.
La marche actuelle, même avec les mesures sévères que nous avons décidées, telles que personnel employé à ½ salaire, institutrices en congé sans solde, licenciement des employés récemment embauchés, etc. permet à peine de végéter même si on écoulait 100 % de la production actuelle au lieu de 5 %.
Il faut donc escompter une hausse ou un développement considérable des ventes et réduire encore les frais (…)
3 juillet (…) Reçu la visite du directeur général (M. Verdier) et de l’ingénieur en chef (M. Grouillet) de la fabrique de machines agricoles Puzenat-Valette à Bourbon-Lancy. Leurs ateliers sont actuellement arrêtés, mais ils doivent reprendre rapidement la fabrication des machines agricoles (ils avaient en même temps une fabrication d’obus, mais bien séparée et en somme secondaire). Leur situation de trésorerie est satisfaisante, si les rentrées prévues pour fin juillet se font normalement. Ils ont à approvisionner des tonnages d’acier assez importants et, à défaut des Forges de l’Est, leurs fournisseurs habituels, ils les prendraient volontiers au Creusot. Livraisons possibles par voie d’eau. M. Guenard examine la question avec eux (…)
4 juillet (…) Retour de Rebour apportant un chèque de 5 millions sur la Banque de France de Chalon, qu’il verra demain.
Le détachement de Bordeaux devant partir pour Paris le 4 au matin, demande qu’on lui envoie de Paris MM. Rebour, Couenon, Boitier, Gosselin.
5 juillet (…) A 15 heures, Vibert arrive de Saint-Honoré dans une auto militaire allemande. Il est chargé, par le capitaine Ponndorf, commandant le détachement qui occupe Saint-Honoré, de me demander d’aller le voir. L’auto allemande m’y emmène. Conversation d’une heure en présence de Vibert avec ce capitaine, qui est correct, mais mordant. Il demande avec insistance ce que nous comptons faire pour empêcher le personnel de Saint-Honoré de tomber dans la détresse. Répondu qu’il s’agit d’une mesure rendue obligatoire par la perspective de ne pouvoir continuer l’activité normale de ces bureaux, ce qui est de plus en plus exact maintenant que leurs archives et documents sont sous séquestre.
D’autre part, la situation de désorganisation momentanée des communications et des moyens de crédit nous laisse à peu près sans numéraire. Nous y avons paré au Creusot et à Decize par des moyens provisoires (comme tout le monde). A Saint-Honoré, le personnel a, en général, plus d’argent devant lui qu’au Creusot, même le faible effectif qui travaille. Le problème est général. « C’est pourquoi, dit Ponndorf, si vous ne le résolvez pas, vous aurez la révolution. Vous avez des réserves. Vos actionnaires en profitent et se promènent ; il faut utiliser ces réserves à assurer la soudure. » Répondu que ces réserves ne dépendent pas de moi, et que j’ignore les possibilités de les mobiliser (possibilités certainement réduites depuis que les titres de la Maison sont sous séquestre). Notre siège social s’est replié sur Bordeaux, mais je crois savoir qu’il va rentrer à Paris. Il faut avant tout que les usines retrouvent une certaine activité. Cette reprise a paru intéresser diverses missions (notamment la mission Varenhorst) qui sont venues voir nos moyens de production ; tout ce qu’on pourra faire pour aider à cette reprise à laquelle nous travaillons de notre côté sera dans le bon sens. « Mais ce sera long, répond-il, et pendant ce temps que vont devenir les gens ? » Etc., etc. Je réponds que ces restrictions sont inévitables et qu’au Creusot les agents ont touché bien moins qu’à Saint-Honoré. Il faudrait que les agents encore à Saint-Honoré puissent progressivement se disperser vers leurs familles, ou vers d’autres emplois ; mais actuellement le voyage sur Paris est impossible et interdit. Le capitaine Ponndorf, qui est, paraît-il, député du Reichstag, partait le soir même pour Berlin. Il me faire reconduire au Creusot (…)
Visite le soir de M. Hartmann, ingénieur de la Reichsbahn, accompagné, comme interprète, d’un ingénieur des chemins de fer d’Alsace et Lorraine (M. Gutenecht), venu pour examiner avec nous les possibilités de fournitures de matériel de chemin de fer. Il s’agirait de 50 locomotives 1-5-0 avec tenders (modèle allemand), des bielles, crochets d’attelage, cages de tampons, etc.
Cela vaudrait certainement mieux que d’être contraints de fabriquer du matériel de guerre.
6 juillet (…) Conférence de Stroh, Delahousse, Bertrand, avec Hartmann pour examiner l’affaire des locomotives :
30 locomotives Decapod, 1-5-0, 3 cylindres, de fabrication simple, poids 99 tonnes, plus tenders de 30 tonnes.
Le train luxembourgeois du 29 juin est toujours en gare. La mairie reçoit des Allemands et nous transmet l’ordre formel de répartir ces évacués avec leurs familles dans les villages des environs. On doit utiliser des camions. La Kommandantur donnera l’essence. Il y aurait en outre des réfugiés à refouler au-delà de la ligne de démarcation.
Confirmation, puis démenti de l’interdiction de l’accès à Paris.
Visite du capitaine Laroche (dans le civil baron von Laroche, directeur de la BAMAG). Il est mobilisé comme capitaine d’aviation, attaché au GQG allemand (OKW). Accompagné d’un ingénieur (M. Haure), il nous demande des tôles en acier Virgo soudable. Nous n’en avons pas en stock. Il voudrait aussi des chaudière en fonte spéciale pour acide sulfurique que nous avons en fabrication pour la direction des Poudres. Nous répoindons que la question est à poser à la direction des Poudres.
7 juillet. Continuation des entretiens avec Hartmann.
Le baron von Laroche visite l’aciérie du Breuil, CM1, le Forgeage. Il nous confirme la bonne impression de M. Hartmann sur les entretiens « Locomotives ». Au point de vue technique pas de difficulté ; la question commerciale pourrait se régler par un voyage à Berlin à partir du 22 juillet.
A 15 heures, je pars avec Delahousse pour Paris (…)
8 juillet. Arrivée à Paris avant 9 heures, malgré quelques difficultés d’itinéraire. Nous y retrouvons MM. Vicaire et Faucillon. Delahousse entreprend ses démarches commerciales. La SNCF (M. Poncet) envisage une série de locomotives Mikado 141P (jusqu’à 150 unités), mais les choses ne paraissent pas devoir aller vite.
9 juillet. Nous apprenons à 19 heures l’arrivée de MM. Schneider, de Saint-Sauveur, Goineau, Caron, Saint-Pol. Refoulés à Limoges, ils sont passés par Clermont-Ferrand et Vichy, 5 jours au total pour venir de Bordeaux.
Visite du Major d’Artillerie Vierling, Technischer Kriegsverwaltungsrat, dans le civil professeur à l’université de Hanovre, accompagné d’un capitaine d’Artillerie. Ils visitent les bureaux de l’Artillerie, sont au courant de la situation à Saint-Honoré, et disent que nos bureaux devront être à la disposition du général Schubert.
Entretien avec M. Vicaire à l’Astoria avec le général Schubert.
Worms reçoit pour ses chantiers naval du Trait l’ordre de travailler notamment à des renflouements de bateaux coulés en Seine-Maritime (…)
12 juillet. Retour au Creusot sans difficulté.
Les Houillères de Decize ont pu obtenir de l’autorité allemande à La Machine (après avoir, paraît-il, fait poser la question à Wiesbaden) l’autorisation d’expédier au-delà de la ligne de démarcation.
On a reçu 430 T. de commandes pour le Gaz de Bourges, Cosne, Nevers, et 460 T. par petites commandes de 20 T., par l’intermédiaire de M. Schmidt, représentant de la Ballaka-Brugnaux à Nevers. Le tout est payable d’avance ainsi que les ventes locales (20 T. par jour) ; 385 000 T. au total. Le paiement sera fait comptant sur l’initiative de la Trésorerie de la Nièvre pour les établissements publics du département. Ce sera plus difficile pour les chemins de fer.
Le trésorier-payeur de la Nièvre, devant la situation de caisse de Decize, a mis à sa disposition 2 millions de bons départementaux ; ils serviront à rembourser, en deux ou trois fois, les bons de caisse de l’usine (…)
Visite du général d’aviation Bührmann qui demande, pour demain matin, une liste de nos stocks de métaux (…)
13 juillet. La liste des stocks est remise par M. Voillot.
Le général von Leeb, avec un nombreux état-major, visite l’usine, conduits par Stroh. Je n’accompagne pas la visite.
Les départs d’ouvriers étrangers ont repris depuis le 9 et se poursuivent. Tous les Yougoslaves sont partis aujourd’hui. On va continuer par les Luxembourgeois, actuellement hébergés par les communes avoisinantes.
Arrivée de MM. Benezit et Thouroude (Direction des Travaux Publics), venant de Villeneuve-sur-Lot.
14 juillet. Je vais à Chalon avec MM. Benezit, Thouroude et Delahousse. Les Chantiers sont évacués depuis le 11, mais la Saône constituant la ligne de démarcation, on ne peut franchir la passerelle pour y aller (…)
On a pu régler le personnel présent au 16 juin avec 600 000 fr. Reste un disponible de 400 000 fr. sur la caisse du Receveur.
15 juillet. Départ de DTP (MM. Benezit et Thouroude) pour Paris.
Nous demandons rendez-vous au Feldkommandant colonel Jähn, à l’Hôtel Moderne, pour lui parler des expéditions en zone non occupée et de la situation des Chantiers de Chalon.
16 juillet. Visite du colonel Jähn. Il dit avoir réglé hier la question des laissez-passer pour le personnel des Chantiers de Chalon. (En réalité il n’y a rien de fait, comme nous le saurons dans l’après-midi.
Arrivée du général Dietinger et de M. Nagel, porteur d’un ordre des services de Berlin leur conférant une mission de direction et de contrôle du programme de mes établissements, ultérieurement de direction du contrôle technique des fournitures destinées à l’Allemagne. Ils demandent des renseignements sur :
Pou le moment ils ne font que passer, mais la mission sera permanente et comprendra :
18 juillet. Arrivée de M. Vicaire avec M. Freund, de la Société Citroën (pour bouteilles à gaz).
19 juillet. Visite des Chantiers de Chalon par la commission (Général Dietinger, M. Nagel)). Depuis hier, le détachement de Chalon a un laissez-passer, mais il faut faire le détour du pont de pierre, la passerelle étant barrée (…)
Le seul travail sérieux sur lequel on pourrait reprendre immédiatement serait « l’Antigone », sous réserve des plans et de la question de principe. Nous demandons à M. Delahousse, que M. Vicaire ramène avec lui à Paris, de chercher à éclairer cette question (…)
20 juillet. L’évacuation des réfugiés de la banlieue se poursuit (…)
Visite du Baurat Steinhardt (ingénieur de la Marine) et trois ingénieurs qui s’intéressent aux gros éléments de canons. Ils demandent des renseignements techniques sur canons, obus de rupture, blindages, ce pourquoi nous le renvoyons à DG [direction générale, ndr].
Visite des représentants de la firme Wagner, M. Beckhaüser (Geshäfte Führer), capitaine Stohmeyer, M. Geidetsger, pour examiner l’affaire des pièces de presses. Nous réservons à DG la conclusion définitive (…). Ces Messieurs seront sans doute lundi à Paris (…)
21 juillet. Suite de la visite du Baurat Steinhardt.
Je vais voir M. Ducreux à Fontaines. Il n’emploiera que des équipes réduites, 150 est la liste totale des gens dont on peut avoir besoin ; y compris bureau d’études, contremaîtres pour l’inventaire, etc.
Mais la situation des Chantiers, en zone libre, accessibles seulement de la zone occupée, est inextricable.
22 juillet. Fin de la visite du Baurat Steinhardt, qui fait réserver un certain nombre d’éléments de canons, projectiles, rondelles, blindages, pour se les faire expédier « à titre de butin » (Beute).
Convocation pour ce matin de MM. Delahousse et Thomachot à la Reichsbahn à Berlin (lettre partie le 13). D’autre part la SNCF paraît s’agiter autour de la Mikado 141 P (…)
24 juillet. Visite et conférence avec le baron von Schmidt et le capitaine von Daniels. Ils nous assurent que « l’intention formelle du Führer est de ne nous faire faire que des fabrications civiles. » (…)
25 juillet (…) Visite du baron von Laroche qui voit l’économie française très démolie. Trois points principaux : énergie (y compris combustibles), voies de communication, finances. En ce qui nous concerne, il voit dans la mission Dietinger-Nagel, notre meilleure sauvegarde (…)
30 juillet. Conférence de Boissieu. Restrictions désirées par le gouvernement sur des renseignements à fournir aux autorités occupantes (…)
Depuis le 2 août, un fonctionnement à peu près normal des services ayant repris, j’ai cessé de tenir mon journal au jour le jour.
Les visites allemandes ont continué, la progression des exigences a continué à se faire sentir. Au début, il faut avant tout ranimer les fabrications civiles françaises, puis il faut aussi faire des fabrications civiles allemandes, ensuite celles-ci ont eu la priorité sur les fabrications françaises. Ensuite, si on ne montre pas une bonne volonté suffisante, les fabrications françaises vont être interdites ; et ainsi de suite, on a l’impression d’un étranglement progressif (…)
[1] Si la mine du Creusot, proche de son épuisement, n’offrait qu’une faible production, celle de Decize portait encore la sienne à 1 100 tonnes par jour pendant la drôle de guerre. On rappellera cependant « que le charbon britannique, et même américain au lendemain de la (Grande Guerre), occupe une place sans cesse plus importante dans l’approvisionnement du Creusot. » Jean-Philippe Passaqui, « Mobilisation des facteurs de production et coordination de l’activité industrielle aux usines Schneider du Creusot de 1914 à 1918, Patrick Fridenson, Pascal Griset dir., L’Industrie dans la Grande Guerre, Colloque des 15 et 16 novembre 2016, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2018, p. 299-324.
[2] Exposé des motifs, 16 juin 1949, le commissaire du gouvernement. AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie).
[3] Je tiens à remercier tout particulièrement Jacky Ehrhardt qui traduit sans relâche depuis une dizaine d’années des archives militaires allemandes. Sans son travail colossal, cette étude n’aurait jamais pu voir le jour. Je tiens également à remercier Pascal Raimbault des Archives nationales qui m’aide depuis de nombreuses années, Virginie Seurat, archiviste de l’Académie François Bourdon, pour les informations qu’elle a bien voulu me communiquer ; Élodie Raingon documentaliste de l’Écomusée de La Verrerie, pour sa patience et son aide dans le choix des illustrations (voir la version numérique en ligne de ce texte) ; Olivier Azzola, responsable du Centre de ressources historiques Mus-X [Bibliothèque de l’École Polytechnique] ; mon confrère et ami Michel Blondan, spécialiste de la Résistance, pour les sources concernant Pierre et Madeleine de Gaulle ; Benoît Walckenaer qui a eu l’amabilité de me communiquer d’importants extraits du journal inédit de son grand-père : François Walckenaer, Témoignages et souvenirs des années difficiles, texte dactylographié, 1972 ; le Dr Christian Leitzbach, responsable des archives de l’entreprise allemande Rheinmetall pour les documents et illustrations qu’il nous a adressés ; enfin les historiens Patrick Fridenson et Jean-Marie Moine pour leur lecture attentive.
[4] Voir Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics (1895-1949). Préface de Dominique Barjot, Mémoire et documents de l’École des Chartes, Paris, École des Chartes, 1995, p. 316 sq. André Prost, « Henri Charles Stroh, Ingénieur, patriote », Bulletin de l’Académie François Bourdon, n° 4, janvier 2003. Françoise Berger, « La société Schneider face au travail obligatoire en Allemagne », Christian Chevandier, Jean-Claude Daumas éd., Le travail dans les entreprises sous l’Occupation, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, 67-86.
[5] Jacky Ehrhardt et moi-même avons défriché le sujet en abordant le cas de Schneider dans Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt, « L’industrie automobile au début de l’Occupation », L’Aventure automobile, Mai-juin-juillet 2019, p. 26-37, dont on peut trouver une version annotée en ligne.
[6] Avant d’être érigé en commune, Le Creusot, situé sur la paroisse du Breuil, dépendait de la baronnie de Montcenis dont le propriétaire était alors François de La Chaise.
[7] Comme pour la fonte destinée à forger les canons à Indret, la cristallerie avait été créée pour ne plus dépendre des importations anglaises.
[8] Voir l’historique succinct dans Schneider et Cie (du Creusot), Les Établissements Schneider. Matériels d’artillerie et bateaux de guerre, Impr. De Lahure (Paris), 1914, p. III-XIV. La fonte était alors de piètre qualité en raison de la nature phosphoreuse des minerais extraits au Creusot dont on ne prit conscience qu’au début du XIXème siècle. Louis Bergeron, Le Creusot. Une ville industrielle, un patrimoine glorieux, Paris, Belin-Herscher, 2001, p. 15 sq.
[9] Voie terrestre vers le Nord et Paris, voie d’eau vers le Sud par le Rhône et la Saône et terminus de la ligne de chemins de fer de Paris jusqu’en 1854. Les pièces fabriquées au Creusot étaient acheminées par le canal du Charolais, l’actuel canal du Centre. Les Chantiers débutèrent par la construction fluviale – navires de transport, remorqueurs, bateaux de dragage, navires coloniaux – puis fabriquèrent des torpilleurs pour la Royale et la Marine impériale japonaise, et enfin les premiers sous-marins à partir de 1908. Lucien Grandey, La construction navale aux Chantiers de Chalon-sur-Saône 1839-1957, Le Creusot, Académie François Bourdon, 2002.
[10] Il en déposa le brevet avant le mécanicien et astronome écossais, James Nasmyth (1808-1890).
[11] Contrairement à une légende tenace, ce n’est pas au Creusot que furent construites les premières locomotives en France. Celle de Marc Seguin fut essayée à Perrache au cours de l’automne 1829 et celles de François Cavé à Paris en 1837, un an avant le « Gironde » de Schneider. François Crouzet, « L’Industrie française des locomotives 1838-1914 », Revue d’Histoire économique et sociale, Vol. 55, n° 1/2, p. 121-123.
[12] Jean-Philippe Passaqui, La stratégie des Schneider. Du marché à la firme intégrée (1836-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.
[13] Agnès D’Angio, « La branche Travaux publics de Schneider et Cie : Naissance et développement (1895-1949) », Histoire, Économie & Société, 1995, 14-2, p. 331-343.
[14] Louis Bergeron, op. cit., p. 26-27.
[15] Marcel Massard, « Syndicalisme et milieu social (1900-1940) », Le Mouvement social, avril 1977, p. 24.
[16] Union des sociétés françaises d’Histoire naturelle, Société d’Histoire naturelle du Creusot, (Le Creusot, Versailles), 1936, p. 17. BNF.
[17] Travaux des sections – Section d’hygiène urbaine & rurale & de prévoyance sociale – Séance du 28 mai 1926. Discours prononcé en présence de Georges Risler, président du Musée social, Le Musée social, août 1927, p. 233-235.
[18] En outre, la guerre vint clore « la réflexion chaotique » menée par le gérant, Eugène Schneider, depuis le début du XXème siècle au sujet de la localisation de son entreprise et des productions qui devaient être conservées au Creusot. Jean-Philippe Passaqui, « Mobilisation des facteurs de production…, art. cit., p. 299-324.
[19] Dans les deux cas, Schneider profitait de l’expérience acquise par la maison Berthiot dans le cas de la SOM, et Étienne Bouhey, dans celui de la SOMUA.
[20] On en trouve une liste exhaustive dans le dossier d’instruction. AN Z/6NL/366. Voir aussi les nombreux textes mis en ligne par Pandor (Portail Archives Numériques et Données de la Recherche), outil créé par la MSH de Dijon. Voir aussi Claude Beaud, « Les Schneider marchands de canons (1870-1914) », Histoire, Économie & Société, 1995, n° 1, p. 107-131 et Hubert Bonin, La Banque de l’Union Parisienne (1874/1904-1974) De l’Europe aux Outre-Mers, Paris, Publications de la Société française d’histoire des outre-mers, 2011, p. 55.
[21] « Avec ses 120 hectares d’usines aux portes de Saint-Pétersbourg, ses 42 millions de capital, c’est vraiment le Creusot de la Russie », écrivait Francis Delaisi dans son pamphlet Le patriotisme des plaques blindées : l’affaire Poutiloff [Nîmes, 1913], p. 8.
[22] L’ancienne Société des Hauts-Fourneaux de Caen, créée en mai 1910, et dont les capitaux étaient alors à 80 % allemands, fut rapidement « emportée dans le tourbillon des polémiques technico-financières et des passions nationalistes ». Elle devint en 1924 la Société métallurgique de Normandie (SMN). Alain Leménorel, La SMN – Une forteresse ouvrière 1910-1993, Cabourg, Éditions Cahiers du Temps, 2005, p. 16 sq.
[23] Jean-Philippe Passaqui, « Mobilisation des facteurs de production… », art. cit.
[24] Lucien Grandey, La construction navale aux Chantiers de Chalon-sur-Saône op. cit., p. 24.
[25] Eugène II Schneider succéda à son père Henri, non seulement comme gérant de la société, mais encore dans les diverses fonctions électives occupées par ce dernier. Élu maire du Creusot en 1896, il abandonna son poste en 1900 pour se consacrer à ses affaires, mais demeura conseiller municipal jusqu’en 1919. Il fut également conseiller de Saône-et-Loire de 1898 à 1904 et député de la deuxième circonscription d’Autun jusqu’en 1910. Il présida par ailleurs la mission économique envoyée Outre-Atlantique en 1919, nommé membre de la commission interministérielle des experts chargée de préparer la conférence de Gênes (1922). Il fut élu en 1934 membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques). J. Reviron, « Monsieur Eugène Schneider (1868-1942) », Société éduenne, Mémoires de la Société éduenne, Dejussieu, Société éduenne, Autun, T. 49, 1944, p. 145-152.
[26] Georges Riguet « Un bastion du capitalisme – Le Creusot », Les Primaires, (Issy-les-Moulineaux), Société des amis de Régis Messac, 1933, p. 261-266.
[27] Le 4 décembre 1919, la Chambre des députés du Luxembourg autorisait la société Rhein-Elbe-Gelsenkirchener Berwerks AG à céder ses mines et usines à un groupement de sociétés luxembourgeoises, belges et françaises, la Société métallurgique des Terres rouges, qui était dotée d’un capital de 100 millions de francs. Le conseil d’administration, dans lequel figuraient notamment Henri Coqueugnot, alors chef du département de la Métallurgie de Schneider, Gaston Barbanson, président de l’ARBED, ou encore Henri de Wendel, était présidé par Eugène Schneider, maître de forges. On notera parmi les commissaires de la nouvelle société la présence de Jean-Louis Bach, docteur en droit, alors chef-adjoint du service général d’administration de Schneider. https://www.industrie.lu/SocieteMetallurgiqueTerres-Rouges.html
[28] Le CA de l’UEIF ne s’était quasiment pas modifié entre 1920, date de la fondation, et 1940. En voici la composition en 1935 : Eugène Schneider, président, Charles Sergent, vice-président, président de la Banque de l’union parisienne (BUP) ; administrateurs, Jean-Louis Bach, fondé de pouvoirs de Schneider et Cie ; Maurice Hottinguer, administrateur de la BUP, associé de la Banque Hottinguer et Cie ; le vice-amiral Lucien Lacaze, membre du conseil de surveillance de Schneider et Cie, grand-croix de la Légion d’honneur, ancien ministre ; Louis Lion, administrateur de la BUP, ingénieur en chef des Ponts et chaussées ; Frédéric Mallet, président honoraire de la BUP, associé de la Banque Mallet Frères et Cie ; Jacques de Neuflize, membre du conseil de surveillance de Schneider et Cie, associé à la Banque Neuflize et Cie (le baron de Neuflize était administrateur de la BUP) ; Maurice Paléologue, administrateur de la BUP, grand-officier de la Légion d’honneur, ambassadeur de France, membre de l’Académie française ; Armand de Rafélis, comte de Saint-Sauveur, André Vicaire et Ernest Weyl, administrateur de la Société générale d’entreprise. En 1940, Gabriel Brizon remplaça Charles Sergent à la vice-présidence tandis que Louis Lion, disparu en octobre 1939, et Frédéric Mallet ne faisaient plus partie du CA resserré. AGO du 23 juin 1930. Les Assemblées générales…, (Paris), 1930, p. 1091. « Les munitionnaires, danger national (suite du rapport de Félix Gouin, député, rédigé au nom de la Commission de la Législation civile) », Le Populaire, 3 juillet 1935. BNF. AG du 20 mai 1940. Archives de Paris (désormais ADP) 115 W 27 dossier Union européenne industrielle et financière.
[29] La BUP fut la banque la plus proche de Schneider entre les années 1910 et 1929 date à laquelle Schneider se rapprocha de la Banque des pays du Nord dont elle allait prendre le contrôle. Voir Hubert Bonin, La Banque de l’Union Parisienne… op. cit., p. 68, 162-163.
[30] Claude Beaud, « Une multinationale française au lendemain de la Première Guerre mondiale : Schneider et l’Union européenne industrielle et financière », Histoire, Économie et Société, Vol. 2, n° 4 (4ème trimestre 1983), p. 631. Voir aussi Agnès D’Angio, « Schneider et Cie face aux risques géopolitiques en Europe centrale et orientale (1918-1939) », Les Cahiers Irice, 2010/2 (n° 6), p. 35-59.
[31] Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics… op. cit., p. 13.
[32] Voir par exemple « Quelques vérités sur le bagne Schneider », L’Action syndicale – organe des travailleurs, 5 avril 1908, et trente-deux ans plus tard, l’encart de L’Humanité clandestine du 16 mai 1940 « Ceux qui profitent de la guerre ». Les Schneider étaient les « nouveaux princes du sang » de la « monarchie capitaliste ». Les Cahiers de la démocratie, juin 1936, p. 16. BNF.
[33] Paul Faure s’appuyait sur le fait que des dirigeants tchèques d’origine allemande de la Skoda, von Duschuitz et von Arthala, avaient été mentionnés par la presse (Le Journal) comme ayant financé le NSDAP. Et comme Schneider contrôlait alors la Skoda, il n’en fallut pas davantage pour que Le Combattant indépendant, bulletin trimestriel de l’Association indépendante des anciens combattants, n° 2, d’août 1932, écrivît en titre « La trahison des chefs », et en sous-titre « Comment M. Flandin, au service de l’Internationale des marchands de canons, sauva, avec l’argent du contribuable français l’Union parisienne, l’Union européenne et le groupe Schneider – Schneider finance Hitler et fournit de la poudre à l’artillerie allemande ». BNF. Sur le sujet voir Jean-Marie Moine, « La mythologie des ”marchands de canons” pendant l’entre-deux guerres », Dominique Pestre (dir.), Deux siècles d’histoire de l’armement en France : de Gribeauval à la force de frappe, Paris, Éditions du CNRS, coll. « CNRS histoire », 2005, p. 358 sq.
[34] « Les travailleurs du fer. III. Au Creusot chez Schneider. » Le Peuple, 15 juin 1936, p. 1-2. BNF.
[35] « Au Creusot, bastion du Comité des Forges », La France nouvelle, 27 septembre 1947, p. 16. BNF.
[36] Morgan Poggioli, « Le Creusot en 1936 : Le calme au milieu de la tempête », Les Cahiers d’ADIAMOS, ADIAMOS (1999-2003), 2007, Le mouvement ouvrier au Creusot au XXe siècle.
[37] « Les grèves de Saône-et-Loire », Courrier de Saône-et-Loire, 1er août 1936. Marcel Roy, secrétaire de la Fédération des Métaux, accusa Schneider du blocage de la situation à Chalon. « A Chalon-sur-Saône, l’intransigeance de M. Schneider prolonge des conflits », Le Populaire, 20 juillet 1936. BNF.
[38] Idem.
[39] Le Progrès de la Côte d’Or, jeudi 1er décembre 1938. BNF.
[40] Idem. Voir aussi une analyse de l’échec des grèves au Creusot dans « La CGT au Creusot », L’Express de Mulhouse, 22 avril 1938. BNF.
[41] Charles Prosper Eugène Schneider – dit Eugène II Schneider –, né au Creusot (Saône-et-Loire) le 29 octobre 1868, demeurant 34, Cours Albert-1er à Paris, gérant ayant la signature sociale.
[42] Henri Paul Antoine Eugène Marie Schneider (1895-1918).
[43] J. Reviron, « Monsieur Eugène Schneider (1868-1942) », Société éduenne, Mémoires de la Société éduenne, Dejussieu, Société éduenne, Autun, T. 49, 1944, p. 145-152.
[44] Jean Jules Marie Antoine Eugène Schneider, né le 28 août 1896 à Paris (8ème). A l’automne 1918, le sous-lieutenant Jean Schneider, du 21ème dragons, fut inscrit au tableau de la Légion d’honneur avec la citation suivante : « Pilote d’une rare énergie et d’un courage remarquable. Blessé grièvement au début d’un combat très dur, est revenu trois fois à l’attaque et a réussi à mettre hors de combat le mitrailleur ennemi, rentrant ensuite avec un appareil criblé de balles. A déjà abattu un avion ennemi. Deux citations. » En 1919, le lieutenant Jean Schneider, décoré de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre, épousa Françoise de Curel, fille du vicomte Paul de Curel et de la vicomtesse née de Guitaut. « Petit Carnet », Le Gaulois, mercredi 2 octobre 1918 et « Informations », L’Avenir d’Arcachon, dimanche 28 mars 1919. BNF.
[45] Charles Marie Bernard Henri Schneider, né le 28 juin 1898 à Paris (8ème), domicilié en 1946 1 rue de Vaulx à Marly-le-Roi (Seine-et-Oise), marié sous le régime de la séparation des biens avec Liliane Louise Volpert.
[46] On peut lire une analyse de l’arrêt dans Gaston Griolet, Félix Tournier, Dalloz. Jurisprudence générale, (Paris), 1927, p. 113-115. BNF.
[47] Préfecture de police – Direction de la police judiciaire – Délégations spéciales et judiciaires. Cabinet de M. Perez y Jorba. Exécution de la commission rogatoire, 5 juin 1946. AN Z/6NL/366 f° 26.
[48] Suivant Henri Faucillon qui la dirigeait depuis 1930, « La division métallurgie (était) chargée de la vente des produits laminés en aciers de toutes qualités (barres et tôles), fabriqués par l’usine du Creusot, ainsi que des produits filés et étirés, en alliage de métaux non ferreux (cuivres, laitons, alliages légers), fabriqués par l’usine de Bordeaux. Déposition du 22 juin 1946 devant le commissaire Perez y Jorba. AN Z/6NL/366 f° 18.
[49] Armand Eugène Guillaume Étienne Marie de Rafélis, comte de Saint-Sauveur, né le 11 mai 1879 à Paris (7ème), décédé le 24 novembre 1969, fils de Paul de Rafélis, marquis de Saint-Sauveur (1839-1894), et de Henriette de Gontaut-Biron (1851-1933), officier de réserve, chevalier de la Légion d’honneur (janvier 1919 au titre du ministère des Affaires étrangères), marié le 9 novembre 1905 à Germaine-Jeanne Aron de Faucompré, demeurant à la Libération 71, avenue Foch Paris (16ème). Administrateur de nombreuses sociétés dont la Banque franco-japonaise. A noter que son fils, le comte Paul de Saint-Sauveur épousa en avril 1935 Jacqueline Citroën, fille d’André Citroën. Le Petit Parisien, 22 janvier 1919, p. 2 et La Presse, 19 avril 1935. BNF.
[50] Marie Jules André Vicaire, né le 22 décembre 1876 à Paris (6ème), fils de Joseph Marie Hector Eugène Vicaire et de Marie Thérèse Joséphine Marguerite Roger, domicilié 1, rue de l’Alboni à Paris (16ème). Élève de l’Ecole polytechnique (promotion 1896, entré classé major et sorti classé 4 sur 217 élèves) et de l’École des Mines (entré en 1899 et sorti classé 4 sur 5 élèves), directeur technique de la Compagnie des chemins de fer de l’Est puis du PLM, secrétaire général de la Société des Forges et aciéries de Huta-Bankowa, directeur-général de Schneider de 1930 à 1948, membre du comité consultatif des Mines dépendant du ministère des Travaux publics (1938-1939). JO du 28 novembre 1938. BNF. André Thépot, Les ingénieurs des mines du XIXème siècle – histoire d’un corps technique d’État, Paris, Éditions ESKA, 1998, p. 329.
[51] Maurice Nicolas, polytechnicien, ingénieur maritime de 1926 à 1935, était venu des Travaux publics avec un détour par l’industrie aéronautique chez Dewoitine où il avait négocié les grèves de 1936. Voir Philippe Caila, « Déconstruction d’une stratégie : la Compagnie industrielle de travaux (1949-1972) », Histoire, économie & société, année 1995, 14/2, p. 353-354.
[52] Albert Louis Litzellmann, né le 25 novembre 1880 à Lausanne (Suisse), décédé le 31 mai 1960 à Paris (6ème). Il est mentionné comme chef du secrétariat général de Schneider en 1926. Voir Association républicaine de rénovation nationale, L’Association républicaine de rénovation nationale et le club de renaissance française, leur rôle, les services qu’ils ont rendus et qu’ils continuent à rendre, (Paris), 1926, p. 34. La même année, il fit partie du conseil de la Société pour la construction d’avions métalliques (Avimeta) qui venait de se constituer. « Dans l’Industrie », L’Auto, 10 juillet 1926. En février 1914, nous retrouvons la trace d’Albert Litzellmann, comme officier de la marine marchande et, plus précisément, comme lieutenant du navire Eugène Schneider. L’Ouest-Éclair, 20 février 1914. BNF. Au début des années trente, il communiqua à Robert de La Baume « à titre strictement confidentiel » des « Informations sur les missions d’achat soviétiques Stern et Simonov ». Cet épisode doit être replacé dans le contexte du rapprochement germano-soviétique contre lequel Edouard Daladier tentait de lutter, ainsi que du passif russo-soviétique de Schneider. Le 31 décembre 1932, Édouard Daladier intervint auprès d’Armand de Saint-Sauveur qui s’opposait à la cession de tout matériel aux Soviétiques. Voir Centre d’études d’histoire de la Défense, Histoire des rapports politico-stratégiques, Cahier n° 3, 1997, notes 17 et 24.
[53] Albert Charles Marie Joseph de Boissieu, né le 13 décembre 1896 à Chambéry (Savoie), décédé le 14 janvier 1961 à Paris, marié le 5 décembre 1923 avec Juliette de Durfort Civrac de Lorge (1899-1946), Croix de guerre 14-18, commandeur de la Légion d’honneur, demeurant à la Libération 12 bis, avenue Bosquet à Paris (7ème). En décembre 1914, alors qu’il était encore en Prépa 2ème année, math spé, il arrêta ses études et s’engagea dans l’Armée. Dirigé sur Valence en Mars 1915 où se tenait un cours d’élèves officiers, il continua son entraînement à Fontainebleau et fut affecté en janvier 1916 en tant que sous-officier au 2ème Régiment d’Artillerie stationné au nord de Nancy. En juillet, il fut nommé sous-lieutenant, affecté au sud de Verdun, puis envoyé en Champagne en mars 1917 et dans la Somme en septembre. Deux mois plus tard, il retourna en Champagne avec un régiment américain de New York dirigé par le Colonel Pickering, participa en avril 1918 sous les ordres du général Gouraud à la troisième bataille de Champagne, puis à l’offensive Mangin de juin 1918. Lors d’une reconnaissance des positions d’artilleries près de Rethel, il fut blessé par un éclat d’obus à la jambe. Le 25 octobre suivant, son frère Antoine fut tué en menant son escouade à l’assaut. Polytechnicien, licencié en Lettres, il entra à l’Inspection des Finances en 1922. En 1930, il intégra le groupe Schneider comme directeur-général adjoint de l’Union européenne industrielle et financière. Directeur de Schneider en 1937, mobilisé au mouvement général des Fonds pendant la drôle de guerre, il devint président de l’Union européenne en 1940. Après la guerre, il fut notamment président de la Banque Vernes, de la Banque Hottinguer et gérant du groupe Schneider (1960). En 1968, il succéda à Albin Chalandon à la présidence de la Banque commerciale de Paris, banque d’affaires contrôlée par le groupe Dassault. Henri Queuille, Journal de guerre – 7 septembre 1939-8 juin 1940, Texte annoté et présenté par Isabel Boussard, Fondation nationale des Sciences politiques, Limoges, Presses de l’université de Limoges, 1993, p. 170 note 37. Le Monde du 7 juin 1968. Luc Rouban, « Le pantouflage au XIXème et XXème siècle », Fabien Cardoni, Nathalie Carré de Malberg, Michel Margairaz dir., Dictionnaire historique des inspecteurs des Finances, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Vincennes, 2012, p. 307-317. Hervé Joly, Diriger une grande entreprise au XXème siècle – L’élite industrielle française, Préface de Patrick Fridenson, Tours, PUFR, 2013. Maxime de Ladoucette, « Mon arrière-grand-père Albert de Boissieu » (texte en ligne). Son dossier administratif, consultable sous dérogation, se trouve sous la cote SAEF 1C-0034820/1 bien que les dates extrêmes ne correspondent pas (non consulté par nous).
[54] Il put sans doute y côtoyer un autre polytechnicien, ingénieur des Mines, son aîné Aimé Lepercq, représentant l’UEIF en Tchécoslovaquie de 1923 à 1929, administrateur de la Skoda et futur ministre du gouvernement provisoire de la République française.
[55] Assemblée générale annuelle du 6 octobre 1941. Rapport au conseil d’administration. ADP 115 W 27 dossier 167 [ancienne cote Perotin 3314/71/1 6ème comité] – L’Union européenne industrielle et financière.
[56] Louis Victor Benezit, né le 24 janvier 1882 à Antrain-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), décédé le 25 juin 1946. Marié le 19 juin 1912 à Paris (6ème) avec Yvonne Oger du Rocher. Il obtint le 3ème accessit en dissertation française au lycée de Chartres (1898), les 2ème accessit de Mathématique et 4ème accessit en Physique Chimie au lycée Condorcet (1899), admis au concours de l’École Polytechnique (13ème sur 250) en 1900, nommé sous-lieutenant de réserve du Génie, classé au 1er régiment 25ème bataillon à Versailles, élève-ingénieur de 3ème classe au corps des Ponts et chaussées à dater du 1er octobre 1902, ingénieur chargé de la résidence de Vannes, à dater du 16 juin 1906, ingénieur ordinaire à Dieppe (1910-1911), puis en Seine-et-Marne (1913), nommé ingénieur en chef de 2ème classe pour prendre rang à dater du 1er septembre 1919. Mis en disponibilité sans traitement pour convenances personnelles avec autorisation d’entrer à la Société des forces motrices de Chancy-Pougny (arrêté du 4 octobre 1921). Victor Benezit reçut l’ordre du Mérite de 2ème classe lors de l’inauguration du port franc de Budapest en 1928. JORF, 30 juillet 1898, p. 4761 ; 29 juillet 1899, p. 5131 ; 3 octobre 1900, p. 6529 ; 11 septembre et 18 octobre 1902, p. 610 et 6797 ; 21 juin 1906 p. 4210 ; 3 avril 1908, p. 2356 ; 13 novembre 1913, p. 9942 ; 11 août 1919 p. 8483 ; 6 octobre 1921, p. 11509. Le Temps, 18 novembre 1929, p. 2. BNF.
[57] Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics… op. cit., p. 235, 250. Voir l’analyse et le compte rendu de l’approche de Victor Benezit sur les digues maritimes après le concours remporté par la DTP pour la jetée d’Alger dans « Résistance des matériaux ». Le Génie civil, 1er mars 1924, p. 219, et « La jetée de Mustapha au port d’Alger », Idem, 29 février 1936, p. 206 sq. En 1912, alors qu’il était ingénieur des Ponts et chaussées dans le Morbihan, Victor Benezit avait travaillé au pont de La Roche-Bernard. Le Génie civil, 10 novembre 1912, p. 46-47. BNF. « In 1923, Victor Benezit introduced a method that was the first to consider the effects of standing waves, or clapotis, on a vertical wall », American Society of Civil Engineers, Proceedings of the ASCE, 1951, p. 8. Victor Benezit fut aussi président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de constructions métalliques de France (avant 1937).
[58] [Union coloniale française], Congrès de l’outillage économique colonial et des communications (20-25 juillet 1931)…, (Paris), 1931, p. 39 et « Les travaux du port de Casablanca », Le Ciment, son emploi et ses applications nouvelles en France, journal mensuel, mai 1922, p. 161. Avec Eugène Schneider et plusieurs officiels, Victor Benezit accueillit d’ailleurs le sultan du Maroc au Creusot le 30 juillet 1926. « Le Sultan du Maroc en Saône-et-Loire », Courrier de Saône-et-Loire, 1er août 1926. Victor Benezit remplaça Laroche au CA de la Compagnie marocaine. Les Assemblées générales, Compagnie marocaine – AGO du 16 décembre 1936, p. 179. BNF.
[59] En plus de Schneider, de l’UEIF et de la BUP figuraient entre autres parmi les premiers souscripteurs MM. de Neuflize et Cie, la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez et la Société des Forges et aciéries de Huta-Bankowa. « Pologne – L’expansion oligarchique française », Les documents politiques, diplomatiques et financiers, (Paris), avril 1931, p. 340.
[60] Le Génie civil, 6 avril 1935. BNF.
[61] François Marie André Athanaze baron Walckenaer, né le 10 juillet 1889 au Pecq (Seine-et-Oise), décédé le 24 décembre 1981 à Paris, polytechnicien (1908), ingénieur des Mines, marié en 1919 à Marie Chabert. Sous-lieutenant au 32ème Régiment d’Artillerie, il devint lieutenant en 1915, entra dans l’Aviation à l’escadrille MF 36, officier de la Légion d’honneur en 1916 pour ses états de service : « Excellent observateur, ayant fait plus de 200 heures de vol sur les lignes ennemies. A pris part à plusieurs bombardements de nuit effectués à faible hauteur. S’est particulièrement distingué lors des reconnaissances des 29 juillet et 25 septembre 1915, au cours desquelles il a obligé un appareil allemand à rentrer dans ses lignes. A participé, le 12 mars 1916, à un combat contre un avion ennemi, qui est tombé dans les lignes allemandes à 500 m de nos tranchées. Déjà cité trois fois à l’ordre. » François Walckenaer était en 1936 membre de la commission consultative des fabrications de guerre à la mobilisation et, plus précisément, de la sous-commission des fontes et produits sidérurgiques (en remplacement d’André Vicaire), et de la sous-commission des fabrications mécaniques. Il fut nommé en janvier 1941 membre du comité d’organisation des industries de la Grosse forge et du gros emboutissage. N° 132 – Extrait du JORF – Dimanche 14 mai 1916, L’Aérophile, 1er juin 1916. Bulletin de la Chambre de commerce de Paris, 11 juin 1936, p. 706. Annales du collège Stanislas, 1904, p. 209-210 ; L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er mars 1924, p. 110. Fédération sportive et culturelle de France, Les jeunes – courrier de quinzaine du journal « Le Patronage », 1er janvier 1933, p. 8. L’Ouest-Éclair, 15 janvier 1941. BNF.
[62] Membre de l’Automobile club de France (ACF) dont il présida la commission historique en 1933, Charles-Guillaume Walkenaer participa notamment aux règlements internationaux sur la circulation routière au sein de la SDN. En 1901, il était chargé du service de la surveillance des machines à vapeur, professeur de machines à l’École nationale des ponts et chaussées et membre de la Commission centrale des machines à vapeur. Lorsqu’il était encore ingénieur en chef du service des Mines de la Seine et chef du Service des Automobiles au ministère des Travaux publics, il avait contribué à déterminer la puissance des moteurs pour leur évaluation fiscale. Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 27 février 1901, L’Écho des mines et de la métallurgie, des 23 juin 1898 p. 3941 et 9 janvier 1911, p. 32. La Revue commerciale automobile, 25 janvier 1913, p. 25 et Bulletin officiel – ACF, janvier 1933 BNF.
[63] Le lieutenant Charles Walckenaer, du 18ème dragons, fut tué à l’ennemi le 6 octobre 1914. A ses obsèques, conduites par son père, étaient également présents son frère Bernard et son oncle Luuyt, ingénieur en chef adjoint à la direction des chemins de fer du PLM. Le Figaro, mardi 13 octobre 1914. BNF.
[64] Simon Charles Timoléon Pierre de Cossé, comte puis 12ème duc de Brissac, né le 13 mars 1900 à Paris 8ème, fils de Anne Marie Timoléon François de Cossé-Brissac, et de Mathilde Renée de Crussol d’Uzès.
[65] Préfecture de police – Commissariat de police du quartier des Champs-Élysées, l’inspecteur (illisible), 16 janvier 1946. AN Z/6NL/28 dossier 269. Ministère public c/Antoine Castellani, Jean-Louis Bach, André Vicaire et alii (Société d’optique et de mécanique de haute-précision) f° 122. Pour l’appréciation allemande, voir infra.
[66] Howard Horace, comte d’Angerville dir., Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, (Paris), 1913, p. 210 sq.
[67] AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW).
[68] Préfecture de police – Direction de la police judiciaire – Cabinet de M. Perez y Jorba, Rapport de l’inspecteur Allard, 27 novembre 1945 et Le Matériel électrique SW – Historique succinct, s. n. s.d. AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 5 et 9. Louis Bergeron, op. cit., p. 21.
[69] Ce fut également le cas de Pierre Nectoux, autre Creusotin, chef de la Comptabilité ; Joseph Lambret, secrétaire du conseil d’administration chargé du personnel et des questions sociales. Voir leurs dépositions respectives faites devant le commissaire Perez y Jorba, les 23 et 24 janvier 1946. AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 14-15 et 17 à 19.
[12] Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d., p. 21 et Rapport du 16 avril, T. IV p. 378-279. AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 43.
[71] Charles Louis Delarue-Caron de Beaumarchais, né le 19 janvier 1882 à Tours (Indre-et-Loire), élève du collège Stanislas et de l’École polytechnique (1900), décédé le 31 août 1964, fils de Raoul André Édouard Delarue-Caron de Beaumarchais, colonel de cavalerie (1839-1900) et de Caroline Etcheverry (1849-1915), marié le 7 novembre 1908 à Paris (7ème) avec Juliette Laudet (1889-1979), demeurant depuis au moins 1924 au 8, rue Pierre 1er de Serbie à Paris (8ème), puis 3, rue Octave-Feuillet. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise avec son illustre aïeul Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais et d’autres membres de sa famille.
[72] Fernand Cordier, né le 6 février 1875, administrateur de la Société provinciale de distribution d’énergie et de la Société civile d’études hydroélectriques en 1946.
[73] L’ingénieur de Westinghouse John Recknagel, n’entrant comme administrateur que le 26 septembre 1945.
[74] Déposition d’Armand de Saint-Sauveur du 5 juin 1945 devant le juge Martin. Ministère public/Antoine Castellani, Jean-Louis Bach, André Vicaire et alii (Société d’optique et de mécanique de haute-précision). AN Z/6NL/28 dossier 269 f° 69.
[75] Jean-Louis Bach, né le 6 août 1883 à Tulle (Corrèze), fils de Joseph Bach et de Marthe Lavielle, classe 1903, chevalier de la Légion d’honneur.
[76] Déposition du 29 juin 1945. Ministère public/Antoine Castellani, Jean-Louis Bach, André Vicaire et alii (Société d’optique et de mécanique de haute-précision). AN Z/6NL/28 dossier 269 f° 81.
[77] Jean Carron, né le 27 novembre 1875.
[78] Il ne la mentionne pas dans sa déposition mais nous savons qu’il était président de la Société provinciale d’entreprises en 1946.
[79] Déposition du 29 juin 1945 devant le juge Marcel Martin. AN Z/6NL/28 dossier 269 (…) f° 82.
[80] Georges Fontaine, né le 19 août 1879 à Saint-Joire (Meuse), fils de Jean Charles Fontaine et d’Adrienne Aubry, classe 1899, colonel d’artillerie retraité, officier de la Légion d’Honneur. Cour de justice du département de la Seine. PV de 1ère comparution, 18 décembre 1945. Idem.
[81] Préfecture de police. Direction de la police judiciaire. Rapport, Paris, 13 octobre 1945. Ministère public c/x (Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie – SOMUA). AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 43 sq et http://www.symogih.org/resource/CoAc8920
[82] Jean Albert Pérony, né le 24 août 1876 à Forges Allechamps (Cher), demeurant à la Libération 27, boulevard Beauséjour à Paris (16ème).
[83] Paul Louis Émile Delahousse, né le 10 mars 1894 à Paris, demeurant 42, rue d’Anjou à Paris (8ème).
[84] Henri Paul Louis Camille de Saulces de Freycinet, né le 18 septembre 1857 à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), fils du contre-amiral Charles Henri Auguste de Saulces de Freycinet (1823-1881) et de Stéphanie Clémence Camille Garnier de La Boissière (1833-1910), marié en octobre 1890 à Louise Pinel (1863-1927), capitaine de frégate (1899), demeurait 42, rue de Lisbonne à Paris (8ème).
[85] Léon Félix Alexandre Jean de Laborde, né le 27 avril 1877 à Paris, demeurant 9, rue de Lille à Paris (7ème).
[86] SOMUA à Robert Israël, Saint-Ouen, 29 septembre 1947. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 507 sq.
[87] Ministère de l’Intérieur. Direction générale de la sûreté nationale. Rapport de l’inspecteur de police judiciaire Louis Frédéric de Chabannes, Dijon, 9 avril 1949. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 908.
[88] Note sur la fabrication des chars SOMUA et les plans de ces chars, 3 p. s. n, s. d. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 686.
[89] Note sur les activités de SOMUA de 1935 à la Libération. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 417.
[90] Direction générale de la sûreté nationale. PV du 16 mars 1949. Audition de Henri Victor Jungblutt. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 904 et « Passé industriel de l’usine de Montzeron à Toutry (21) » sur le site « petit patrimoine : http://petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=21642_8&liste_pp=pm
[91] Ministère de l’Intérieur. Direction générale de la sûreté nationale. Rapport de l’inspecteur de police judiciaire Louis Frédéric de Chabannes, Dijon, 9 avril 1949. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 908.
[92] Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 1939. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 216.
[93] Le P-DG de la SOMUA à Robert Israël, expert-comptable, Saint-Ouen, 30 novembre 1947. Ministère public c/x (SOMUA). AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 748.
[94] Note sur les activités de SOMUA de 1935 à la Libération. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 417.
[95] Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire du 20 octobre 1941. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 223.
[96] Voir Claude Beaud, « Une multinationale française au lendemain de la Première Guerre mondiale… », art. cit., p. 631.
[97] Note de renseignements sur les chars prototypes et plans de fabrication SOMUA saisis par les Allemands en 1940, s. n., s. d., 25 p. et Ministère de la Guerre – Direction des études et fabrications d’Armement – Service du Contentieux, à Robert Israël, expert-comptable, 11 août 1947. AN Z/6NL/641 dossier 15609. Ministère public c/x (SOMUA) f° 935 sq. et f° 703.
[98] Note de renseignements sur les chars prototypes et plans de fabrication SOMUA saisis par les Allemands en 1940, s. n., s. d., 25 p. et Ministère de la Guerre – Direction des études et fabrications d’Armement – Service du Contentieux, à Robert Israël, expert-comptable, 11 août 1947. AN Z/6NL/641 dossier 15609. Ministère public c/x (SOMUA) f° 935 sq. et f° 703.
[99] Note du 26 juin 1946, s. n. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 21-22.
[100] Louis Bergeron, Le Creusot. Une ville industrielle, un patrimoine glorieux, Paris, Belin-Herscher, 2001, p. 21 et http://www.apremont-sur-allier.com/fr/mieux-connaitre-apremont/le-chateau/. L’un des marquis de Saint-Sauveur fut maire d’Apremont en 1871. Le château du XIVème siècle avait été mis en adjudication dès 1892. Voir Le Figaro, 11 juillet 1892, p. 3 et Monographie d’une famille militaire de l’ancienne France – Famille du Verne, T. 4, Nevers, Mazeron Frères, 1902-1903, p. 80.
[101] Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 40-41. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659.
[102] SOMUA à M. Robert Israël, 30 septembre 1947. Idem, f° 700.
[103] Jacques André Marie Cheysson, né le 7 octobre 1888. A ne pas confondre avec Pierre Cheysson, administrateur de l’UEIF.
[104] Le polytechnicien Paul Joseph Chaleil (X, 1894), chevalier de la Légion d’honneur, décoré de la Croix de guerre, avait intégré en 1903, lors de sa création, la Société pour l’exploitation des brevets Rateau à la demande du fondateur de l’entreprise, lui-même polytechnicien. Il en fut administrateur et directeur-général, puis vice-président à la mort d’Auguste Rateau en 1930, la société étant présidée par Léon Guillet, membre de l’Institut et directeur de l’École centrale des arts et manufactures. Trois ans plus tard, Paul Chaleil reçut la médaille d’honneur du Travail pour les 30 années passées au service de cette société. Il faisait alors partie du comité de direction de l’entreprise avec Marcel Champin, de la banque Mirabaud, et André Dupont. En 1930, il intégra également le conseil d’administration de la SA des Ateliers et chantiers de Bretagne, en raison des liens de collaboration technique et industrielle qui unissaient cette entreprise et la société Rateau. Vice-président puis président du Syndicat des industries mécaniques de France, président du Groupe des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne (GIM) de 1936 à 1940, il fut à ce titre l’un des signataires du contrat collectif de la Métallurgie de 1936, et fut désigné le 30 août 1937 délégué de la section Métallurgie du comité d’enquête sur la production française avec Lambert-Ribot, Davezac pour le patronat, Chevalme, Semat et Roy pour la CGT. Le 28 janvier 1940, il présida, en présence de Raoul Dautry, de Fernand Gentin, ministre du Commerce, du général Héring, gouverneur militaire de Paris, et de Pierre Guinand, président de la SNCF, au siège du syndicat des Industries mécaniques de France, 11 avenue Hoche, à la séance de projection du film documentaire de Paul Joyeux « La Mécanique française, synthèse de toutes les industries mécaniques », qui avait été tourné l’année précédente dans le cadre du centenaire du syndicat patronal. Paul Chaleil avait été admis à l’Aéro-club de France le 11 juin 1931 en même temps que l’industriel Edgar Brandt. Victime, avec l’une de ses filles, Marcelle, du bombardement aérien sur Cerdon (Loiret), le 16 juin 1940 [il ne fut donc pas tué sur la route le 12 juin comme l’écrit l’auteur de la note de 1949 sur les prototypes SOMUA], il fut remplacé à la tête de l’UIMM par Jules Quantin, dirigeant de la Société de constructions mécaniques de Stains. Voir Le Temps des 25 février 1917, 27 octobre 1930 et 12 septembre 1940. L’Aéronautique, revue mensuelle illustrée, vol. 12, n° 128 à 129, 1930, p. 110. Le Génie civil, 24 janvier 1931, T. XCVIII n° 4, p. 104. L’Aérophile, 15 septembre 1931, p. 285. Les Assemblées générales, 7 juillet 1934, p. 1213-1215. Le Travailleur parisien, avril-mai-juin 1936, p. 1154. La Voix du Peuple, août-septembre 1937, p. 598. L’Intransigeant, 29 janvier 1940 L’Auto-Vélo du 18 octobre 1940. Bulletin de la Chambre de commerce de Paris, 5 décembre 1936, p. 1027-1029. BNF. Danièle Fraboulet, Quand les patrons s’organisent – Stratégies et pratiques de l’Union des industries métallurgiques et minières 1901-1950, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2007, p. 103-104. Idem, « Auguste Rateau 1863-1930 », Jean-Claude Daumas dir., Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010, p. 578-580. Gérard Michel Thermeau, « Auguste Rateau, maître de la construction mécanique », publié le 23 octobre 2016. http://www.annales.org/archives/x/rateau.html#thermeau.
[105] SOMUA à M. Robert Israël, 30 septembre 1947 et Note de renseignements sur les chars prototypes… p. 11. AN Z/6NL/641 dossier 15609, f° 700 sq.
[106] Idem, p 6. Un autre document parle de 700 tonnes.
[107] Jean-Baptiste Dumay, né le 21 juillet 1891 au Creusot (Saône-et-Loire), était domicilié depuis de nombreuses années 45, rue Pitzelin à Épinay-sur-Seine. Ancien de Schneider où il était entré en 1907, il rejoignit en 1920 la SOMUA où il occupa le poste de chef de la comptabilité industrielle puis celui de chef des services administratifs. Avec 11 autres personnes, il dut quitter l’entreprise en octobre 1944 devant la menace d’une grève lancée par une partie du personnel ouvrier qui lui reprochait d’avoir collaboré avec les Allemands. Il fut alors employé par Schneider en qualité d’adjoint au chef du service financier. Préfecture de police. Direction de la police judiciaire. Rapport, Paris, 13 octobre 1945. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 43 sq.
[108] Une fois sa mission d’évacuation remplie, le mercredi 12 juin, Dumay rejoignit Pérony à Montzeron par Toutry. SOMUA à M. Robert Israël, 30 septembre 1947, f° 700 sq.
[109] En outre le S-40 n’avait pas encore été muni de sa tourelle. Cour de justice de la Seine. Exposé, 21 juin 1949, le commissaire du gouvernement (illisible). Ministère public c/x (SOMUA) AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 992. La destruction incomplète des plans en juin 1940 et le fait que les prototypes de chars furent évacués avant d’être livrés aux Allemands dans des circonstances obscures en 1941, furent reprochés à l’entreprise lors de l’épuration. La « Note de renseignements sur les chars prototypes et plans de fabrication SOMUA saisis par les Allemands en 1940 », s. n., s. d. 25 p., transmise par le ministère de la Guerre au juge d’instruction en 1949, fut déterminante pour évaluer la responsabilité de l’entreprise sur ce point. Jean Pérony déclara qu’il n’avait pas assisté à la réunion présidée par Rochette avec lequel il avait eu un entretien particulier le matin même, et que par conséquent, il n’avait pas entendu les consignes données à cet égard. Idem f° 935 sq.
[110] Philippe Papon, Mémoires d’un maquisard – Le groupe Phiphi, Préface et notes historiques de Dominique Richard, (Bordeaux), Éditions Sud-Ouest – Références, 2014.
[111] Le P-DG de la SOMUA à Robert Israël, expert-comptable, Saint-Ouen, 30 novembre 1947. AN Z/6NL/641 dossier 15609, f° 748.
[112] Note sur les activités de SOMUA de 1935 à la Libération. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 417.
[113] Les Chantiers de Chalon furent occupés le même jour.
[114] Note du 27 juin 1946, s. n. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 f° 21. Calendrier des relations avec les autorités allemandes, [texte manuscrit] s. n., s. d. AFB 01MDL040-16. Une note du même fond donne le chiffre de 12 639 pour juin 1940. [Note sans titre, ndr], s. n., 25 mars 1950. AFB 01L0122-05.
[138] Le Generalingenieur Günther Tschersich (1899-1953), faisait partie avec Ploch et Reidenbach du groupe d’ingénieurs proches du GL qui allaient s’attirer les foudres de Göring après le suicide de Udet. Mais Tschersich avait été limogé par Göring dès le 9 septembre 1941. Cajus Bekker, Angriffshöe 4000. Die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, München, Wilhelm Heyne Verlag, 1976, p. 252 [Rééd. de Ibid. Angriffshöhe 4000, Gerhard Stalling Verlag, 1964]. Richard Suchenwirth, Command and Leadership in the German Air Force, University Press of the Pacific, 2005 [rééd. de Ibid., USAF Historical Division, Aerospace Studies Institute, Harry R. Fletcher, july 1969]. Karl Heinz Roth, Michael Schmit, Die Daimler-Benz AG 1916-1948, Schlüsseldokumente zur Konzerngeschichte, Hambourg 1987, p. 416. Horst Boog, Gerhard Krebs, Detlef Vogel, Germany and the Second World War. Edited by Militärgeschichtliches Forschungsamt (Research Institute for Military History), vol. VII. The strategic Air war in Europe and the War in the West and East Asia, 1943-1944/5, Clarendon Press, Oxford, 2006, p. 173.
[115] La direction de l’entreprise dut utiliser un bâtiment plus modeste, l’hôtel des Voyageurs, lorsqu’elle souhaitait accueillir des visiteurs sous l’Occupation.
[116] [Note sans titre qui répondait à une accusation portée contre la direction Schneider par un certain B., ndr], s. n., 25 mars 1950. AFB 01L0122-05.
[117] Déposition d’Abel Borel, 24 juin 1946. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 15.
[118] La Feldkommandantur s’installa le 11 juillet sous les ordres de l’Oberst Jahn.
[119] Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 41-42. AN Z/6NL/366 dossier 8659.
[120] La liaison avec les forces hydrauliques fut rétablie par les troupes d’occupation dès le 25 juin.
[121] Il s’agit très certainement de l’Hauptmann Dipl. Ing. [capitaine, ingénieur diplômé] Varenhorst (grade au 3 janvier 1939), du Waffenabteilung (Wa J Rü 2) [Service des Armes], dirigé en 1939 par l’Abteilungschef Oberst Dipl. Ing. Hillert, de l’OKH D – Heereswaffenamt (Wa A) [Département de l’Armement de l’Armée] Amtsgruppe für Industrielle Rüstung (Wa J Rü) [Groupe de l’Office de l’armement industriel], dirigé par le Generalmajor Stud. Source : http://gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com/2009/11/
[122] Un AOK [Armee-Oberkommando – Haut-commandement de l’Armée], dirigeait plusieurs corps d’armée et disposait de ses propres troupes, par exemple l’artillerie lourde, le génie et d’autres forces spéciales, qui étaient placées sous son commandement en fonction de la disponibilité et de la mission. L’AOK servait de moyen de commandement entre le groupe d’armée et le corps d’armée. Cependant, la demande et la distribution des fournitures étaient généralement traitées directement par le chef de l’état-major de l’AOK ; le commandement du groupe d’armées n’intervenait que dans les situations de crise.
[123] CM = atelier de Mécanique dans la terminologie du Creusot.
[124] Appelée également dans le texte « mission Schubert », très certainement d’après le nom du chef de l’Inspection de l’Armement (Rü-In).
[125] Wilhelm Ritter von Leeb (1876-1956) fut promu Generalfeldmarschall six jours plus tard avec 11 autres généraux de la Wehrmacht.
[126] On peut lire dans le Journal de guerre de la Rü-In à la date du 9 juillet : « Une Commission mixte du Haut commandement de la Marine de Guerre et du Ministère de l’Armement de l’Armée de Terre a présenté les besoins suivants en machines : a) 20 machines spéciales pour les fabrications d’obus parmi les plus lourds. b) 20 autres machines spéciales pour les fabrications d’obus lourds. c) Quelques machines spéciales pour la fabrication de pièces d’artillerie et de torpilles. d) 10 à 15 machines pour la fabrication de bombes, parmi les plus lourdes. La commission est actuellement en voyage de prospection pour trois jours auprès des usines Schneider-Le Creusot » Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion Paris. Begonnen 20.6.40. BA-MA RW24/54.
[127] Il s’agit de responsables de la Rü-In C (France Nord-Est). L’Oberstleutnant comte Vitzthum von Eckstaedt, qui avait été responsable du Rüstungskommando (Rü-Kdo) de Leipzig avant-guerre et avait commandé le Rü-Kdo de Charleroi pendant le Blitz, fut nommé le 24 juillet 1940 avec effet immédiat Inspecteur de la Rüstungsinspektion France Nord-Est laquelle avait son siège à Dijon. Le Major von Sybel était commandant du Rü-Kdo de Dijon.
[128] Il est vrai que l’avancée victorieuse vers Dunkerque, après la percée de Sedan, avait été effectuée suite à l’acte de désobéissance célèbre du général Heinz Guderian, qui commandait sous les ordres de Kleist le 19ème corps d’Armée motorisé.
[129] La RMB est née en 1935 de la fusion de la Rheinische Metallwaren und Maschinenfabrik (fondée en 1889) et de la A. Borsig Maschinenfabrik (fondée en 1837). En 1938, la société transféra son siège social de Düsseldorf à Berlin. L’entreprise fabriquait des chaudières, des centrales électriques, des turbines et des machines à vapeur, des usines de produits chimiques, des pièces pour automobiles, des machines de bureau, y compris des machines à calculer, et des articles en métal léger. Pendant la guerre, elle produisit tous les types d’armements lourds et de munitions. La Reichswerke AG für Erzbergbau u. Eisenhütten “Hermann Göring” en était l’actionnaire majoritaire. La direction était composée de Hellmuth Röhnert, président, vice-président du CA de la Reichswerke Hermann Göring ; de Wilibald Spielvogel, d’Eberhard Breuninger, de Hans Luce Herbert Pavel et du Dr Pr Carl Waninger. Dans le conseil d’administration figuraient un représentant du ministère des Finances (Dr Fritz Berger), de la Dresdner Bank (Dr Carl Rasche), de la Reichskredit Ges. AG (August Rohdewald), de la Deustsche Bank (Karl Kimich), les présidents de la Dynamit AG (Paul Müller) et de Knoll AG (Max Wessig), le General Georg Thomas, chef du département de l’économie de l’OKW et enfin le secrétaire d’État et président de la VIAG, Dr Ernst Tredelenburg. NARA. OMGUS. External Assets – General Records Pertaining to External Assets Investigation – Rheinmetall-Borsig, p. 1.
[130] Les archives Schneider se contentent de mentionner « deux ingénieurs civils ». C’est grâce aux archives allemandes que nous savons qu’il s’agit des dirigeants de Rheinmetall-Borsig, Spielvogel et Elsenberg. Ferngespräch [Appel téléphonique de] Anruf Oblt [Oberleutnant] Gerhardi bei [au] Major Worm, 3.7.1940. BA-MA RW/46/96.
[131] Il était l’un des directeurs de DEW en 1940 avec Wilhelm Hoffmann et les Dr Heinz Gehm, Konrad Morschele et Helmut Oehnke. Walter Rohland faisait également partie de plusieurs conseils d’administration dont celui de Henschel & Sohn, en tant que vice-président du Vereinigte Stahlwerke, aux côtés du président de cette société, Albert Vögler. Suivant le témoignage de Heinrich Bomke, dirigeant de la Hoesch AG de Dortmund, interrogé par les services financiers américains en 1946, la plupart des responsables de l’industrie devaient leurs fonctions à leur mérite, à l’exception de quelques personnalités comme Walter Rohland, sujet médiocre qui, d’après Bomke, devait son ascension aux liens nombreux et très étroits qu’il entretenait avec les hauts responsables du parti nazi et les cercles gouvernementaux. NARA. Washington Office, Special Funds Division Finance, Intelligence (WASH-SPDF-INT). Documents 3950-3970 p. 136. OMGUS. External Assets – General Records Pertaining to External Assets Investigation – Bomke, Heinrich Otto, p. 4. Idem – Henschel & Sohn, p. 5.
[132] Berlin-Anhaltische Maschinenbau Aktiengesellschaft (BAMAG). La Bamag-Meguin était le fruit de la fusion effectuée en 1924 entre la Bamag (fondée en 1872) et la Meguin AG – fondée en 1901, qui possédait des ateliers à Butzbach dans le district de Hessen. En 1927, le groupe Julius Pintsch KG, profitant des difficultés de cette entreprise concurrente, en fit l’acquisition, suivant un processus de concentration industrielle qui s’inscrivait dans la politique post-inflationniste des banques allemandes. En 1933, la Bamag-Meguin AG ne cessa de se développer. Elle agrandit son usine de Dessau et fit de son usine de Butzbach une filiale sous le nom de Butzbach Werke für Eisenverarbeitung AG dotée d’un capital social de 1 million de RM. La filiale, qui fabriquait des plaques tournantes, des aiguillages, des grues, des installations de charbon de locomotives, contribua à une nouvelle extension des intérêts ferroviaires du groupe. L’activité la plus importante de Pintsch était la fabrication d’installations d’usines à gaz et d’appareils à gaz de tous types. Il était l’un des plus importants fabricants de lampes à basse tension d’Allemagne. Un autre élément très important de la production de Pintsch était la fabrication de toutes sortes d’engrenages et de composants de transmission mécanique tels que des arbres, des poulies, des volants, des roulements, des embrayages, etc. pour lesquels l’usine du Bamag-Meguin à Dessau était l’un des plus grands producteurs individuels en Allemagne. Comme Schneider en France, le groupe Pintsch travaillait en étroite collaboration avec la Marine allemande à laquelle il avait fourni les premières mines navales et torpilles au XIXème siècle. A la tête du groupe, toujours contrôlé par la famille Pintsch, le Landrat Dr Otto Borman. NARA 1561456 – General Records, compiled 1945 – 1950 – Pintsch, Julius Complex – 2-251.
[133] Aktennotiz – über Fortsetzung der Wi Rü Besprechung bei Generallt. Barckhausen am 19.7.40. BA-MA. RW/46/96.
[134] Impliqué comme son cousin le comte von Stauffenberg dans l’attentat du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler, Caesar von Hofacker (1896-1944) fut exécuté à Plötzensee au mois de décembre suivant.
[135] Alexander von Falkenhausen (1878-1966) fut commandant de l’administration militaire en Belgique et dans le nord de la France du 22 mai 1940 au 15 juillet 1944.
[136] Voir Laurent Dingli, « Prises d’intérêts et réseau d’influence sous l’Occupation », laurentdingli.com, février 2017. Mise en ligne 22 février 2017. Dernière mise à jour : 19 octobre 2017.
[137] Streccius reçut le même jour le grade de General der Infanterie et, de ce fait, était uniquement subordonné au commandant militaire en France. « Lexikon der Wehrmacht » : http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/S/StrecciusAlfred-R.htm
[138] Le Generalingenieur Günther Tschersich (1899-1953), faisait partie avec Ploch et Reidenbach du groupe d’ingénieurs proches du GL qui allaient s’attirer les foudres de Göring après le suicide de Udet. Mais Tschersich avait été limogé par Göring dès le 9 septembre 1941. Cajus Bekker, Angriffshöe 4000. Die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, München, Wilhelm Heyne Verlag, 1976, p. 252 [Rééd. de Ibid. Angriffshöhe 4000, Gerhard Stalling Verlag, 1964]. Richard Suchenwirth, Command and Leadership in the German Air Force, University Press of the Pacific, 2005 [rééd. de Ibid., USAF Historical Division, Aerospace Studies Institute, Harry R. Fletcher, july 1969]. Karl Heinz Roth, Michael Schmit, Die Daimler-Benz AG 1916-1948, Schlüsseldokumente zur Konzerngeschichte, Hambourg 1987, p. 416. Horst Boog, Gerhard Krebs, Detlef Vogel, Germany and the Second World War. Edited by Militärgeschichtliches Forschungsamt (Research Institute for Military History), vol. VII. The strategic Air war in Europe and the War in the West and East Asia, 1943-1944/5, Clarendon Press, Oxford, 2006, p. 173.
[139] Calendrier des relations… AFB 01MDL040-16.
[140] C’est probablement dans le même esprit que Louis de Mijolla, directeur de la Société Commentry-Fourchambault & Decazeville se rendit au Creusot le 1er juillet. Calendrier des relations… AFB 01MDL040-16. Le journal de François Walckenaer précise : « A midi, visite de MM. de Mijolla et Coudert, de la société de Commentry-Fourchambault (Imphy). L’usine d’Imphy est arrêtée. Ils trouvent bien difficile de reprendre ; ils envisagent tout au plus des fabrications de détail en aciers spéciaux. » François Walckenaer, Témoignages et souvenirs des années difficiles, p. 42.
[141] Henri Émile Claude Faucillon, né le 13 septembre 1884 à Saulieu (Côte-d’Or), chef de la division Métallurgie des établissements Schneider depuis 1930.
[142] Déposition du 24 janvier 1946 devant le commissaire Perez y Jorba. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 21. Il affirma ailleurs « entre le 10 et le 15 juillet ». Cour de justice de la Seine. Exposé, 21 juin 1949, le commissaire du gouvernement (Bévin). Ministère public c/x (SOMUA). AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 992.
[143] Ce barrage hydro-électrique sur le Rhône, situé entre la Suisse (canton de Genève) et la France (département de l’Ain) avait été créé dans l’entre-deux-guerres pour alimenter en électricité les usines métallurgiques du Creusot.
[144] Note du 27 juin 1946 remise par André Vicaire au commissaire Perez y Jorba, s. n. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659.
[145] Le jour de la réouverture, le 7 juillet. Calendrier des relations avec les autorités allemandes, [texte manuscrit] s. n., s. d. AFB 01MDL040-16 et Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 41-42. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659.
[146] L’ingénieur Paul Delahousse s’était rendu au Creusot le 4 juillet, très certainement pour y rencontrer Hartmann le lendemain et discuter des modalités du voyage à Berlin. A l’issue de son séjour du 5 au 7 juillet, Hartmann adressa une lettre à Schneider afin de convoquer les deux ingénieurs français en Allemagne. Calendrier des relations avec les autorités allemandes, [texte manuscrit] s. n., s. d. AFB 01MDL040-16 et diverses pièces de Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659. En 1933, Paul Delahousse, alors responsable chez Schneider du service des Sous-marins au bureau de Paris, avait introduit dans l’entreprise Charles Stroh, qui était comme lui ingénieur du Génie maritime, chargé depuis 1925 de réorganiser l’usine de torpilles de Saint-Tropez. André Prost, « Henri Charles Stroh, Ingénieur, patriote », Bulletin de l’Académie François Bourdon, n° 4, janvier 2003, p. 6.
[147] La source écrit « Paul Thomachot, directeur des Ventes », mais il s’agit plus certainement de Paul Thomassot, né le 31 octobre 1885 à La Clayette, formé à l’École industrielle de l’Est à Nancy, entré comme dessinateur le 1er juillet 1911 aux ateliers de constructions mécaniques du Creusot, nommé chef de service le 12 janvier 1948. Il prit sa retraite le 1er avril 1952. Renseignements aimablement communiqués par Virginie Seurat, archiviste de l’AFB.
[148] Rapport de Richard Nagel (traduction), Le Creusot 18/19-07-1940. Chemins de fer allemands – Office central des chemins de fer du Reich de Berlin, Hartmann à la société Schneider (traduction), 22.08.1940 et Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 148. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659.
[149] Rapport Caujolle… p. 381.
[150] Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics… op. cit., p. 316.
[151] Préfecture de police – Commissariat de police du quartier du mail. Procès-verbal. Déposition de Jean Pérony, 29 janvier (1945).
[152] Henschel & Sohn GmbH fut pendant longtemps le premier constructeur de locomotives sur le continent européen. A partir de 1924, la société diversifia ses activités avec la production de véhicules automobiles, d’armements, de chars, d’avions et de moteurs d’avion. OMGUS. External Assets – General Records Pertaining to External Assets Investigation – Henschel & Sohn, p. 5.
[153] Henri Victor Jungblutt, né le 17 juillet 1900 au Creusot (Saône-et-Loire), mort à Guillon (Yonne), le 8 mai 1983, fils de Charles Albert Jungblutt, ajusteur, âgé de 25 ans, et de Janie Lacour, sans profession, âgée de 25 ans. AD Saône-et-Loire – Naissances – 5 E 153/125 acte n° 485.
[154] Henri Jungblutt ne fut officiellement désigné comme directeur par le CA qu’en février 1944, mais il occupait de fait ces fonctions dès le mois d’août 1940. Ministère de l’Intérieur. Direction générale de la sûreté nationale. Rapport de l’inspecteur de police judiciaire Louis Frédéric de Chabannes, Dijon, 9 avril 1949 et déposition de Henri Jungblutt du 16 mars 1949. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 908 et 904.
[155] Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire du 20 octobre 1941. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 223.
[156] Antoine Jean Marie Castellani, né le 10 octobre 1880 à Paris 1er, fils de Christophe André Castellani, et de Jeanne Quenouille.
[157] Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 43. AN Z/6NL/572.
[158] Exposé, 9 juillet 1949, le commissaire du gouvernement, signature illisible. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572.
[159] Les dirigeants de SW en conclurent qu’il « appartenait évidemment à la 5ème colonne. » Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d. AN Z/6NL/572 f° 43.
[160] Déposition de Louis Rouvray devant le commissaire Perez y Jorba, 24 janvier 1946. AN Z/6NL/572 f° 18.
[161] A cette époque, l’hôtel Astoria, situé à proximité de l’Étoile, abritait la Rüstungsinspektion Paris.
[162] Annexes au Rapport de Monsieur Israël, expert. Aff. Le Matériel électrique SW – Annexe 1 – Relations entre la société « Le Matériel électrique SW » et les autorités allemandes pendant l’Occupation, 4 mai 1948 et Rapport T. II, p. 241. AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 27.
[163] Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 59-60. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659. Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics … op. cit., p. 316.
[164] Rapport d’expertise… p. 59-60.
[165] Et non le 20, comme l’écrit P. Caujolle. Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 60-61. Note du 27 juin 1946, s. n., p. 7. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 21. [Note sans titre, ndr], s. n., 25 mars 1950. AFB 01L0122-05.
[166] OKW, Wi Rü Amt/Rü. 26. August 1940. Besprechung bei Wi Rü Stab Frankreich und Rü-In Paris. – BA-MA RW19/553.
[167] Oberkommando der Wehrmacht Wi Rü Amt/Rü II d, Berlin, den [espace vide] Juni 1940. BA-MA RW/46/96. Voir aussi Besprechung mit Kpt. Bühring Rü Stab (28.7.40) Kriegstagebuch Wehrwirtschafts- und Rüstungsstab Frankreich. 4.6.40 – 31.12.40. – BA-MA RW24/2.
[168] Fernschreiben vom 28.6.1940 An OKW/Wi Rü Amt, Stab Ia. Oberstlt. Fach AOK 2/O Qu/IV W. BA-MA. RW/46/96.
[169] Armeeoberkommando [AOK] 2 – O Qu – IV W, OU, den 29.6.1940 An das IX A K Schloß. Der Oberquartiermeister IA gez. Fach. BA-MA. RW/46/96.
[170] Fernschreiben vom 14.7.1940 An OKW/Wi Rü Amt, Stab Ia, Berlin. Oberstleutnant Fach AOK 2/O Qu/IV W. BA-MA. RW/46/96.
[171] Devisenschutzkommando (DSK) : Détachement pour la mise en sûreté des devises.
[172] BA-MA RW24/15.
[173] Le groupe «Rüstung fut interrogé par le chef du Wehrwirschaft-und Rüstungstab Frankreich. Tätigkeitsbericht der Deutschen Waffenstillstandskommission Gruppe Rüstung für die Zeit vom 30 Juni 1940 bis 31 März 1942. BA-MA RW/34/224.
[174] Ministère de la Production industrielle – Direction des industries mécaniques et électriques – Circonscription de Dijon – Délégation de Saône-et-Loire. N° 18756/MP. L’ingénieur départemental Miquel, délégué de la direction des industries mécaniques et électriques, Chalon-sur-Saône, le 24 mai 1945. AFB 01L0122-05.
[175] Autorités allemandes chargées du contrôle des usines Schneider et Cie, Le Creusot 31.07.1940 [Traduction de l’Allemand]. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 73.
[176] Un brevet pour « Différentiel à engrenage conique autobloquant, notamment pour véhicules automobiles » [Selbstsperrendes Kegelradausgleichgetriebe, insbesondere für Kraftfahrzeuge], application déposée en 1941 avec l’Ing. dipl. Heinz Hiersig pour Rheinmetall-Borsig. Enregistré sous la référence internationale F16H48/08. Voir également Stahl und Eisen, Zeitschrift für das Deutsche Eisenhüttenwesen. Herausgegeben Vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute im NS.-Bund Deutscher Technik, 25 Februar 1943 [en ligne]
[177] B – Mission allemande de surveillance de l’usine du Creusot (Mission civile), s. n., s. d. AFB 01L0122-05.
[178] Robert Dietinger, né le 14 février 1880 à Marburg an der Drau dans l’empire d’Autriche-Hongrie (Maribor, dans l’actuelle Slovénie), décédé le 3 octobre 1960 à Vienne (Autriche). Entré dans l’armée austro-hongroise en 1898, il y est aspirant-officier – Kadett-Offiziersstellvertreter (le 18 août de la même année), Leutnant (1899), Hauptmann (1911), Major (1915), puis dans l’armée autrichienne, Oberst (1923), Generalbaurat (1926) et enfin dans la Wehrmacht après l’Anschluss (Generalmajor, 1939) ; détaché au département Artillerie de l’École de Guerre (1904-1906), élève à la Technische Hochschule de Vienne de 1906 à 1908, instructeur de mécanique et de physique à l’Académie militaire royale et impériale, il est alors affecté à l’état-major de l’Artillerie (1908-1913). Pendant la Grande Guerre, il commande une batterie dans le 10ème Feldhaubitzregimenter (régiment d’obusiers de campagne – 1913-1915), et, pendant l’entre-deux-guerres, il fut entre autres, directeur des usines de l’État (1926-1932). Il prit sa retraite le 30 juillet 1932, mais fut mis à la disposition de l’armée allemande le 1er octobre 1939. Co-directeur de la mission de surveillance des usines Schneider du Creusot, il intégra la « Führer-Reserve » jusqu’à sa retraite définitive au mois de mai 1944. Divers et traduction partielle de : http://www.geocities.ws/orion47.geo/WEHRMACHT/HEER/Generalmajor/DIETINGER_ROBERT.html
[179] Les derniers arrivants furent remplacés à leur tour, pour la plupart, en décembre 1941 et le turn over se poursuivit ainsi jusqu’en décembre 1943. Annexe I – Personnel ayant fait partie de la direction allemande pendant l’Occupation, s. n., s. d. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 379.
[180] Note sur les activités de SOMUA de 1935 à la Libération, 35 p. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 417.
[181] Voir notamment sa déposition du 23 janvier 1946 au cabinet Perez y Jorba. AN Z/6NL/572, f° 16. Dans ses Mémoires également, Pierre de Cossé-Brissac passe sans transition ni précision du récit de la reprise de l’été 1940 à la désignation de son entreprise comme Patenfirma alors que celle-ci n’eut lieu qu’en 1943 comme pour toutes les entreprises stratégiques contrôlées par les Allemands.
[182] Séance du conseil du 9 octobre 1940 – scellé n° 31, cité dans Rapport, Robert Israël, T. I, p. 27 et T. IV p. 366. AN Z/6NL/572. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW) f° 23.
[183] Préfecture de police – Direction de la police judiciaire – Cabinet de M. Perez y Jorba, Rapport de l’inspecteur Allard, 27 novembre 1945. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 9.
[184] Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d., p. 30-31 et Rapport de Robert Israël, T. I, p. 195. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 43. La Rombacher Hüttenwerke AG était une entreprise allemande de charbon et d’acier fondée en 1888 par Carl Spaeter suivant un projet engagé dès 1881 en Lorraine annexée. L’usine sidérurgique du groupe était située à Rombas (Rombach). Avec la cession de l’Alsace-Lorraine à la France après la Grande Guerre, la société allemande dut vendre l’usine sidérurgique à la Société d’études et d’entreprises industrielles d’Alsace et de Lorraine pour la somme modique de 125 millions de francs. Cette société avait été constituée le 1er avril 1919 à l’initiative de la Compagnie des forges et aciéries de la Marine et d’Homécourt, de la Société des hauts-fourneaux et fonderie de Pont-à-Mousson et de la Société des aciéries de Micheville. Lors de l’assemblée générale du 18 novembre 1919, elle prit le nom de Société des Aciéries lorraine de Rombas. Avec l’occupation allemande de 1940, l’usine de Rombas fut mise sous séquestre comme toutes les usines de Moselle annexée, et revint temporairement dans le giron de la Rombacher Hüttenwerke AG.
[161] Une remarque surprenante au regard de l’histoire européenne, de ses luttes fratricides, et de la genèse du premier conflit mondial.
[186] Pierre de Brissac, La suite des temps (1939-1958), Paris, B. Grasset, 1974.
[187] Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt, « L’Industrie automobile au début de l’Occupation », art. cit.
[188] Rapport Caujolle, p. 55-56. Ministère public c/x (Schneider et Cie) AN Z/6NL/366 f° 80.
[189] Nous suivons ici le résumé effectué par Paul Caujolle. En effet, l’expert-comptable fut l’un des premiers à retrouver les pièces relatives à ces négociations dans le cadre de la procédure lancée contre le comité d’organisation de l’Automobile et du cycle (COA). C’est également à cette occasion que furent mis les scellés sur les papiers du service des commandes étrangères de l’ingénieur général Herck.
[190] Rapport d’expertise de Bernard Fougeray, p. 46. Ministère public c/x (Delahaye). AN Z/6NL/750 f° 9. Cité dans Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt, « L’industrie automobile au début de l’Occupation… art. cit. Voir aussi le compte rendu fait par Léon Noël au maréchal Pétain le 2 août 1940 que nous avions cité dans Laurent Dingli, Louis Renault, Paris, 2000, p. 402-403.
[191] Idem p. 56-58.
[192] Nous déduisons ces questions de la réponse de Jacques Barnaud, car la lettre de Schneider & Cie n’a pas été retrouvée. En revanche celle composée par les dirigeants de Schneider au nom de la SOMUA se trouve dans le dossier d’instruction et a été analysée par le rapporteur, Robert Israël.
[193] Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 63-64 et copie de l’original dans AFB SS1130-07.
[194] Rapport Caujolle, p. 58. Ministère public c/x (Schneider et Cie). AN Z/6NL/366 f° 80.
[195] Déposition d’Albert de Boissieu devant le commissaire Perez y Jorba, 1er juillet 1946. Ministère public c/x (Schneider et Cie). AN Z/6NL/366 f° 10.
[196] Note du 27 juin 1946, s. n. Ministère public c/x (Schneider et Cie). AN Z/6NL/366 f° 21.
[197] André Vicaire avait obtenu un rendez-vous le 4 juillet avec le directeur-général de la SNCF, Robert Le Besnerais, mais ce dernier avait dû se décommander au dernier moment pour rencontrer le chef de cabinet du ministre des Travaux publics. Rapport Caujolle, p. 43.
[198] Note du 27 juin 1946 citée supra. Voir Georges Riguet « Un bastion du capitalisme – Le Creusot » art.cit., p. 261-266 et Marcel Massard, « Syndicalisme et milieu social … art. cit., p. 23-38.
[199] Note du 27 juin 1946, s. n. Ministère public c/x (Schneider et Cie). AN Z/6NL/366 f° 21.
[200] Note de Richard Nagel au comité de direction (de la RMB, ndr), Le Creusot, 18/19.7.40 [Traduction certifiée conforme à l’original]. AN Z/6NL/366 f° 76.
[201] Rapport de Paul Caujolle, p. 66.
[202] C’est-à-dire Wehrwirtschaftsoffizier – Verbindungsoffizier zum Wirtschafts- und Rüstungsamt : Officier de l’Économie de la défense – Officier de liaison auprès du Wi Rü Amt de l’OKW.
[203] Ferngespräch [Appel téléphonique de] Anruf Oblt [Oberleutnant] Gerhardi bei [au] Major Worm, 3.7.1940. BA-MA RW/46/96.
[204] Rapport de Richard Nagel (traduction), Le Creusot 18/19-07-1940. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659.
[205] Il s’agit d’éléments utilisés pour la construction des barrages de l’Aigle (Corrèze et Cantal) – appelé plus tard le « barrage de la Résistance » et celui de Génissiat, tous deux achevés avec succès à la Libération. Au moment de son inauguration, le second fut le plus important ouvrage d’Europe occidentale et contribua au redressement de la France d’après-guerre. Une partie des travaux de Génissiat furent pris en charge par SW. Schneider y avait consacré une part de son activité de Travaux publics à la fin des années trente, le reste étant réservé aux chantiers de la défense nationale. Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics… op. cit., p. 173, 313.
[206] C’est-à-dire le Centre de collecte du butin.
[207] Nous avons seulement trouvé la trace d’Édouard Ducreux, né à Martigny-le-Comte, le 23 juillet 1880, élève de l’école Schneider, engagé le 3 août 1914, cité à l’ordre de la 13ème division d’infanterie, le 2 juin 1915 : « A fait preuve, à maintes reprises, de courage et de sang-froid en se portant jusqu’au voisinage des tranchées ennemies pour relever les blessés et les morts. » Livre d’or du Clergé et des congrégations 1914-1922, la preuve du sang, Paris, Bonne Presse, 1925, p. 684.
[208] « Visites reçues au Creusot les 12 et 13 juillet ». AFB SS1130-07.
[209] Hermann Konstantin Albert Julius von Hanneken (1890-1981). Cet officier allemand, fils de militaire prussien et ancien combattant de la Grande Guerre, était devenu chef d’état-major du Bureau des armes de l’armée (Heereswaffenamt) en 1936 ; nommé par Hermann Göring représentant autorisé pour les achats de fer et d’acier (Bevollmächtigter für die Eisen- und Stahlbeschaffung), le 3 juillet 1937 ; promu major général et transféré au ministère de l’Économie du Reich, le 1er février 1938, en tant que chef du département II (mines, sidérurgie, industrie énergétique), à la fin du mois d’octobre 1938, puis du département I (industrie pétrolière, chimie, autres industries, textiles, pâte à papier, papier) ; sous-secrétaire d’État au ministère de l’Économie du Reich en 1940, promu la même année lieutenant général et en 1941, général d’infanterie [page Wikipedia en allemand].
[210] Idem. A noter, que les feuillets 3 et 4 sont manquants.
[211] Geheime [secret] – Geschichte der Rünstungs-Inspektion Paris (vom 20.6 – 30.9.40). BA-MA RW/24/58.
[212] SOMUA à Robert Israël, Saint-Ouen, 21 juillet 1947. AN Z/6NL/641 dossier 15609 Ministère public c/x (SOMUA) f° 539.
[213] Déposition de Charles Roidot devant le commissaire Perez y Jorba, 23 janvier 1946. AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie) f° 15.
[214] Sur ces questions, voir Arne Radtke-Delacor, « Produire pour le Reich. Les commandes allemandes à l’industrie française (1940-1944) », Vingtième Siècle, 2001/2 (n° 70), p. 99-115.
[215] Note de Richard Nagel au comité de direction (de la RMB, ndr), Le Creusot, 18/19.7.40 [Traduction certifiée conforme à l’original]. AN Z/6NL/366 f° 76.
[216] Rheinmetall-Borsig – Usines de Borsig. Section Direction d’Exploitation « S », au Directeur Nagel, 9 août 1940, signée Isenberg [Traduction de l’Allemand]. AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 70.
[217] Note de Richard Nagel… Idem.
[218] On voit que Nagel s’installa à Paris à l’initiative des Français, contrairement à ce que la direction de Schneider déclara à la Libération : « Lorsque le siège social fut reconstitué, la mission allemande exigea d’y avoir des bureaux dont M. Nagel (…) prit possession. » Note du 27 juin 1946, s. n. Ministère public c/x (Schneider et Cie) AN Z/6NL/366 f° 21.
[219] M. Stroh à M. Walckenaer, Le Creusot, 1er août 1940. AFB SS1130-07.
[220] Usine du Creusot – Direction de l’exploitation, Le Creusot, 10 août 1940, s. n. AFB SS1130-07.
[221] Note de Robert Dietinger, Le Creusot, 1er juillet 1940 (Traduction). AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie) f° 74.
[246] Suivant les termes du PV du CA daté du 27 novembre 1940, repris par l’expert dans : Rapport de Robert Israël, 16 avril 1949, T. IV, p. 378. Idem.
[222] Autorités allemandes de contrôle des usines Schneider & Cie, Le Creusot, 6 août 1940, signé Hentschel et Berkenkemper (Traduction). AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie) f° 65.
[223] Pour éviter cette réquisition, les dirigeants de Schneider évoquèrent la nécessité d’honorer une commande de l’OKH datée du 16 août précédent. Lettre pour la Mission allemande, Le Creusot, 13 septembre 1940 [Le texte porte en annotation marginale au crayon « cette lettre a été faite à titre définitif et en allemand par M. Souffrant »]. AFB SS1130-07.
[224] [Henri] Stroh [à] Monsieur Hartmann, Reichsbaurat à Berlin, 19 août 1940 [Traduction de la pièce en allemand, ndr]. AFB 01MDL040-16.
[225] Voir notamment la déposition d’André Vicaire du 22 juin 1946 devant le commissaire Perez y Jorba, chef de la section financière aux Délégations spéciales et judiciaire de la préfecture de police. AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie) f° 24.
[226] Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt, « L’Industrie automobile au début de l’Occupation », loc. cit.
[227] Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion Paris. Begonnen 20.6.40. BA-MA RW24/54.
[228] La Dortmunder Werkzeugmaschinen-Fabrik Wagner & Co, qui deviendra vers 1943 la Wagner & Co., Werkzeugmaschinen-Fabrik m. b. H.”, a été fondée le 16 décembre 1865 avec un capital de 1,5 million de marks. L’entreprise possédait une usine de machines-outils, une fonderie de fer et une menuiserie modèle. Les principaux produits étaient des machines-outils pour l’usinage des métaux, des machines pour le façonnage sans enlèvement de copeaux ainsi que des machines auxiliaires pour les laminoirs et les usines métallurgiques et des machines et équipements hydrauliques. La société devint par la suite une filiale de Rheinstahl. Source : Historische Wertpapiereund Finanzgeschichte (en ligne) : https://www.hwph.de/historische-wertpapiere/losnr-auktnr-pa48-314.html Voir aussi la cote F3 des Archive in Nordrhein-Westfalen : http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=4&tektId=4&expandId=1
[229] Kriegstagebuch der Rüstungsinspektion Paris. Begonnen 20.6.40. BA-MA RW24/54.
[229 bis] A notre connaissance, Peter F. Klemm est le seul à avoir cité cette commande. Je remercie Patrick Fridenson de m’avoir indiqué cette référence importante qui m’avait échappé. Peter F. KLEMM, « La Production aéronautique française de 1940 à 1942 », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 27e année, n° 107 (juillet 1977), p. 57.
[230] Le premier contrat officiel de matériel de guerre, portant sur des pièces de forge ébauchées et traitées, fut accepté par André Vicaire le 26 août et régularisé le lendemain par l’ingénieur général Herck. Rapport Caujolle, p. 79-81.
[231] Eugène Dequincey, né le 11 janvier 1880 au Creusot, diplômé de l’École nationale des Arts et métiers d’Aix (1899), entré chez Schneider comme monteur le 3 août 1899, dessinateur à partir du 17 janvier 1900, nommé chef d’atelier – constructions mécaniques (Division A – chemins de fer), le 29 novembre 1917, chef de service de Mécanique générale et turbines, le 6 mars 1923, chef de service à titre personnel attaché à la direction de l’usine le 1er août 1943, retraité le 1er avril 1945. Informations aimablement communiquées par Virginie Seurat, archiviste de l’AFB d’après les fiches du personnel ingénieur et cadre.
[232] Wagner et Cie (copie). Note pour le dossier Dortmund, le 8 août 1940, signé Beckhaüser. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 71.
[233] Kriegstagebuch Wehrwirtschafts- und Rüstungsstab Frankreich. 4.6.40 – 31.12.40. – BA-MA RW24/2.
[234] Rapport du 9 août 1940. BA-MA RW/24/54.
[235] Idem.
[236] Agnès D’Angio, Schneider & Cie et les Travaux publics… op. cit., p. 316. L’historienne n’a pas travaillé à partir du dossier de la cour de justice mais de AN 187/AQ/175. Dossier n° 6 : préparation à la demande de l’expert Caujolle, 27 juin 1946 – qui n’indiquait peut-être pas la source première de ce texte, c’est-à-dire la note originale déposée par André Vicaire au commissaire Perez y Jorba. Celle-ci portait précisément : « Il résulte de ce texte [les pouvoirs conférés à Nagel le 10 juillet, ndr] que nous étions dessaisis de la direction générale de nos usines déjà occupées par un bataillon allemand, le rôle de notre direction se bornant désormais à prêter notre concours administratif pour servir d’intermédiaire entre la mission et notre personnel. Cette situation équivalait en fait à une réquisition. » Note du 27 juin 1946, s. n., p. 6. Le rapport Caujolle, p. 233, précise bien que l’affirmation provient d’une déclaration des établissements Schneider. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 dossier 8659 f° 21.
[237] Note du 12 avril 1946 adressée au juge d’instruction, p. 3-4. AN Z/6NL/366, pièce non foliotée.
[238] La légende rose est reprise par la presse locale, ainsi dans Le journal de Saône-et-Loire du 15 février 2019 peut-on lire sous le titre « Quand l’usine Schneider résistait aux ordres de l’occupant » : « La direction de l’usine s’oppose à ces directives. Elle saisit la direction générale du groupe Schneider qui, à son tour, alerte les autorités françaises, considérant que les injonctions des Allemands ne sont ni conformes à la convention d’armistice, ni aux conventions internationales auxquelles l’Allemagne avait adhéré. Autre point de désaccord avec l’occupant, la fabrication du matériel de guerre. Dès août 1940, les autorités allemandes passent commande d’un certain nombre de pièces de forge ébauchées et traitées. Le journal de Saône-et-Loire du 15 février 2019 [en ligne]
[239] Avant-guerre, la SOM était déjà la plus importante des sociétés françaises spécialisées dans l’étude et la fabrication des instruments militaires d’optique.
[240] AN Z/6NL/28 dossier 269. Ministère public/Antoine Castellani, Jean-Louis Bach, André Vicaire et alii (Société d’optique et de mécanique de haute-précision). Paul Caujolle cita un extrait du rapport de son collègue Bernard Fougeray daté du 8 mai 1945 dans son propre rapport sur Schneider. Rapport Caujolle… p. 509.
[241] PV de 1ère comparution, 22 décembre 1945. AN Z/6NL/28 dossier 269 (…) f° 118.
[242] Note sur les activités de SOMUA de 1935 à la Libération. AN Z/6NL/641 dossier 15609 f° 417.
[243] Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 43.
[244] Rapport de Robert Israël, 16 avril 1949, T. IV, p. 367. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 23.
[245] Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 43.
[246] Suivant les termes du PV du CA daté du 27 novembre 1940, repris par l’expert dans : Rapport de Robert Israël, 16 avril 1949, T. IV, p. 378. Idem.
[247] Déposition de François Verheyden-Chaine, 20 mai 1949. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 36.
[248] Le Matériel électrique SW – Note au sujet du rapport de M. Israël du 16 avril 1949, s. n, s. d. L’argument fut repris par Charles de Beaumarchais dans sa déposition du 29 avril 1949 devant le juge Nicolas de Villedary. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 28 et 43.
[249] Après la fusion avec la Banque des pays du Nord.
[250] Assemblée générale annuelle du 20 mai 1940. Rapport au conseil d’administration. ADP 115 W 27 dossier 167 [ancienne cote Perotin 3314/71/1 6ème comité] – L’Union européenne industrielle et financière.
[251] L’UEIF céda 14 613 des 40 202 parts de Rothschild & Cie et les 86 330 parts qui lui appartenait en propre (sur un total de 144 232 parts, le reste étant partagé entre Schneider et Cie (100), la BUP (15 000), la Banque de Paris et des Pays-Bas (1 500), Worms & Cie (1 000) et divers (100).
[252] Assemblée générale annuelle du 6 octobre 1941. Rapport au conseil d’administration. ADP 115 W 27 dossier 167 – L’Union européenne industrielle et financière.
[253] NARA. OMGUS. External Assets – General Records Pertaining to External Assets Investigation – Reichswerke Hermann Göring, p. 22.
[254] Interrogée à la Libération, la BUP parvint à prouver qu’elle avait dû céder ses parts sous la contrainte. Voir Ministère public c/x (Forges et aciéries de Huta-Bankowa). AN Z/6NL/605 dossier 14943.
[255] Seules étaient concernées par l’ordonnance du 18 octobre 1944 sur la confiscation des profits illicites les cessions faites après le début des hostilités entre la France et l’Allemagne, soit les parts de la Banque générale de crédit hongrois et de la Banska A Hutni cédées en 1940 et 1941. Le comité ne mentionna pas la Société des aciéries et forges de Huta-Bankowa dans le cas de l’UEIF.
[256] Ce fut pourtant en raison des cessions faites à l’ennemi que la société avait été citée le 18 avril 1945. Rapport de M. Abart, inspecteur des Contributions directes sur la Société anonyme L’Union européenne (industrielle) et financière. Comité de confiscation des profits illicites, 6, rue des Pyramides Paris 6. Citation n° 167.
[257] Ajoutons encore le Crédit mobilier industriel (SOVAC), société autrefois spécialisée dans le financement de ventes à crédit de voitures automobiles et qui se consacrait alors aux opérations de crédit à moyen terme ; la Compagnie française de réassurances générales, qui bénéficiait de l’appui du marché suisse des assurances et jouait un rôle important sur le marché français et international des réassurances ; la Société des tanneries de France à Rennes, et la Société financière transafricaine. Assemblée générale annuelle du 29 juin 1942. De nombreux investissements en métropole et dans les colonies eurent lieu en 1942 et 1943. ADP 115 W 27 dossier 167 – L’Union européenne industrielle et financière.
[258] Les rachats d’obligations Skoda pour le compte de l’ennemi n’avaient pas été effectuée par l’UEIF mais par la Banque des Pays du Nord avant la fusion d’octobre 1943.
[259] Le montant total de la confiscation porté sur la lettre de notification fut ramené à 1 725 244 francs après observations faites par Albert de Boissieu pour l’UEIF (sur un profit global de plus de 52 millions de francs). L’inspecteur estima que si la banque n’avait ni recherché ni favorisé des opérations directes ou indirectes avec l’ennemi, elle n’avait pas agi sous l’empire de la contrainte. La banque put jouir de ce fait d’une « responsabilité atténuée ». Note résumant les observations présentées au comité par M. Abart sur l’Union européenne et financière, s. n., s. d. L’amende évaluée au départ à 60 000 francs fut par la suite annulée. ADP 115 W 27 dossier 167 – L’Union européenne industrielle et financière.
[260] Pierre de Gaulle, né le 22 mars 1897 à Paris 7ème, arrêté dans la même ville le 16 mars 1943, interné dans une résidence de Neuilly puis à la prison du Cherche-Midi, fut transféré avec d’autres « personnalités-otages », telles que Charles de Cossé-Brissac, Michel Clémenceau ou encore le colonel François de La Rocque, au château d’Eisenberg, par convoi au départ de la gare de l’Est du 31 août 1943. « Les Allemands, écrit Thomas Fontaine, craignent un débarquement en Provence, et face à cette situation, ils ont dressé des listes de personnalités civiles et militaires susceptibles d’être arrêtées. » Le château d’Eisenberg, situé au flanc des montagnes des Sudètes, était officiellement rattaché au KL Flossenbürg, et avait été « aménagé pour recevoir ces déportés au statut particulier. » Il ne semble pas que Pierre de Gaulle ait été lui-même engagé dans la Résistance, contrairement à son épouse. Née Delepouve, à Rouen, le 28 septembre 1908, Madeleine de Gaulle contribua en effet dès la fin 1940 à la mise en place du groupe Le Dantec (réseau du Musée de l’Homme). En décembre 1940, elle mit en rapport Lehman, qui cherchait un contact avec Londres, André Taurin et André Perrault. Elle assura entre autres le lien entre le groupe de renseignements et le colonel de La Rochère. Madeleine de Gaulle fut une résistance active. Mais, à partir de septembre 1943, elle dut se cacher pour échapper à la Gestapo. Le 23 février 1944, elle passa en Espagne avec ses cinq enfants et la fille qu’André Taurin, condamné à mort, lui avait confiée. SHD GR 16 P 165202 – Dossier Madeleine de Gaulle. LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION, Livre mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression et dans certains cas par mesure de persécution 1940-1945, Tome 1, Paris, Éditions Tirésias, 2004, [article de Thomas Fontaine], p. 1044-1045. Patrice MIANNAY, Dictionnaire des agents doubles dans la Résistance, Paris, Le Cherche Midi, 2005, p. 249-250, 288 notes 4 et 5. Toutes ces sources nous ont été aimablement transmises par Michel Blondan.
[261] Conseil national du crédit et du titre – Comité de surveillance auprès de la Mission d’étude sur la spoliation des juifs de France, le président, Jean Saint-Geours à Monsieur Tamburini, directeur général de la Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne, Paris, 6 mai 1998. Rapport à Monsieur le président de la Mission d’étude sur la spoliation des juifs de France, Comité de surveillance du secteur bancaire et financier, Conseil national du crédit et du titre, Paris, 2000, NP. BNF.
[262] « Si les cessions de titres de porteurs israélites consenties sous l’empire des mesures raciales ont été effectuées d’un commun accord et si cet accord est confirmé par les co-contractants israélites, j’aurais tendance à admettre que les dispositions précitées de l’article 1er-3° de l’ordonnance du 18 octobre 1944 ne doivent pas trouver leur application, même s’il subsiste un profit entre les mains des acquéreurs « intérimaires » de ces titres. Cependant, il pourrait être dangereux d’ériger cette position en règle générale, car on risque de se trouver parfois en présence de collusions destinées à éluder la confiscation. » Ministère des Finances. Direction générale des contributions directes. Note du 18 août 1945, le directeur général, par délégation l’administrateur. Voir également copie des actes sous seing privé passé entre Guy de Rothschild et l’UEIF d’une part, entre Lazard Frères et Cie et l’UEIF de l’autre. ADP 115 W 27 dossier 167 – L’Union européenne industrielle et financière. L’UEIF, poursuivie en cours de justice, fit l’objet d’une ordonnance de classement en date du 13 février 1946. Ministère public c/x (Union européenne industrielle et financière). AN Z/6NL/29 dossier 270 (non consulté par nous). A noter que l’inventaire des Archives nationales signale un dossier manquant pour Ministère public c/x (Banque de l’union parisienne – Affaires Skoda – achats d’obligations pour le maréchal Göring par l’intermédiaire de la Dresdner Bank). AN Z/6NL/605.
[263] Dans son ordonnance de classement de la procédure, le commissaire du gouvernement retenait notamment en faveur de Schneider : « 3° – Complaisance indiscutable envers l’occupant des organismes d’État et désaveu donné aux tentatives des dirigeants de se soustraire aux exigences de l’ennemi. » Exposé du 6 juin 1949, p. 6. Ce fut en réalité exactement le contraire.
[264] André Vicaire parvient au Creusot le 26 juin et regagne Paris le 28.
[265] Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt, L’industrie automobile… art. cit.
[266] L’argument fut rejeté par Pierre de Cossé-Brissac dans sa note du 16 avril.
[267]Zusammengefasster Bericht des Vorstands über die Entwicklung der Rheinmetall-Borsig AG im Jahre 1941, 20.4.1942, ZARh, Bestand B 300, Nr. 21, S. 4. Cité dans le livre anniversaire de Rheinmetall-Borsig, publié en 2014, texte aimablement communiqué par le Dr Christian Leitzbach des Archives de Rheinmetall.
[268] Ministère des Finances. Département de la Seine – 7ème comité de confiscation des profits illicite. Décision de classement du 16 mai 1945. Ministère public c/x (Société Le Matériel électrique SW). AN Z/6NL/572 f° 33. De même, aucune confiscation de profits ne fut mise à la charge de la société Schneider & Cie suite à la citation du 26 décembre 1944. Ministère public c/x (Schneider & Cie). AN Z/6NL/366 f° 23.
[269]. C’est-à-dire, dans l’ordre : chrome, nickel, molybdène, vanadium, tungstène, cuivre, étain, zinc, ndr.
Pour toute référence à ce texte, merci de préciser : Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt,  ”L’industrie automobile au début de l’Occupation”, L’Aventure automobile, n° 7, Mai-juin-Juillet 2019 (version annotée)
”L’industrie automobile au début de l’Occupation”, L’Aventure automobile, n° 7, Mai-juin-Juillet 2019 (version annotée)
La version PDF à télécharger
 Rarement, depuis la Révolution – à l’exception de la Grande Guerre –, la France n’a subi de choc équivalent à la défaite de juin 1940. Soixante-dix-huit ans après les faits, il faut effectuer un effort d’imagination pour se représenter la violence de ce qui fut, au sens propre, un traumatisme collectif. Restituer le contexte est d’autant plus nécessaire que l’histoire de l’industrie automobile sous l’Occupation est mal connue[1]. Il est impossible, dans le cadre d’un article, de traiter cette question de manière exhaustive, c’est pourquoi nous nous contenterons d’étudier les premiers contacts établis entre les constructeurs français et les autorités allemandes au début de l’été 1940. La période allant de l’armistice à l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht correspond au redémarrage de l’industrie française, cette fois au profit du IIIème Reich. Dans ce cadre, les secteurs tels que l’automobile attirèrent tout particulièrement l’attention de l’occupant.
Rarement, depuis la Révolution – à l’exception de la Grande Guerre –, la France n’a subi de choc équivalent à la défaite de juin 1940. Soixante-dix-huit ans après les faits, il faut effectuer un effort d’imagination pour se représenter la violence de ce qui fut, au sens propre, un traumatisme collectif. Restituer le contexte est d’autant plus nécessaire que l’histoire de l’industrie automobile sous l’Occupation est mal connue[1]. Il est impossible, dans le cadre d’un article, de traiter cette question de manière exhaustive, c’est pourquoi nous nous contenterons d’étudier les premiers contacts établis entre les constructeurs français et les autorités allemandes au début de l’été 1940. La période allant de l’armistice à l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht correspond au redémarrage de l’industrie française, cette fois au profit du IIIème Reich. Dans ce cadre, les secteurs tels que l’automobile attirèrent tout particulièrement l’attention de l’occupant.
Une France traumatisée
L’industrie automobile en juin 1940
Industrie de pointe, souvent liée à l’aéronautique dont elle avait favorisé l’essor au début du siècle, l’automobile a puissamment contribué à la défense nationale pendant la drôle de guerre et la bataille de France. Il faut s’imaginer ce que furent ces dix mois de travail intense, le surmenage du personnel des entreprises et de leurs dirigeants. En fin de période, les ouvriers et ouvrières s’échinent 60 heures par semaine dans des conditions souvent pénibles et dangereuses. L’épuisement, la fulgurance de la défaite, les péripéties de l’exode, contribuent à l’état de sidération dans lequel se trouve une grande partie de la population française.
En juin 1940, l’automobile est l’un des fers de lance de l’industrie. Depuis la fin des années vingt, elle a rationalisé ses méthodes de travail, développé et modernisé ses installations et son outillage. Le mouvement est appuyé par la politique de défense nationale à partir de 1935 et surtout de 1936. Avant la guerre, l’automobile occupe le premier rang des industries mécaniques et un rôle majeur dans l’économie française avec ses 140 000 ouvriers, son poids dans la balance commerciale et le montant de son chiffre d’affaires. Un phénomène de concentration est à l’œuvre depuis la fin de la Grande Guerre, le nombre de constructeurs passant de 150 en 1920 à 31 en 1939[2].
Mais cette modernisation et ces atouts ne doivent pas masquer de réels handicaps dus autant à l’organisation interne de l’industrie automobile qu’à la configuration géographique et économique de la France. Si le secteur s’est relativement modernisé, l’effort de rationalisation est encore balbutiant. Entre 1913 et 1938, l’industrie automobile française est passée du second au quatrième rang mondial (derrière les États-Unis, l’Angleterre et l’Allemagne) et au cinquième, derrière l’Union soviétique, si on ne considère que les véhicules industriels. Comme le reste de la métallurgie, elle est largement dépendante de l’outillage fabriqué aux États-Unis et en Allemagne tandis que ses centres d’approvisionnement (acier et matières premières) se situent dans des régions proches du Reich, dans les colonies et à l’étranger. Un effort important de décentralisation des usines de guerre est réalisé à l’initiative des pouvoirs publics, mais il est souvent tardif et ne permet pas de surmonter toutes les difficultés inhérentes à la perte des territoires du Nord et de l’Est après la première phase de l’offensive allemande en mai 1940.
Exode et armistice
Sauf dans le cas de Berliet, le mouvement de repli des grandes entreprises automobiles se déroule dans un ordre et une discipline qui contrastent avec la confusion générale. Certains dirigeants ont par ailleurs pris soin d’évacuer ou de détruire une partie ou la totalité du matériel de guerre qui, faute de temps, n’avait pu être livré à l’armée française. Le reste sera pris comme butin par la Wehrmacht.
A la signature de l’armistice, la France est paralysée : les routes terrestres et les voies ferrées ou fluviales souvent impraticables, les familles dispersées, le ravitaillement rare. A titre d’exemple, plus de 2 600 ponts ont été détruits par la seule armée française pendant sa retraite. Certaines usines comme celle de Citroën à Javel ont été bombardées. Le pays donne l’impression d’avoir sombré dans le chaos. Pour ajouter à ces difficultés, la France est bientôt délimitée en cinq zones dont deux principales, occupée et non-occupée, auxquelles il faut ajouter l’Alsace-Moselle purement et simplement annexée par le Reich, une zone interdite et le Nord, rattaché au commandement militaire allemand de Bruxelles. Le gouvernement français, tout d’abord replié à Bordeaux, s’installe à Vichy et détache un représentant à Paris.
Que vont décider les maîtres de l’heure ? Faut-il rentrer de l’exode et rouvrir les usines ? Et comment nourrir le personnel, préserver l’outil industriel du pillage et de la destruction ? Il n’y a plus d’information, presque plus de communication ; on ignore les intentions du vainqueur et les nouvelles règles qu’il a édictées en matière de circulation, de monnaie, de réquisition…
Le redémarrage de l’industrie
Voilà, très succinctement résumée la situation à laquelle le personnel et les dirigeants des entreprises automobiles furent confrontés au lendemain de l’armistice. Mais avant d’aborder les premiers contacts avec l’occupant, il est nécessaire d’évoquer la période postérieure à la Libération. A cette époque en effet, la plupart des constructeurs automobiles furent inculpés pour leur activité sous l’Occupation. La quasi-totalité d’entre eux, dont l’ancien directeur général de la Société anonyme des usines Renault, entretemps nationalisée, obtinrent un non-lieu[3]. Or cette décision de classement posait un problème politique majeur dans le cas de Renault, car elle contredisait la condamnation posthume du fondateur de l’entreprise qui avait constitué le socle de la nationalisation-sanction du 16 janvier 1945. Le non-lieu obtenu par l’ancien DG de Renault, René de Peyrecave, le 30 avril 1949, influença l’administration fiscale, pourtant réputée très sévère dans son appréhension des faits de collaboration économique. Le rapporteur du premier comité de confiscation des profits illicites de la Seine, chargé du dossier Renault, se rangea en 1956 à l’avis de la justice et considéra que la firme au losange, ayant fait l’objet d’une réquisition régulière, dès l’arrivée des Allemands, pouvait invoquer l’excuse de la contrainte[4]. Malgré le départ en retraite anticipée de l’auteur, ses conclusions furent confirmées en 1957 par son successeur, l’inspecteur Barbedienne. C’était une véritable bombe qui provoqua la colère du P-DG de la Régie nationale des usines Renault, Pierre Dreyfus, lequel alla jusqu’à mettre en cause les compétences des deux rapporteurs[5]. Cette contradiction était en effet délicate pour un État qui avait confisqué les biens d’un homme mort sans jugement, au mépris des principes constitutionnels les plus élémentaires. Afin de dissocier les responsabilités entre l’entreprise et son fondateur, la justice avaient pourtant pris soin d’affirmer que Louis Renault s’était « efforcé, au début de l’Occupation, de prendre des contacts directs avec les Allemands, alors qu’il lui était facile de se retrancher derrière la décision du COA » (comité d’organisation de l’automobile) qui, en réalité, n’existait pas à cette date.
Comment se déroula dans les faits la remise en route de l’industrie automobile française au profit du IIIème Reich ?
L’organisation allemande : entre pillage et contrôle de la production
Dès leur arrivée, les Allemands se saisirent des entreprises dont ils prononcèrent la réquisition. Même s’ils commencèrent immédiatement le pillage d’une partie des installations, des stocks et des machines, cette mesure avait surtout un but conservatoire : la politique du Reich à l’égard du potentiel industriel français n’avait pas encore été bien définie à Berlin. Fallait-il exploiter les forces vives de la France sur place ou les transférer en Allemagne ?
A quelques nuances près, le système d’exploitation de l’industrie française était calqué sur l’organisation du Reich. L’un des maillons essentiels en était la Rüstungsinspektion (Rü-In) ou Inspection de l’Armement, créée pour la France par ordre du 20 juin 1940 et placée sous la direction du général Schubert. Directement subordonnée au Commandement militaire de Paris, elle avait son siège à l’hôtel Astoria, 132, avenue des Champs-Élysées. Le service était subdivisé par zones géographiques : la Rü-In A contrôlait Paris, la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise, soit l’essentiel de l’industrie en zone occupée ; la Rü-In B, installée à Angers, s’occupait de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France, et la Rü-In C, basée à Dijon, de la partie Est. Le service œuvrait de concert avec les « troupes de l’économie », chargées de l’enlèvement et de l’expédition vers l’Allemagne du butin de guerre, jusqu’à leur dissolution en février 1941. Une des missions principales de l’Inspection consistait à « la remise en marche des entreprises de l’industrie désignées par le commandement militaire. [6] »
Trois unités avaient constitué l’embryon de cette structure : le groupe « P » de l’économie, composé de 25 officiers et sous-officier placés sous la direction du capitaine Vering, créé à Hambourg les 8 et 9 juin ; le groupe « Rüstung » de l’administration militaire dont l’état-major comprenait 15 officiers, sous-officiers et agents, et enfin le groupe « P » des matières de production, doté d’un effectif de 47 personnes. Les trois unités se retrouvèrent à Cologne entre le 10 et le 13 juin 1940. Là, avec le concours du bibliothécaire de la Chambre économique de Rhénanie, elles constituèrent un fichier des entreprises et des groupements économiques français les plus importants. Cette base de données fut ensuite complétée par les listes d’entreprises ayant travaillé pour la défense nationale qui furent transmises aux Allemands par le gouvernement français. La chronologie indique bien que l’organisation de la Rü-In France s’est faite au fur et à mesure de l’avancée allemande et n’avait sans doute pas été prévue avant le début de l’offensive, le 10 mai, du moins dans ses détails.
L’État-major de l’économie militaire et de de l’industrie de l’armement s’installa dans l’hexagone le 3 juillet 1940 ainsi que 4 (puis plus tard 3) Rü-In[7]. Dans la même période fut établi un service dirigé par le colonel (Oberst) Max Thoennissen, plénipotentiaire général pour les véhicules automobiles (Generalbevollmächtigte für das Kraftfahrwesen, GBK). Enfin, le conseiller d’État en construction Kummer prit ses fonctions de délégué spécial des troupes rapides (Schnelle Truppen), le 26 août 1940. Il était chargé à ce titre des engins blindés et donc du contrôle des entreprises automobiles françaises spécialisées dans cette fabrication comme Renault ou Hotchkiss[8].
Des commissaires, désignés par les occupants sous le sigle IB (Industrie Beauftragte, c’est-à-dire « fondé de pouvoir industriel ») furent également installés dans les usines. Pas moins de trois pour Renault à Billancourt, deux pour Chausson et Delahaye. Ces hommes, souvent des ingénieurs, connaissaient parfaitement l’industrie automobile et métallurgique pour en être eux-mêmes issus. Plus précisément, c’étaient des employés chevronnés des entreprises allemandes qui avaient sollicité et reçu de Berlin la tutelle des sociétés françaises dont les fabrications les intéressaient : Daimler-Benz pour Renault, Volkswagen (VW) pour Peugeot, Auto-Union pour Citroën et SIMCA, VW et Süddeutsche Kühlerfabrik (SKF) pour Chausson, etc. A titre d’exemple, les commissaires de Delahaye, Stanievicz et Schmitz, étaient respectivement directeur technico-commercial et directeur des ateliers de la firme allemande Büssing-Nag. Les IB coiffaient souvent plusieurs entreprises. Egbert Fischer, auquel succéda le Dr Friedrick Lucke, employé dans le civil par la firme Dentz de Cologne, fut ainsi chargé de Latil, Saurer, Willème, Camions Bernard, Coder, Licorne et Laffly. Un doute subsiste quant à la planification de cette prise en charge. Ce qui est certain, c’est qu’elle s’est décidée suffisamment tôt pour que ces spécialistes soient mis en place dès les premiers jours de l’Occupation avec une mission de contrôle relativement bien définie. Notons que certains sont issus de l’aristocratie comme Paul von Guilleaume, collaborateur de l’usine Adler de Francfort-sur-le-Main, IB de Peugeot et de Chausson – dont le frère était employé au GBK –, le prince Wilhelm Fürst von Urach, attaché à Renault, ou Heinz von Baumbach, commissaire de Citroën. A noter également que les entreprises françaises devaient payer les salaires et les frais des IB chargés de les contrôler. Hotchkiss dut ainsi régler plus de 5 700 Reichsmark (RM) en août 1941 pour le salaire et les frais d’hôtel de son commissaire, Hermann Speich, ingénieur de Krupp-Gruson à Magdebourg[9].
Au cours de l’été 1940, les industriels de la zone occupée se retrouvèrent souvent livrés à eux-mêmes face aux autorités d’occupation. A part les préfets et les chambres syndicales patronales, organismes qui faisaient la liaison avec Vichy, le seul interlocuteur officiel était l’ancien ambassadeur de France à Varsovie, Léon Noël, nommé délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés.
Les premiers contacts
Au moment de la défaite, certains dirigeants d’entreprise se trouvaient loin de leurs usines, parfois même à l’étranger ; c’était le cas de Louis Renault qui s’était rendu aux Etats-Unis fin mai 1940 à la demande du ministre de l’Armement pour y négocier la production massive de chars d’assaut. De même, Henri-Théodore Pigozzi, directeur général de la SIMCA, était à Turin où le même Raoul Dautry l’avait missionné pour accélérer l’envoi de 2 200 camions FIAT destinés à l’armée française.
A notre connaissance, Jean-Pierre Peugeot fut le premier constructeur automobile à retrouver ses usines après la débâcle. Il rentre en effet à Sochaux dès le 27 juin 1940 à 21h 30, soit deux jours après la signature de la convention d’armistice et près d’un mois avant le retour de Louis Renault à Paris (mais à peu près au même moment que René de Peyrecave à Billancourt). Sur place, il constate que les troupes allemandes gardent les usines et en interdisent l’entrée. Le lendemain, 28 juin, il prend l’initiative de se rendre à la Kommandantur avec Robert Martin, sous-préfet de Montbéliard. Là, un lieutenant-colonel lui annonce « que n’ayant pas trouvé de personnel de direction à Sochaux, il attend une personnalité allemande à qui il est chargé de remettre les usines ». La menace de dépossession a un effet immédiat puisque Jean-Pierre Peugeot rencontre le même jour le major Fritz puis le commandant de la division allemande installée dans la région et obtient « l’autorisation de reprise de possession pour le lundi 1er juillet. [10] » Aussitôt, 375 ouvriers (sur les 13 000 que comptaient les usines avant l’exode) sont convoqués pour la remise en ordre des ateliers. Avant le 10 août, près de 400 voitures destinées au secteur civil sont produites.
La réquisition de Renault est prononcée dès le 18 juin et des affiches sont placardées aux portes de l’usine six jours plus tard. Le texte, émanant du GBK, stipule que les ateliers, les bureaux et les stocks sont réservés au gouverneur militaire de Paris et que l’entrée des locaux n’est permise qu’à des personnes munies de sauf-conduit. Le 25 juin, René de Peyrecave, administrateur-délégué des usines Renault, est nommé membre de la délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice de Wiesbaden. Après avoir pris des instructions à la présidence du Conseil à Bordeaux, il rejoint Billancourt où il rencontre les commissaires allemands déjà installés dans l’usine. D’après sa déposition, ces derniers, menaçants, auraient exigé la reprise du travail. En cas de refus de la direction française, ils passeraient outre. Une note de la commission française d’armistice constate en effet que les commissaires allemands de Renault et de Citroën ont pour mission de prendre le contrôle des entreprises en cas de défaillance de leurs dirigeants. Au cours de la même période, François Lehideux, administrateur-délégué de Renault et neveu par alliance du fondateur de l’entreprise, intervient auprès des pouvoirs publics pour faire rouvrir, non seulement les usines de Billancourt, mais toutes les entreprises de la région parisienne. Il obtient dans ce but l’accord de Pierre Laval (27 juin) et l’appui de la préfecture de la Seine[11]. Une première commande de 1000 camions passée respectivement à Renault et à Citroën pour les besoins civils donnent un peu d’oxygène aux deux grandes entreprises.
Les usines Delahaye sont frappées d’une ordonnance de saisie provisoire dès le 24 juin et se voient attacher les commissaires Stanievicz et Schmitz. Le personnel, replié en région nantaise, commence à rentrer dès le lendemain. Les usines sont rouvertes le 1er juillet et fonctionnent à la fin du mois au tiers de leur activité normale, la société poursuivant pour la Wehrmacht la production de camions de 3,5 tonnes et de véhicules sanitaires qu’elle avait fournis à l’armée française. Ce n’est en revanche que le 15 juillet qu’une ordonnance de réquisition émanant du bureau d’approvisionnement de la Luftwaffe (GL) est affichée sur les portes des usines d’Asnières et de Gennevilliers de la société Chausson. Début août, c’est le tour de l’usine Delaunay-Belleville de Saint-Denis[12]. Mais, dans ce dernier cas, la réquisition est levée dès le 12 août à la suite de démarches faites par la préfecture de la Seine sur demande de la direction.
Jean Berliet, seul dirigeant de l’entreprise éponyme à être resté dans l’usine de Vénissieux depuis l’exode, obtient l’assurance des Allemands qu’il ne sera pas considéré comme prisonnier de guerre malgré son statut d’affecté spécial. D’après deux témoignages recueillis à la Libération, il convoque un de ses contremaîtres, un dimanche, pour réparer le side-car d’un officier de la Wehrmacht, et demande à un autre, Jean Faure, le 23 juin, de se mettre à la disposition de l’occupant : « Jean Berliet me dit de faire tout ce que les Allemands me demanderaient et leur donner tout ce qu’ils désireraient »[13].
De retour à Paris le 12 juillet, Louis Willème retrouve son usine de Nanterre partiellement pillée et réquisitionnée depuis quelques heures par le colonel Kurting, membre des chemins de fer allemand (Deutsche Reichsbahn). Quelques jours plus tard, le capitaine d’un parc de la Wehrmacht (HKP 503) installe un atelier de réparation de moteurs dans une partie de l’usine comme chez Renault à Billancourt et au Mans, Berliet à Courbevoie, Panhard à Orléans. Cette dernière entreprise fait également l’objet d’une saisie provisoire ; les Allemands se sont en outre emparé des machines immobilisées en gare pendant la débâcle ainsi que de plusieurs châssis dans le Loiret. A l’instar de leurs confrères, les Panhard tentent de faire lever la réquisition et s’adressent pour cela à leur chambre syndicale qui les renvoient à la préfecture de la Seine[14].
Lorsque les dirigeants de Chausson, Levet, directeur général, et Plegat, directeur commercial, rentrent à Paris, le pillage des machines de l’entreprise est en cours ; en plus de la menace d’un remplacement pur et simple de la direction française, la crainte de perdre installations et outillages a joué un rôle dans la volonté de reprise rapide[15]. Au-delà des reconstructions historiques postérieures, l’impression qui domine alors est celle d’une victoire durable de l’Allemagne dont il faut prendre son parti. Certains ne font d’ailleurs pas très bien la distinction entre l’armistice et la paix. C’est le cas du vieux Marius Berliet : la franchise bourrue avec laquelle il dépose à la Libération semble constituer le témoignage le plus proche de la réalité. Avant 1943, à part l’exemple très exceptionnel du carrossier Jacques Kellner, qui sera fusillé par les Allemands en mars 1942, aucun patron ne songe de près ou de loin à entrer en résistance.
En fait, côté français, la volonté de reprendre le travail est partagée par une grande partie de la population : industriels, craignant de voir disparaître un outil de production qui est souvent leur patrimoine familial ; ouvriers au chômage qui, pour beaucoup, n’ont plus aucun moyen de subsistance ; gouvernement de Vichy qui veut remettre la France au travail et instaurer un nouvel ordre politique et social ; Parti communiste clandestin, qui dans L’Humanité appelle à fraterniser avec les soldats de la Wehrmacht et à ouvrir les usines sans la présence des patrons[16].
Le 24 juillet, Léon Noël adresse une circulaire aux préfets dans laquelle il va jusqu’à menacer d’expropriation et de confiscation partielle tous les industriels qui n’auraient pas rouvert leurs usines : « Si la carence patronale n’apparaissait pas justifiée par la force majeure, le gouvernement se verrait obligé d’envisager une procédure d’expropriation dans des conditions à déterminer, mais qui ne comporterait pas l’indemnisation totale du patron défaillant »[17].
L’industrie automobile est l’une des premières à avoir rouvert ses usines à la date du 1er juillet 1940 comme le confirme un rapport allemand[18]. Seule Latil est toujours à l’arrêt uniquement parce qu’elle n’a pas encore été aryanisée : « Elle est entièrement la propriété de juifs[19] », constate à cette date un compte rendu de la Rü-In.
La reprise étant acquise, qu’allaient donc produire les entreprises ?
Production civile ou matériel de guerre : un faux dilemme ?
Même avec le précieux concours des autorités françaises, la remise en route de l’économie constituait une tâche immense, d’autant plus que les services allemands étaient en sous-effectif chronique. Les autorités d’occupation considéraient l’industrie automobile comme prioritaire pour leur effort de guerre. Ce secteur présentait l’avantage de fournir des véhicules à la Wehrmacht, mais aussi de travailler pour l’aéronautique et de produire des engins blindés. Or le Reich avait besoin de ce matériel, une partie de ses chars ayant été usée ou détruite pendant le « Blitz ». Le 20 juin, à Berlin, le général Karl Zuckertort fit le point sur l’état des fabrications des Panzers III et IV. Il réalisa une projection pour les mois suivants et consigna les nombreux goulots d’étranglement qui handicapaient la production allemande (main-d’œuvre, pièces forgées, roulements à bille, etc.)[20]. La défaite de la France constituait à cet égard une manne inespérée : l’industrie de l’Hexagone pouvait réparer le matériel de l’armée française, qui venait d’être saisi par la Wehrmacht, et fabriquer des pièces détachées, délestant ainsi l’économie du Reich qui travaillait à flux tendu. Adolf Hitler avait interdit la production de matériel de guerre neuf en France, décision qui se traduisit par le décret-loi de Vichy du 9 juillet, puis par la loi du 15 octobre 1940. Mais cette position allait connaître des adaptations et une réelle évolution au cours de la première année d’Occupation.
Tout au long du mois de juillet, les constructeurs français furent sollicités de manière pressante par les Allemands pour réparer ou fabriquer du matériel blindé. Ou bien ils refusaient et risquaient de se voir remplacer par des administrateurs provisoires, comme le prévoyait déjà l’ordonnance allemande du 20 mai 1940, ou ils acceptaient et fournissaient ainsi des moyens offensifs à l’ennemi, dilemme qui n’avait pas échappé aux autorités de Vichy. De leur côté, les Allemands possédaient de très nombreux moyens de pression. Ils surent jouer notamment du partage de la France en différentes zones – la plupart des entreprises ayant été coupée de leurs sources d’approvisionnement. C’était le cas de Renault dont l’aciérie d’Hagondage se trouvait désormais sous le contrôle du groupe Röchling en Moselle annexée. Pour les mêmes raisons, Bugatti avait dû quitter son fief de Molsheim tandis que l’outillage de son usine aéronautique de Bordeaux était confisqué et expédié par les Allemands en Alsace[21]. La situation était très délicate pour les entreprises dont les usines principales se trouvaient en zone non-occupée comme Berliet et Michelin, totalement coupées de leurs sources d’approvisionnement, ce qui conduisit ces industriels à démarcher directement les autorités d’occupation.
Certes, les Allemands avaient multiplié les discours rassurants sur l’utilisation « pacifique » de l’industrie – comme le fit Max Thoennissen devant les constructeurs automobiles à la Chambre des députés, le 16 juillet. Les industriels avaient reçu l’autorisation de reprendre quelques fabrications, militaires et civiles, de quoi rouvrir les entreprises et employer des centaines d’ouvriers alors que des milliers de chômeurs se pressaient aux portes des usines. De leur côté, les constructeurs faisaient des efforts pour occuper une partie de leur personnel à des tâches non productives, parfois avec l’appui de l’État français, mais une telle situation ne pouvait durer. Les autorités d’occupation redoutaient par ailleurs une insurrection sociale et surestimaient le pouvoir d’action du PCF dont le gouvernement Daladier avait partiellement brisé les reins pendant la drôle de guerre. A cette crainte se mêlait l’obsession raciale. La Rü-In souligna ainsi dans un compte rendu à Berlin « le manque de fiabilité de la classe ouvrière de Renault, qui est très agitée et très mélangée au niveau des races[22]. »
L’étau se resserra dès le 5 juillet, quand des spécialistes des chars et des industriels impliqués dans cette fabrication – le conseiller d’ambassade Sieburg, le général Karl Zuckertort, le directeur de Daimler-Benz von Hentig, qui intervenait également en tant que commissaire de Renault, et enfin le directeur de la BAMAG[23], Wilhelm von Laroche, prirent contact avec la Rü-In de Paris. Ils constatèrent que la production de poids lourds démarrait lentement, mais que celle des véhicules blindés était toujours à l’arrêt[24]. Il fut donc décidé que des commissaires spécialement chargés de cette fabrication seraient affectés aux principaux établissements français concernés : Schneider, SOMUA, Panhard, Hotchkiss, Renault et enfin l’atelier nationalisé d’Issy-les-Moulineaux (AMX).
En raison de son importance, la société Schneider fut jugée prioritaire par les Allemands. D’après le journal de guerre de la Rü-In, daté de la première semaine de juillet 1940, le seul représentant de l’entreprise alors présent à Paris se montra complaisant à l’égard des demandes de l’occupant : « Les entretiens avec le directeur général de la société Schneider-Creusot, Monsieur Vicaire, étaient au premier plan. D’une manière générale, ces entretiens se sont déroulés d’une façon très prometteuse. Monsieur Vicaire s’est montré accessible aux souhaits allemands ». De même, Hyppolyte-Eugène Boyer, directeur général de Hotchkiss, « a rendu visite à la Rü-In de Paris [6 juillet] où il « a exprimé sa disposition pour une collaboration avec l’Allemagne (…) Le directeur tentera de se procurer les dessins techniques de réservoirs qui avaient été mis de côté, dans l’intérêt d’une prochaine reprise du travail de ses ouvriers. » Le Journal de guerre allemand note en revanche : « On se heurte à des difficultés dans la coopération avec Renault. »
A cette époque, Louis Renault venait à peine de rentrer en France et se trouvait encore en zone non-occupée. En attendant son retour, les négociations étaient menées par René de Peyrecave, François Lehideux et le directeur commercial, Albert Grandjean, qui parlait l’allemand. Le journal de guerre note à la date du 9 juillet : « Les directeurs français de Renault partent du point de vue que, conformément aux négociations de la Commission d’armistice, les sociétés françaises ne sont pas obligées de fabriquer du matériel de guerre qui pourrait être utilisé contre l’Angleterre. [25] »
Le 17 juillet, Léon Noël convoque plusieurs constructeurs automobiles à l’hôtel Matignon et leur renouvelle « les instructions de faire tourner les usines en acceptant les commandes allemandes, sauf pour les fabrications spéciales telles que : armes et chars, pour lesquelles il demandait qu’on lui en réfère spécialement.[26] » Sans doute influencé par la position de Renault et le discours du représentant de Vichy, le directeur des établissements Hotchkiss, Hippolyte-Eugène Boyer, manifeste, le même jour, « des états d’âme au sujet de toute nouvelle fabrication de véhicules de combat et de véhicules de traction français ».
En fait, SOMUA et Hotchkiss ont déjà commencé à réparer du matériel de guerre pour la Wehrmacht : trois contrats sont ainsi passés avec SOMUA le 12 juillet pour la maintenance et la remise en état de véhicules de combat blindés S-35 et 15 véhicules de traction avec système de grue. Le 22 juillet, un autre contrat est passé avec Hotchkiss pour la maintenance et la remise en état de trois véhicules blindés du même type[27]. Les Allemands notent le 13 juillet : « Après s’être concerté avec l’ambassadeur Noël, Monsieur Boyer, directeur général adjoint de la société Hotchkiss, déclare qu’il mettra en œuvre les commandes allemandes de façon loyale et irréprochable. » Et le lendemain : « La finition de la fabrication des 7 véhicules de combat de 12 tonnes disponibles démarre demain dans la société Hotchkiss, avec pour l’instant 25 ouvriers français. » Le 14 juillet, la Rü-In est informée par Berlin que le matériel blindé est désormais placé en première priorité des fabrications, avant la Luftwaffe.
Louis Renault rentre à Paris le 23 juillet au soir. Quelques heures plus tôt, il écrit une lettre à François Lehideux, avec lequel il est en conflit depuis les années 1936-1937, pour lui ôter toutes ses responsabilités au sein de l’entreprise. Cette décision allait jouer un rôle déterminant dans la suite des événements. Le lendemain, l’industriel rencontre le commissaire Sieburg qui lui demande de réparer des chars français saisis par la Wehrmacht : Renault refuse. Le Journal de guerre de la Rü-In précise à la date du 26 juillet : « Le Général Zuckertort veut balayer les difficultés occasionnées par Monsieur Renault au sujet de la réparation de blindés en mettant M. Renault face à la décision suivante : soit il consent à réparer sans opposition et sous régie française les blindés à Paris, soit il court le risque que la régie allemande s’en occupe elle-même et organise ainsi les attributions de charbon, d’électricité, etc., uniquement pour les besoins allemands. »
Le 28 juillet, les autorités d’occupation font le point sur les négociations et remarquent : « Le directeur de Renault, Grandjean, a justifié son refus par le fait que le gouvernement français est en train de préparer une loi selon laquelle la fabrication d’engins de guerre n’est pas autorisée. Sous l’influence de Renault et de Levassor, la position jusqu’à présent bienveillante des sociétés Hotchkiss et SOMUA s’est durcie (…) Tous les moyens à disposition doivent être utilisés pour briser ces résistances ». Les réglementations sur la gestion de l’économie et la gestion des entreprises « offrent la possibilité de punir les dirigeants d’entreprises récalcitrants et n’excluent pas que l’on puisse les remplacer par des commissaires administrateurs, sans préjudice d’autres mesures.[28] »
Louis Renault est convoqué par le général allemand, le 31 juillet mais il continue de se retrancher derrière une décision du gouvernement français. Dès lors, les choses se précipitent : le 1er août, l’industriel est à nouveau convoqué par le général Zuckertort qui, cette fois, lui remet un ultimatum. Un texte identique est adressé à Panhard qui cède le lendemain. En revanche, Louis Renault temporise : il propose de réparer des chars dans les usines du Mans sous réserve d’un accord du gouvernement français et réclame un délai de dix jours pour donner une réponse. Après une entrevue avec l’ambassadeur Noël, il se met en retrait des négociations, décline la convocation des autorités supérieures allemandes et laisse ces dernières négocier un compromis avec François Lehideux et le baron Petiet, président de la Chambre syndicale des constructeurs d’automobile, le 4 août, à l’hôtel Majestic : les réparations de chars français seront effectuées directement par les Allemands dans deux ateliers réquisitionnés, situés en périphérie de l’usine.
Mais entretemps, François Lehideux a fait circuler une pétition dans l’entreprise insinuant que son oncle par alliance avait cédé à l’occupant. C’est cette accusation mensongère, riposte à la décision que le constructeur avait prise de se débarrasser de son neveu, qui pesa très lourdement en 1944 contre Louis Renault, d’autant plus que Lehideux en fit part dès l’été 1940 à Léon Noël et à Alexandre Parodi, alors fonctionnaire de Vichy, et futur ministre du Travail à la Libération. Quand, en 1951, l’administration fiscale fit des recherches dans les archives judiciaires pour essayer d’établir la responsabilité de Louis Renault au début de l’Occupation, elle découvrit que l’ensemble de l’accusation concernant la prise de contact personnelle reposait uniquement sur deux dépositions faites à la Libération par l’ancien ministre de Vichy, François Lehideux[29] !
Au moment des faits, la vision des Allemands était très différente. Le général Franz Barckhausen, qui dirigeait l’État-major de l’économie de la défense et de l’armement en France, déclara ainsi le 6 août 1940 devant tous les officiers responsables de la Rü-In :
« En ce qui concerne le cas de Renault et Panhard, je m’en suis entretenu avec le général Thomas et le général Hünermann[30]. Les deux sont de l’avis que les sociétés ne peuvent pas refuser d’effectuer pour nous des travaux de remise en état en se basant uniquement sur les négociations en cours à Wiesbaden. Nous pouvons absolument exiger cela. Sur ce, Panhard s’est montré coopérant. Renault persiste dans son refus.[31] »
Cette attitude contraste avec celle des dirigeants de Schneider. Le Journal de guerre de la Rü-In précise en effet à la date du 5 août :
« Le directeur Beckhäuser de la société Wagner de Dortmund nous informe ce jour qu’il s’apprête à conclure un contrat avec Schneider-Le Creusot pour la production de pièces pressées lourdes destinées à des bombes lourdes d’aviation.
« Malgré le fait qu’un spécialiste considérerait sans conteste ces commandes comme un contrat d’armement, le directeur Vicaire de Schneider-Le Creusot n’a pas d’états d’âme pour l’acceptation de ce contrat.
« Ce qui semble déterminant pour le directeur Vicaire, c’est que ce contrat d’armement ne soit pas identifiable en tant que tel par la majorité de son personnel [souligné par nous].[32] »
Le rapport du 1er août concernant Charles Schneider stipulait déjà :
« Le directeur d’entreprise Monsieur Schneider de la société Schneider-Le Creusot a fait part à la Rü-In de son obligeance pour travailler avec l’Allemagne dans l’intérêt des 11 000 anciens employés faisant parti de son personnel (…)
« Pour les commandes de matériels de guerre, il demande que les oppositions et les résistances soient balayées par l’intermédiaire du gouvernement français.
« Il prétend disposer de suffisamment de charbon, de ferraille et de fer pour produire en continu.[33] »
Et le 24 août, les Allemands constate que les « relations avec la société Schneider – Paris et Le Creusot – se développent tellement bien que le gendre de Schneider [Pierre de Cossé, duc de Brissac, ndr] a été libéré » et « placé en tant que directeur de la société Le Matériel électrique » à Champagne-sur-Seine qui travaille pour la Wehrmacht »[34].
Cette attitude face aux commandes d’armement allemandes, au début de l’Occupation, est exceptionnelle. La situation de l’industrie au cours de l’été 1940 ne reflète d’ailleurs en rien celles des périodes suivantes, que ce soit en matière d’effectifs, d’organisation et d’horaires de travail ou d’attitude patronale. Rappelons à ce sujet que le directeur du Creusot, Henri Stroh, fut déporté à Buchenwald. A cela s’ajoutent des facteurs qui n’existent pas au cours de la reprise comme les bombardements alliés, les prélèvements de main-d’œuvre, les sabotages de la Résistance ou l’aryanisation des entreprises. Nous sommes dans une perspective de victoire durable du IIIème Reich : la bataille d’Angleterre est loin d’être terminée ; ni les États-Unis ni l’URSS ne sont entrés en guère.
A la fin du mois d’août 1940, les Français apprennent que l’industrie automobile sera soumise à un programme fixé à Berlin dans le cadre du plan de quatre ans. Les offices centraux de placement des commandes allemandes (ZAST) sont créés le 26 août dans l’Europe occupée (Paris, Bruxelles, La Haye) et leur mission définie le 15 septembre. Les commandes civiles sont déjà strictement contingentées ou tout simplement interdites. Du côté de Vichy, l’organisation de l’économie dirigée est également en formation : le service des commandes allemandes (SCA) de l’ingénieur général Jean Herck est créé le 24 août 1940, le COA le 30 septembre (dirigé par François Lehideux, le lendemain) et l’Office central de répartition des produits industriels (OCRPI) de Jean Bichelonne, à partir de janvier 1941. Avant même que cette organisation administrative ne soit effective, la marge de manœuvre des industriels est ténue d’autant que les Allemands décident de chaque élément important de la vie des entreprises : type de matériel à fabriquer et volume des commandes, salaires et horaires de travail, fourniture d’énergie et de matières premières, mesures de sécurité et permis de circuler… Certes, Jacques Kellner parvient à fabriquer des meubles destinés à la Wehrmacht pour éviter les fabrications aéronautiques et automobiles, tandis que la société des avions Kellner-Bechereau, repliée en grande partie à Alençon, ne livre pratiquement que le secteur français[35]. Mais cette politique de reconversion, envisageable pour de petites entreprises – la première emploie en moyenne 27 personnes sous l’Occupation – ne l’est pas pour des géants industriels comme Renault, Peugeot et Citroën dont l’effectif moyen oscille entre 10 et 20 000 personnes. Si les constructeurs parviennent à décliner certaines commandes en motivant de manière détaillée leur refus – n’oublions pas qu’ils s’adressent à des ingénieurs allemands qui connaissent parfaitement le procédé industriel et contrôlent tous les mouvements de l’entreprise – il leur est difficile d’éluder la fabrication de matériel automobile pour la Wehrmacht, parfois même celle de « fabrications spéciales » comme les munitions et les pièces détachées de matériel d’armement. Sous quelles conditions, à quel moment et dans quelle ampleur l’ont-ils fait ? Avaient-ils des alternatives ? C’est cette marge de manœuvre que les comités d’épuration, la Justice et l’administration fiscale tenteront d’évaluer à la Libération[36].
[1] Malgré l’apport d’études de qualité telles que : Talbot C. Imlay, Martin Horn, The Politics of industrial collaboration during Wolrd War II : Ford France, Vichy and Nazi Germany, Cambridge University Press, 2014. Voir également les travaux de Patrick Fridenson que nous ne pouvons malheureusement citer ici.
[2] Abel Chatelain, « L’industrie automobile française », Revue de géographie de Lyon, 1950, 25/2, p. 106-112.
[3] Sauf les Berliet. Recours en grâce et arrêts de la Chambre des mises en accusation du 27 juin 1946. Ministère public c/Berliet. ADR W 225.
[4] Rapport de l’inspecteur principal Blangonnet, chef du Service des vérifications nationales, 3 septembre 1956, 67 p. ADP ancienne cote Perotin 3314/71/1/ 15 dossier 211.
[5] Mémoire pour la Régie nationale des usines Renault, signé Pierre Dreyfus, 6 janvier 1958. ADP ancienne cote Perotin 3314/71/1/ 16 dossier 211.
[6] Geschichte der Rüstungsinspektion Paris (vom 20.6 – 30.9.40). BA-MA RW24/58. Sur ces questions, voir également Arne Radtke-Delacor, « Produire pour le Reich. Les commandes allemandes à l’industrie française (1940-1944) », Vingtième Siècle, 2001/2 (n° 70), p. 99-115.
[7] Rü-In Frankreich. Kriegsgeschichte VIII-IX 42. F/Id. BA-MA RW24/27.
[8] Fernschreiben Heereswaffenamt N° 13247 vom 28.08. BA-MA RW/19/5088.
[9] SA des anciens Ets Hotchkiss, A. Roth, à M. L’inspecteur de la Rüstungsinspektion A, 20 août 1941. Ministère public c/Hotchkiss. AN Z/6NL/680 f° 51/1.
[10] Complément d’enquête… Ministère public c/Peugeot. AN Z/6NL/80, f° 417, p. 2.
[11] Pour tout ce qui concerne Renault, voir Laurent Dingli, Louis Renault, Paris, Flammarion, p. 379 sq.
[12] Exposé des faits. Ministère public c/Delaunay-Belleville. AN Z/6NL/238. Ministère public c/Delahaye. AN Z/6NL/750. Idem. Ministère public c/Chausson. AN Z/6NL/589.
[13] Déposition de Jean Faure, 28 novembre 1945. Ministère public c/Berliet. ADR 394 W 222 f° 260.
[14] Dépositions de Louis Pasquier et Maurice Abril, 22 juin 1948. Ministère public c/Willème. AN Z/6NL/731 f° 466. Panhard & Levassor à M. le préfet de la Seine – Service des renseignements économiques. A l’attention de M. Reverdy, 2 septembre 1940. ADP. Perotin 6096/70/1 676.
[15] Déposition de Gaston Chausson, 27 février 1948. Ministère public c/Chausson. AN Z/6NL/589 f° 431.
[16] Laurent Dingli, Louis Renault, op. cit.
[17] Léon Noël au préfet de la Gironde, 24 juillet 1940 et Note (jointe) d’information pour les groupements professionnels. ADG 45 W 1.
[18] Tätigkeitsbericht gewerbliche Wirtschaft. BA-MA RW35-726.
[19] Rüstungsinspektion Paris. Z/Ia. Paris, 20.7.1940. Lagebericht. BA-MA RW24/55.
[20] Aktennotiz. Berlin, den 20.6.40. Betrifft: Panzerwagen – Fertigung. – BA-MA RW24/577
[21] Dossier Bugatti – ADG 45 W 1.
[22] Doc. cit. BA-MA RW24/54.
[23] Berlin-Anhaltische Maschinenbau Aktiengesellschaft (BAMAG)
[24] Kriegstagebuch de Rüstungsinspektion Paris. Begonnen 20.6.40. BA-MA RW24/54.
[25] Sauf mention contraire, toutes les citations sont tirées du Kriegstagebuch, doc. cit. BA-MA RW/24/54.
[26] Rapport d’expertise de Bernard Fougeray, p. 46. Ministère public c/x (Delahaye). AN Z/6NL/750 f° 9.
[27] Rüstungsinspektion Paris. Z/Ia. Paris, 20.7.1940. Lagebericht. – BA-MA RW24/55.
[28] Kriegstagebuch Wehrwirtschafts-und Rüstungsstab Frankreich. 4.6.40 – 31.12.40. – BA-MA RW24/2.
[29] Jean Prouhèze à M. le secrétaire du 1er comité, 30 novembre 1951. ADP ancienne cote Perotin 3314/71/1/ 15 dossier 211.
[30] Georg Thomas (1890-1946) et Rudolf Hünermann (1895-1955), respectivement chef et chef d’état-major du Service de l’économie et de l’armement (Wehrwirtschafts-und-Rüstungsamt) depuis 1939. Lexikon der Wehrmacht.
[31] Besprechung der Inspekteure am 6.8.40 beim Wi Rü Stab Frankreich. BA-MA RW24/2.
[32] Kriegstagebuch de Rüstungsinspektion Paris. Begonnen 20.6.40. BA-MA RW24/54.
[33] Idem.
[34] Idem.
[35] Ministère public c/Kellner-Bechereau. AN Z/6NL/757.
[36] Cet article s’inspire d’un travail en préparation, Laurent Dingli, Jacky Ehrhardt, L’Industrie en guerre (1936-1947).
Pour se procurer le n° 7 de L’Aventure automobile, Mai-juin-Juillet 2019, voir la page dédiée des Éditions Heimdal
Au-delà de la réalité des réquisitions allemandes, Renault reste un symbole et c’est aussi à ce titre que l’entreprise fut durement frappée par l’aviation alliée. Le 3 mars 1942 au soir, 222 avions de la Royal Air Force larguent des centaines de bombes sur Billancourt. L’attaque fait 463 morts, des centaines de blessés et laisse un amas de ruines. L’opération militaire britannique se double d’une action de propagande active car des milliers de tracts sont lancés sur la région parisienne. : « Regardez la photo à l’envers de cette feuille. Elle montre des tanks de l’armée allemande pris par les Russes. Ce ne sont pas des tanks allemands, mais des tanks français (…) des chars Renault 35…. Ces chars que les Allemands emploient aujourd’hui contre la Russie furent pris à l’armée française avant l’armistice ou fabriqués depuis dans des usines françaises sous le contrôle allemand (…) Pour égaler l’Allemagne, il faut…que les ouvriers anglais fabriquent trente mille chars. Mais si les ouvriers français fabriquent en même temps dix mille chars, les trente mille chars à fabriquer en Angleterre devront être quarante mille ».
Non seulement la propagande britannique associe le nom de Renault à une production qui lui échappe totalement, mais elle donne à cette occasion des chiffres ahurissants : dix mille chars fabriqués, alors que l’armée française a péniblement disposé de trois mille six cents unités pendant la drôle de guerre et que Renault n’a jamais fabriqué un seul blindé pour l’Allemagne…
Les Britanniques étaient-ils mal renseignés ou s’agissait-il uniquement d’un discours de propagande visant à marquer les esprits ? Il est étonnant de constater qu’au même moment certains services de renseignements alliés évoquaient la production de chars Citroën, une fabrication que l’entreprise du quai de Javel n’a jamais entreprise. De même, Washington affirme que Peugeot sort le double de sa production d’avant-guerre en camions 2 et 4 tonnes. En ce qui concerne Billancourt, les erreurs sur la production paraissent d’autant plus surprenantes que les cadres de Renault, en charge du bureau d’études ou des essais moteurs, étaient des résistants de l’Organisation civile et militaire. Il semble toutefois qu’ils n’aient pas eu la possibilité de fournir à Londres des détails sur les fabrications réelles de Renault ; ce sera d’ailleurs au prix de mille difficultés qu’ils feront parvenir des photographies montrant les impacts du raid britannique sur Billancourt.
La propagande anglo-gaulliste fut alimentée par les Soviétiques et les communistes français à partir de juin 1941. Deux ans plus tard, le Front national de lutte évoque “l’exposition à Moscou du butin pris aux Boches“, commentée sur place par Jean-Richard Bloch “Les visiteurs déchiffrent à haute voix les écriteaux explicatifs ; et tout d’un coup j’entends épeler autour de moi des noms bien connus : Peugeot, Laffly, Renault…Où sommes-nous donc ? A Moscou, dans l’immense et saisissante exposition du matériel de guerre allemand capturé par l’armée rouge”…
C’est une véritable guerre d’information (et de désinformation) dans laquelle la propagande de Vichy et celle des Allemands ne demeurent pas inactives. En mars 1942, la Luftwaffe lance une série de tracts-pièges imitant ceux de la Royal Air Force en y ajoutant avec perversité le décompte des victimes civiles ou des photos de pavillons détruits. Pendant ce temps, le coup bas de la « perfide Albion » est mis en exergue dans toute la presse collaborationniste. Désireux d’exploiter la tragédie à des fins politiques, le secrétaire d’Etat Benoist-Méchin propose “de rassembler les cercueils des trois cents victimes identifiées sur la place de la Concorde, et d’inviter les Parisiens à venir leur rendre hommage“. Du côté de Vichy, la mise en scène idéologique tourne depuis longtemps déjà au sordide.
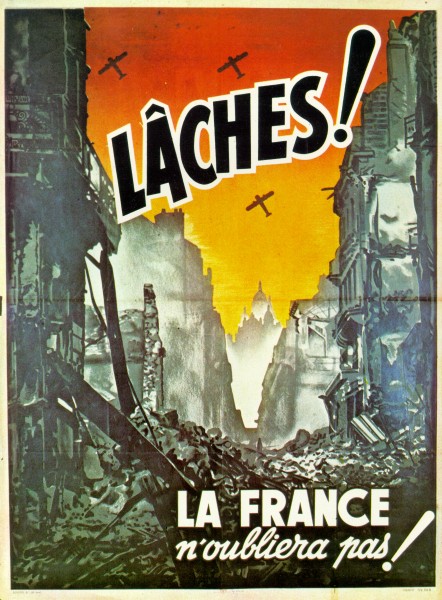
Affiche de propagande de Vichy contre les bombardements © Archives départementales de la Savoie – Coll. Aimé Pétraz
Profondément blessé, Louis Renault réagit, quant à lui, avec beaucoup de passion en composant un pamphlet contre l’Angleterre dont la politique, de 1914 à 1939, aurait empêché, selon lui, tout équilibre européen. “Nous ne comprenons pas“, note l’industriel encore abasourdi par le choc qu’il vient de subir. “Les Anglais commettent une lourde faute d’appréciation. Ils oublient que le peuple français veut survivre ; que privé à nouveau de la fleur de sa jeunesse retenue en captivité, dépouillé d’un grand nombre de ses moyens d’existence, le peuple français doit travailler pour vivre. Ils oublient qu’obligées de travailler pour l’Allemagne les industries françaises ont su maintenir la dignité de la position française et que, si leurs productions sont effectivement utilisées par l’Allemagne, il en va de même des productions agricoles françaises et de tout ce qui se trouve soumis au contrôle allemand en Europe. En attaquant par conséquent des usines françaises, en massacrant la population ouvrière de ces usines, les Anglais, quoi qu’ils en disent, s’attaquent à la volonté de vivre de la France”. Louis Renault cède à l’une de ses colères légendaires de manière particulièrement inopportune. Se sentant injustement accusé, il en vient à développer lui-même des arguments excessifs et injustes. L’égarement dû à la douleur peut se comprendre, mais il ne justifie pas de tels propos. Le bombardement britannique n’est pas une opération dirigée contre la France, et toutes les entreprises sont loin d’avoir maintenu “la dignité de la position française”. Au même moment, l’industriel fulmine contre l’Allemagne “qui l’a obligé à travailler“.
Louis Renault est persuadé qu’il faut reconstruire l’usine sans tarder. Il explique ses motivations à ses vieux collaborateurs en juillet 1942 : “Dès que j’ai appris le malheur, j’ai compris qu’il n’y avait qu’une seule chose à faire : il y avait pourtant beaucoup de destructions ; malgré tout, j’ai senti immédiatement qu’il fallait remettre debout cette affaire, notre usine. Pourquoi ? Parce qu’il fallait qu’elle reste française, parce que je devais penser à tous ceux qui y collaborent depuis si longtemps. Je devais donc la faire tourner…“. Le désir de reconstruire est partagé par l’extrême majorité des ouvriers. Tous sont conscients des menaces de déportation que les Allemands font peser sur le personnel. D’après une note rédigée après la Libération, “un fonctionnaire allemand des services de la main-d’œuvre se présenta à l’usine“, dès le 4 mars, soit le lendemain du bombardement, “et déclara qu’il prenait en charge la totalité du personnel. Devant une menace aussi précise, la totalité des délégués ouvriers demanda instamment la remise en route de l’usine, c’est-à-dire sa reconstruction” ; information confirmée à la Libération par une enquête de police judiciaire ; même le représentant de la CGT, Jacques Chonion, témoigne dans ce sens en octobre 1944. La reprise de l’activité était une question de survie pour la plupart des ouvriers.
Assurer la reconstruction de l’usine ne signifie pas cependant qu’il faille témoigner d’un quelconque zèle pour les commandes allemandes, comme le souligne Fernand Picard, résistant de l’O.C.M. et membre du bureau d’études de Renault : “Pour le moment, il faut bluffer, afin de faire croire aux Allemands que l’usine tournera bientôt pour éviter que nos ouvriers soient dirigés sur les usines du Reich et nos machines réquisitionnées“. Il ajoute le 12 mars : Louis Renault “sait fort bien que les promesses qu’il fait aux commissaires ne seront pas tenues. Gagner du temps est maintenant le seul mot d’ordre“.
De nouveaux raids aériens, organisés cette fois par les Américains, frappent les usines Renault en avril et septembre 1943. Faut-il reconstruire ? Le résistant Fernand Picard analyse la situation avec lucidité : “Le plus sage serait certainement de mettre en sommeil la production. Mais alors que faire du personnel, onze mille ouvriers et quatre mille cinq cents collaborateurs ? Les congédier ? Mais ne seront-ils pas envoyés dans les bagnes allemands, vers l’organisation Todt ou vers d’autres usines françaises au service de l’armée nazie ? Les conserver, mais comment assurer chaque quinzaine les salaires et chaque mois les appointements ? Dilemme terrible… “. Renault tente alors de décentraliser ses ateliers ce qui a pour conséquence de ralentir la production comme le souligne une note allemande interceptée par la Résistance : “La diminution de la production est due aux conséquences des bombardements de septembre 1943 sur Renault, aux mesures de décentralisation prises par Renault, aux sabotages chez Peugeot-Sochaux et Berliet-Lyon“. Dès 1943, les comptes rendus de la Résistance témoignent des tentatives allemandes visant à démanteler les usines françaises. Mais, précise l’un d’eux, Renault “essaie de sauver une partie de ses machines“. En août 1944, le Comité français de libération nationale (CFLN) constate avec satisfaction : “A moins de destructions nouvelles, les usines françaises ont sauvegardé leurs possibilités de fabrication“.
Au cours de l’été 1940, le souci essentiel du constructeur est de préserver l’outil industriel et de donner du travail à ses ouvriers, afin que ses derniers puissent nourrir leur famille. Louis Renault écrit le 3 octobre 1940 : “Ceux de nos ouvriers qui ont pu être réembauchés ne travaillent que vingt-quatre heures par semaine et, par conséquent, ne touchent que la moitié du salaire normal ; quant aux douze mille ouvriers pour lesquels je n’ai pas de travail et qui, par conséquent, sont réduits au chômage intégral, ils ne reçoivent que 10 francs par jour, ce qui ne leur permet même pas, dans les conditions de vie actuelle, d’acheter le strict (minimum) indispensable (…) Conscient de cette situation… nous avons organisé un service qui a pour mission de former des équipes que je propose aux maires des grandes villes, aux préfets et aux chefs de chantiers importants… J’ai pu ainsi placer à Orléans une équipe de trois cent cinquante ouvriers, et je suis en pourparlers avec la société d’exploitation landaise“. La direction tente alors d’éviter que les chômeurs soient recrutés par les Allemands. Henri Duvernoy, chef du personnel, écrit à Christiane Renault dès le 23 août 1940 : “La plupart de nos apprentis et des enfants de nos ouvriers et collaborateurs sont actuellement au chômage et livrés à la rue. Si nous ne réussissons pas à nous occuper d’eux, très bientôt d’autres s’en occuperont, et les solutions qui seront données à cette question risquent d’être très pénibles à nos coeur de Français“. En mars 1941, mille cent quinze ouvriers des usines Renault sont employés dans les chantiers extérieurs : Orléans, Beauvais, Sully-sur-Loire, Meudon, Versailles, La Rocade-Saint-Germain, ainsi que dans les gares de Puteaux, Saint-Cyr, Montrouge, Bougival et Rueil. En province, ils sont occupés au déblaiement des villes bombardées ; en région parisienne, à des travaux divers : débrouissaillement, terrassement, nivellement de terrain, travaux forestiers et manutentions dans les gares.

Enfants évacués, arrivant à la gare d’Austerlitz. Paris, 31 août 1939. RV-880201 © Albert Harlingue / Roger-Viollet – Paris en images
Pendant l’Occupation, Christiane, Louis et Jean-Louis Renault ont déployé des efforts importants pour venir en aide au personnel, soit en matière de ravitaillement, soit en ce qui concerne les prisonniers et les victimes des bombardements. De nouveaux services sociaux sont créés, près de 200 millions de francs dépensés tandis que le stock clandestin de l’usine est mis à contribution. Depuis 1940, treize nouvelles cantines ont été construites et aménagées pour une somme de 13 millions de francs. L’entreprise, qui pouvait servir cinq mille repas par jour avant guerre, en fournit désormais seize mille pour une somme de dix francs (alors que l’effectif de l’usine a chuté de moitié au cours de la même période). L’aide s’étend aux produits alimentaires, à l’habillement et au chauffage à une époque où les denrées du marché noir sont inaccessibles aux ménages ouvriers, les tickets de rationnement ne permettant d’obtenir que 1200 à 1960 calories en 1942. Poursuivant les oeuvres qu’elle avait engagées pendant la drôle de guerre, Christiane Renault organise des colonies de vacances au camp de Nemours pour environ mille cinq cents enfants, mais aussi trois maisons d’accueil herbergeant mille neuf cents enfants de prisonniers et de sinistrés ; cette assistance est complétée par les consultations médicales gratuites et diverses prestations dont l’installation d’un cabinet dentaire à Herqueville. Après le premier bombardement, Louis Renault met à la disposition du comité social des usines le château des Buspins pour y accueillir les enfants de sinistrés. Au cours du seul mois de mai 1943, dix-huit mille cinq cents journées de maladie sont indemnisées par la société de secours mutuels. Enfin, de 1942 à 1944, Renault dépense 24 millions de francs uniquement pour maintenir l’apprentissage.

Vendeur de semelles de caoutchouc. Paris, janvier 1941. LAP-1377 © LAPI / Roger-Viollet – Paris en images
Jusqu’en mai 1941, il n’y a pas d’agitation particulière aux usines Renault. A partir de cette date, les privations, la fatigue et la présence des Allemands commencent à peser sur le personnel. Quelques jours après l’invasion de l’URSS, des ouvriers de Renault sifflent un détachement allemand lors de son passage place Jules-Guesde. Mais la situation paraît calme à la fin du mois. Chez Renault et Citroën, note un rapport de police, la “grande majorité du personnel reste plus préoccupée des problèmes de l’alimentation que des questions politiques“. C’est au retour des congés payés fin août début septembre, que la préfecture de Boulogne signale les premiers sabotages. Les autorités pressent les dirigeants de l’entreprise de mener une enquête technique. Mais ces derniers ne comptent pas s’associer à des mesures de répressions. “La direction des établissements Renault observe à ce sujet le plus grand mutisme“, constate le commissaire de police. Au début du mois de décembre, un “centre clandestin de propagande communiste” est démantelé par la police de Vichy. Quatre des dix militants arrêtés sont inculpés, les six autres relâchés. En juillet 1942 encore, vingt-cinq militants qui avaient reconstitué les cellules au sein des usines Renault sont arrêtés. L’un d’eux, Jean Baudin, sera déporté.
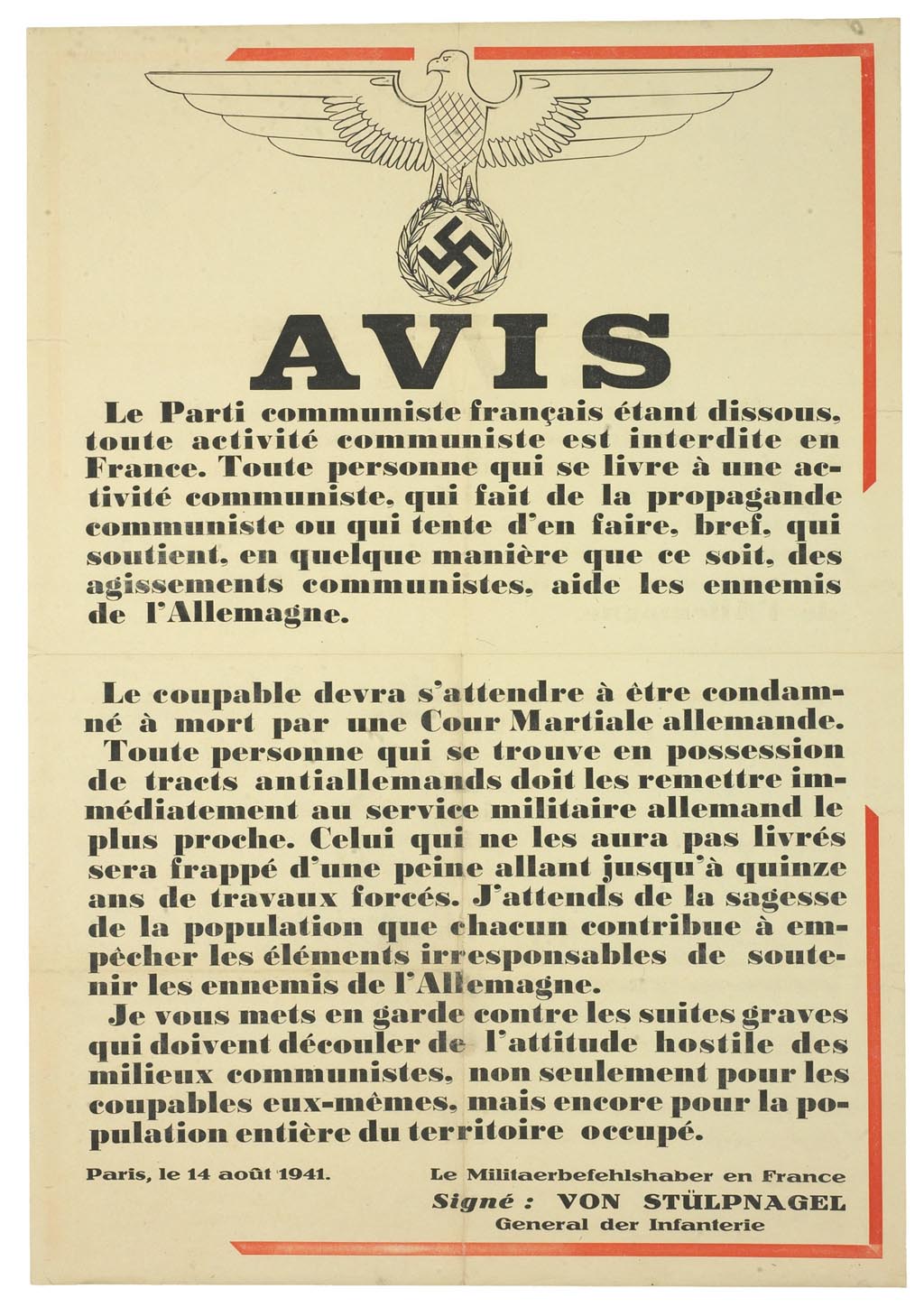
Affiche émanant du commandant militaire en France, concernant la dissolution du parti communiste et l’interdiction de toute activité communiste ou de soutien aux communistes © AN 72AJ/795
Parallèlement aux actions individuelles ou communistes, les représentants de l’Organisation civile et militaire (OCM), tels Fernand Picard, Charles Astolfi, Robert de Longcamp, René Delmotte ou Jean Riolfo, s’organisent au sein de l’usine. Leur activité principale consiste à lutter contre le STO, à retarder ou à saboter la production, à fournir des renseignements sur l’impact des bombardements alliés. Robert de Longcamp et son épouse organisent en outre des parachutages en liaison avec Londres. On notera que, excepté Delmotte, les membres de ce réseau sont des proches collaborateurs de Louis Renault et travaillent quotidiennement avec lui. Fernand Picard est membre du bureau d’études, Charles Astolfi responsable du département moteurs, Riolfo des essais, Robert de Longcamp, ancien directeur des usines du Mans, chef du service des tracteurs agricoles, Raymond Delmotte, chef pilote, responsable des essais chez Caudron-Renault. La majorité des ouvriers demeurent toutefois en retrait de ces actions. Au cours de l’Occupation, leurs revendications portent essentiellement sur des augmentations de salaire et l’obtention d’un temps de travail suffisant pour vivre.
En 1941, le comité populaire, organe communiste clandestin, rencontre la direction des usines Renault pour régler la question des salaires. L’année suivante, René de Peyrecave, jugeant les tarifs officiels insuffisants, donne satisfaction aux revendications ouvrières. Mais les Allemands ne veulent pas entendre parler d’une telle mesure : rien ne doit entraver les départs pour le Reich. Les mesures prises en faveur de la “relève” puis du Service du travail obligatoire (STO) ne font qu’augmenter le mécontentement au sein des usines, même si certains ouvriers sont favorables à une expatriation momentanée. Un certain nombre d’entre eux seront d’ailleurs sanctionnés à la Libération par le comité d’épuration des usines Renault. Il n’en reste pas moins que la majorité du personnel s’oppose farouchement aux mesures prises par l’occupant et Pierre Laval. Des ouvriers tentèrent d’organiser une grève, mais le 14 décembre 1942, des soldats allemands, baïonnettes au canon, pénètrent dans les usines, choisissent quarante ouvriers au hasard et les font monter dans un camion “qui a pris une destination inconnue”. Nous ne savons pas quelle a été la réaction de la direction dans cette affaire ni même le sort des quarante ouvriers. Nous avons pu toutefois retracer quelques parcours individuels. Ainsi le capitaine Renouard, magasinier aux usines du Mans, est-il arrêté sur dénonciation anonyme pour avoir tenté d’organiser un parachutage en 1943. Torturé et déporté à Oranienburg, il décèdera de septicémie suite à ses blessures. Ernest Biette, membre de l’organisation spéciale du Parti communiste, entré chez Renault le 27 juillet 1942, est appréhendé le 28 septembre pour ses activités de résistance chez Brissonneau à Creil où il travaillait précédemment. Après avoir été incarcéré dans différentes prisons françaises, il est transféré à Dachau avant d’être employé à la fabrication des Messerschmitt 262 à réaction, au sud d’Augsbourg. Il réintégrera l’usine en février 1946.

Résistants fusillés à Billancourt près des usines Renault. RV-364536 © Roger-Viollet/ Roger-Viollet/Paris en Images
Des interventions directes en faveur des membres du personnel arrêtés par les Allemands sont attestés. A diverses reprises, le patron de Billancourt et son directeur sont intervenus pour obtenir la libération de prisonniers. René de Peyrecave auprès du commissaire von Urach, et Louis Renault en s’adressant directement à la police allemande, leurs lettres “avaient pour objet d’obtenir la mise en liberté provisoire d’un ingénieur, d’un chef de service et d’un chef d’atelier“. Le patron de Bilancourt intervient en outre personnellement pour faire libérer Jean Riolfo, résistant, membre de l’OCM, ainsi que plusieurs personnes arrêtées par les Allemands le 19 mai 1943 : “Quand nous fûmes libérés, après cinquante-trois jours au Cherche-Midi, je fus convoqué rue des Saussaies, et le chef de la Gestapo me dit : “Nous vous libérons à la suite des démarches pressantes de M. Renault, mais vous serez surveillé“. C’est encore le sang-froid de René de Peyrecave qui permet d’éviter une arrestation massive d’ouvriers par la Gestapo, suite à la manifestation du 11 novembre 1943. Quelques mois plus tôt, le P-DG des usines Renault est intervenu personnellement auprès du maréchal Pétain pour obtenir la grâce de Robert Heitz, condamné à mort par le tribunal militaire allemand de Strasbourg.

Meeting du travail, Paris, Magic City, février 1942. Délégation de Renault-Citroën sous un portrait géant de Jacques Doriot entouré d’insignes du P.P.F. LAPI-6425 © LAPI / Roger-Viollet/Paris en Images
Pour être complet, il faut ajouter que des membres du personnel des usines Renault et Citroën, dans une proportion qu’il est impossible de définir avec précision, ont adhéré aux thèses de la Révolution nationale et parfois aux pires mouvements collaborationnistes comme le Parti populaire français de Jacques Doriot.
Quant à Louis Renault, il demeure fidèle, au cours de l’Occupation, à la ligne de neutralité politique qu’il s’est fixé tout au long de sa vie. Il n’a jamais adhéré aux thèses du régime de Vichy et à la Révolution nationale. C’est pendant la Grande Guerre, alors qu’il commandait une escadrille, que René de Peyrecave a entamé des relations amicales avec Philippe Pétain. L’un de ses fils, Henri, récuse aujourd’hui le terme d’amitié qui sous-entend selon lui une égalité entre les deux hommes, lesquels auraient toujours conservé le sens de la hiérarchie militaire dans leurs relations. Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel de nos connaissances, rien ne vient attester d’un soutien politique de René de Peyrecave au régime de Vichy, bien qu’il fût très certainement maréchaliste comme des millions de Français. L’administrateur des usines Renault a par ailleurs refusé le portefeuille ministériel que lui a offert le maréchal Pétain au début de l’Occupation.
En ce qui concerne le prélèvement de personnel par l’occupant, les documents et témoignages recueillis indiquent une résistance passive de la direction. Dès le mois de décembre 1941, Louis Renault déclare à ses principaux collaborateurs : “Il faudrait donc faire comprendre à ceux qui partent (en Allemagne, ndla) qu’ils travaillent contre leur pays“. Six jours avant la publication de la loi sur le STO, le 10 février 1943, Louis Renault s’adresse personnellement au général allemand Weigand afin d’empêcher le départ des ouvriers en Allemagne : “Je ne vois personnellement pas l’intérêt, pour la production générale de votre armement, qu’il peut y avoir à déplacer des ouvriers qualifiés et entraînés à une cadence rapides que sont les ouvriers Renault pour les transplanter du jour au lendemain en Allemagne et les disperser systématiquement dans les usines les plus diverses, dans des métiers ne correspondants pas aux leurs“. Le 21 février 1943, le responsable allemand de la main-d’oeuvre répond sur un ton menaçant : “Je suis informé par la Werbestelle XVI de Boulogne que vous n’envoyez à la visite médicale, ou que vous ne désignez de la main-d’oeuvre, qu’en nombre tout à fait insuffisant. Nous ne pouvons pas tolérer à l’avenir une façon de procéder aussi lente (…) Je regretterai infiniment si, pour assurer l’exécution, j’étais obligé de prendre les mesures appropriées“. Le 3 mars encore, Louis Renault demande à l’Oberbaurat Kummer qu’aucun nouveau prélèvement de main-d’oeuvre ne soit effectué tout au long de l’année 1943.
Quelle est le bilan de l’Occupation ? Dans quelle mesure les bombardements ont-ils ralenti la production ? Faut-il imputer les baisses de rendement aux destructions des raids alliés, à la pénurie d’énergie, de matières premières et de main-d’oeuvre ou à l’attitude passive de Renault ? Il est certain que l’ensemble de ces facteurs a joué un rôle. Toutefois, l’impact des bombardements sur la production de Billancourt a été relativement faible, comme l’indiquent les études statistiques de l’armée américaine. En outre, des dizaines de commandes allemandes sont retardées, ou purement déclinées, bien avant les raids alliés et les périodes de graves pénuries. Malgré le pillage effectué en France par l’occupant, les usines Renault parviennent à préserver leur stock clandestin et même, dans certains cas, à l’augmenter. Un seul exemple parmi bien d’autres : à la Libération, les réserves totales de l’usine s’élèvent à la bagatelle de 165.000 tonnes de produits pétroliers. Et pourtant, dès février 1941, la direction de l’entreprise invoquait un prétendu manque de gasoil pour retarder les essais de moteurs destinés à la Kriegsmarine !
Au total, sur les cent quatre commandes enregistrées par Renault pendant l’Occupation, une seule a été livrée dans les délais prévus, trente avec un retard de plus de six mois, une autre trentaine n’était pas achevée dix jours avant la Libération de Paris (dont vingt-deux avec un retard de six mois), enfin, à la même date, dix-sept commandes n’avaient même pas reçu un début de réalisation.
Citroën a livré 37.190 véhicules aux autorités allemandes, Renault 34.270 et Peugeot 27.415, l’effectif moyen des trois grandes entreprises automobiles étant respectivement de dix mille, vingt mille et huit mille personnes.
La production de Renault pendant les quatre années d’Occupation représente seulement 50% de la production de la seule année 1939 pour la France.
En ce qui concerne Caudron-Renault et la Société des moteurs Renault pour l’Aviation, les fabrications réelles ont porté sur 220 appareils Goélands et 1290 moteurs Argus 411 (moteur Renault 6Q modifié). A la fin de janvier 1942, précise l’ordonnance de non-lieu, c’est-à-dire avant le premier bombardement allié, “le nombre des avions pris en charge par les Allemands n’était que de 99 alors que selon le programme imposé, il aurait dû être de 220“. Le commissaire du gouvernement estime que les dirigeants des deux sociétés ont travaillé sans zèle pour l’occupant.
Par l’intermédiaire de son P-DG, René de Peyrecave, la direction de Renault a soutenu des réseaux de résistance comme le firent à des degrés divers le directeur de Citroën, les Peugeot et les Michelin, ces deux derniers ayant payé un lourd tribut à la barbarie nazie (notamment Marcel Michelin, mort en déportation, ainsi que trois directeurs de Peugeot). A la Libération, plusieurs témoignages, et non des moindres, ont attesté du soutien du P-DG des usines Renault à des réseaux de résistance. Le 16 octobre 1944, le colonel de Boilambert, membre de la Mission militaire de liaison administrative, affirme que René de Peyrecave a “aidé en différentes circonstances, les services de la Résistance“. De même, R. Gérard, alias Pen, membre du réseau de renseignements Phratrie, déclare le 20 octobre au ministre de l’Intérieur du général de Gaulle : “Durant l’Occupation, ayant eu plusieurs fois besoin de concours pour nos besoin de résistance, je me suis adressé à M. de Peyrecave. Il a toujours été au-delà de mes demandes, mettant à ma disposition tous les moyens dont il pouvait disposer du fait du poste qu’il occupait. Je me porte donc garant que le patriotisme de M. de Peyrecave ne s’est jamais laissé égarer pendant la période très trouble qui va de l’armistice à la libération du territoire (…) L’action judiciaire ouverte fera certainement ressortir l’inanité des accusations portées contre lui“. Le commandant Chavagnac, chef du réseau Phratrie et ancien responsable de la section de la DGSS, se porte garant de ce témoignage. René de Peyrecave a en outre perdu deux fils et un gendre dans la drôle de guerre et dans les combats menés par les Forces françaises libres. Jean-Louis Renault a devancé l’appel en 1939, mais n’a pas rejoint Londres ou Alger. Enfin, Louis Renault ne s’est pas engagé à titre personnel en faveur de la France libre. Toutefois, il a été approché par le lieutenant-colonel Julien François, l’un des cadres de la résitance, mobilisé dans les Forces françaises libres dès janvier 1941. Pour les besoins de son réseau, ce dernier demanda au patron de Billancourt de lui fournir un camion. Louis Renault lui en proposa cinquante ! Mais le lieutenant-colonel François s’en tint à sa demande initiale et le camion à gazogène et à double-fond fourni par Louis Renault permit de transporter des parachutistes anglais, des résistants et des marchandises pour le ravitaillement.
Les trois premiers constructeurs automobiles ont eu, à peu de chose près, la même attitude pendant l’Occupation : tentative visant à dissimuler les stocks et, dans certains cas, à retarder les commandes allemandes, volonté de donner du travail au personnel et souci de préparer l’après-guerre par des études clandestines. Sur les milliers de sociétés françaises en activité, seules une cinquantaine, parmi lesquelles les principales firmes automobiles, ont été contrôlées directement par des commissaires allemands. Les autres ont travaillé pour l’occupant sans connaître ce type de contrainte (et souvent en zone libre).
Pour la première fois de sa vie, Louis Renault se désintéresse de la production ; il se concentre sur la création de prototypes pour l’après-guerre et sur les questions de fabrications civiles, essentiellement de tracteurs agricoles. Dès le début de l’Occupation, Louis Renault travaille à la réalisation d’une petite voiture de tourisme. Il a été séduit par la KDF, la future Volkswagen, qu’il a pu étudier au salon de Berlin en février 1939, et souhaite concurrencer la 11 cv réalisée par Citroën. Il sait que l’orientation du marché ainsi que les pénuries entraînées par le conflit rendent nécessaire la mise au point d’un modèle de faible cylindrée, susceptible d’être fabriqué à peu de frais et vendu à prix réduit une fois les hostilité terminées. Au mois d’octobre 1940, le constructeur demande à son collaborateur Jean Hubert d’effectuer un rapport sur la question. Dans une note adressée au patron de Billancourt, Jean Guillelmon confirme la nécessité de s’orienter vers la production de petites voitures de type KDF. Dès l’hiver 1940, l’étude de la future 4 cv est entreprise dans le plus grand secret par des chefs de service et des ingénieurs de l’usine. Le matin du 20 mai 1941, Louis Renault surprend Picard, Amise et Serre en train d’examiner la maquette du moteur qu’ils ont réalisée. Aussitôt, Louis Renault donne l’ordre de poursuivre les études malgré l’interdiction signifiée par les autorités allemandes. Il fait ensuite cacher les plans dans un endroit secret, près d’Herquiville, puis installe une partie du bureau d’études avenue Foch, près de son domicile. A la barbe des nazis, les ingénieurs de l’entreprise étudient non seulement le projet de la 4 cv mais aussi, avec Pierre Bézier, les têtes électromécaniques des futures machines-transfert, outillage révolutionnaire qui allait permettre le lancement de la 4 cv en grande série après la Libération. Renault lança enfin pendant l’Occupation le projet de ce qui allait devenir l’autorail unifié de 150 cv utilisé par la SNCF après la guerre.
Isolé sur le plan professionnel, Louis Renault ne l’est pas moins sur le plan privé. Les “amis sûrs et fidèles” se font de plus en plus rares, confie-t-il à l’un de ses proches. Son épouse, après avoir vécu une passion tumultueuse avec Drieu La Rochelle, s’affiche en compagnie de René de Peyrecave. Cette dernière liaison, comme les sympathies d’extrême droite de “Beloukia” sont un secret de Polichinelle. Christiane pousse même la désinvolture jusqu’à se rendre à Vichy au bras du directeur général pour dîner à la table du maréchal. Louis Renault doit subir en silence cettenouvelle humiliation. En 1941, le couple est au bord de la séparation. Heureusement, il y a la présence de Jean-Louis et aussi celle, plus rare, de Jeanne Hatto, la confidente de toujours. L’amitié de celle qui fut le premier amour de Louis est un réconfort à l’heure de la vieillesse, du désarroi et de la solitude. “Je pense bien à tous les soucis, les chagrins qui s’accumulent sur ta pauvre chère usine, mon cher Louis, et je vois bien combien tu dois être chaviré et malheureux de tant de deuils et de malheurs“, lui écrit-elle après le bombardement de mars 1942. Et fin mai 1944, à Pierre Rochefort : “La santé de M. Renault n’est pas sans me donner de l’inquiétude, il n’était pas bien quand je suis partie. Je le savais fort tourmenté… et si peu, si mal entouré“.
Depuis le début de l’occupation, la santé de Louis Renault se détériore. Sa condition physique reste bonne, puisqu’il pratique du sport (natation, vélo…), mais ses facultés intellectuelles sont fréquemment déficientes. Frappé d’aphasie, souffrant d’urémie, sans doute aussi de la maladie d’Alzheimer, il ne parvient plus à s’exprimer ni à écrire distinctement. Tous les documents et les témoignages contemporains sont formels sur ce point. Pour communiquer, il en est réduit à écrire quelques phrases sur des bouts de papier et sa main, impatiente, les cherche désespérément lorsqu’un interlocuteur se présente à lui. Et si la maladie accorde une trêve, Louis Renault laisse échapper des phrases hachées, incomplètes, déformées ; il mélange les mots, se répète, oublie. Cette affection accuse les traits de caractère d’un homme épuisé : le sensibilité extrême, mais aussi les emportements et l’entêtement.
En 1943, les rapports avec René de Peyrecave deviennent sulfureux, et le directeur général menace de démissionner. Il faut toute la compréhension de Jean-Louis Renault pour éviter la rupture. Il écrit au P-DG en novembre 1943 : “Je comprends bien qu’il vous est pénible de voir que trop souvent ce que vous préconisez est contredit par lui et que ce sont seulement les questions de détail qui retiennent son attention, alors que les questions vitales ne semblent pas l’intéresser (…) dans les mois qui vont venir des décisions importantes seront à prendre, des négociations délicates à mener et… plus que jamais, votre présence et votre action seront indispensables“. Afficher une désunion au sein de la direction, poursuit Jean-Louis Renault, “serait approuver à 100% tous les arguments que M. Lehideux avait formulés pour justifier son action (…) tout le monde, à l’extérieur, considère que vous dirigez et que le patron ne s’occupe que d’une façon restreinte de l’ensemble de l’affaire, se spécialisant surtout dans les questions de fabrications (…) vous n’ignorez pas, hélas, l’état de santé de mon père et vous savez bien aussi pour quelles raisons il est malheureusement à craindre qu’il ne puisse plus, et peut-être dans un avenir proche, assurer seul la direction totale de l’affaire…“. En décembre 1943, les jeunes apprentis de l’usine voient apparaître une ombre, une présence effacée et muette qui abandonne la parole à son directeur général.
Evincé de son propre couple, ne jouant plus qu’un rôle de second plan au sein de l’usine, Louis Renault est un homme seul, affaibli et meurtri. “Je suis fatigué de me débattre“, griffonne-t-il d’une main vacillante, avant de tenter quelques phrases à jamais incompréhensibles.
Lire la sixième partie de la Biographie de Louis Renault
Dernière mise à jour : 30 décembre 2015

Panneau indicateur indiquant la direction de l’hôtel Majestic, siège du commandement militaire allemand en France © succession Régine Deforges
Dès le 18 juin 1940, les autorités allemandes prononcent la réquisition des usines Renault. Des affiches apposées aux portes de l’usine annoncent la saisie provisoire des ateliers et des stocks. L’entrée n’est désormais permise qu’à des personnes munies d’une autorisation du gouverneur militaire de la région de Paris. Trois commissaires allemands, issus de la société Daimler-Benz, s’installent à l’usine. Alors que Louis Renault n’est pas encore rentré en France, la volonté de rouvrir les entreprises est générale : elle émane tout d’abord du gouvernement, installé à Vichy, qui dès le 30 juin décide “que la direction Renault devait rester sur place et diriger la fabrication du matériel automobile demandé par l’Allemagne pour les besoins de la région parisienne“. François Lehideux se chargera de cette tâche avec la bénédiction de Pierre Laval. Michelin est déjà entré en contact avec les autorités allemandes afin d’obtenir l’acheminement des fournitures nécessaires à ses fabrications et sans même en référer aux autorités françaises. Quant au contrôleur allemand de Citroën, il adresse une fin de non-recevoir à la direction de l’entreprise qui pense pouvoir limiter sa production à des fabrications civiles. Ce désir de rouvrir les usines est aussi partagé par le PCF (officellement dissous depuis 1939). Les communistes, qui négocient en secret avec les nazis pour faire reparaître légalement L’Humanité, appellent les ouvriers à travailler sous la botte allemande, dès le 4 juillet 1940, et à fraterniser avec les soldats de la Wehrmacht (nous sommes à l’époque du pacte germano-soviétique) :
Ainsi, le journal communiste juge-t-il particulièrement “réconfortant, en ces temps de malheurs, de voir de nombreux travailleurs parisiens s’entretenir amicalement avec des soldats allemands, soit sur la rue, soit au bistrot du coin. Bravo, camarades, continuez, même si cela ne plaît pas à certains bourgeois aussi stupides que malfaisants. La fraternité ne sera pas toujours une espérance, elle deviendra une réalité vivante“.
On peut encore lire dans le même journal à la date du 13 juillet : “Les conversations amicales entre travailleurs parisiens et soldats allemands se multiplient. Nous en sommes heureux. Apprenons à nous connaître, et quand on dit aux soldats allemands que les députés communistes ont été jetés en prison pour avoir défendu la paix (…) on travaille pour la fraternité franco-allemande“. Et le 24 juillet 1940, L’Humanité lançait un appel en faveur de la réouverture des usines sous occupation allemande et sans la présence des patrons :
“Il faut organiser la reprise du travail et, pour ce faire, nous recommandons aux ouvriers :
“1. De s’assembler d’urgence à la porte de l’entreprise dans laquelle ils travaillent ;
“2. De s’organiser en comités populaires d’entreprise ;
“3. De prendre tout de suite les mesures nécessaires pour faire fonctionner les entreprises en désignant un comité de direction parmi le personnel de chacune d’elles.
“Devant la carence et le mauvais vouloir des capitalistes, les ouvriers ont le devoir d’agir, de procéder à l’ouverture des usines et de les faire fonctionner“.
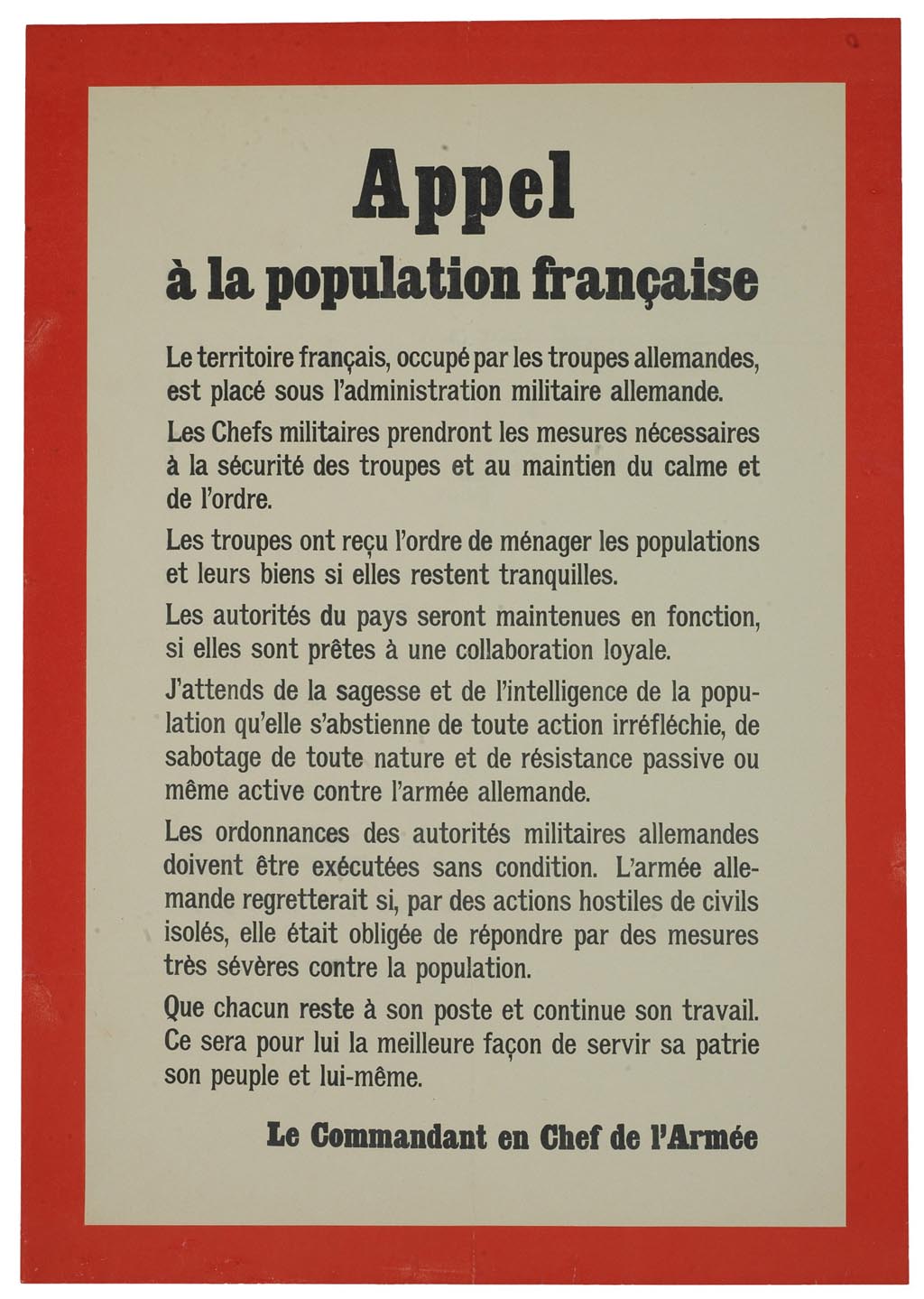
Affiche émanant du commandant en chef de l’armée allemande concernant l’administration du territoire occupé © AN 72AJ/784
Louis Renault, qui a prolongé sa mission au Canada, réussit à prendre l’avion du retour le 22 juin et franchit la frontière à Port-Bou, le 3 juillet. Il se rend ensuite chez le marquis de Fayolle à Tocane-Saint-Apre en Dordogne où il est rejoint par son secrétaire particulier et fondé de pouvoir, Pierre Rochefort. Il se renseigne sur la situation auprès de ses collaborateurs. René de Peyrecave ainsi que plusieurs ministres estiment qu’un retour immédiat de l’industriel à Paris n’est pas opportun. Le 14 juillet, Louis Renault se rend à Vichy pour rendre compte de sa mission aux Etats-Unis, après avoir visité les services de l’Armement repliés à Clermont et à La Bourboule. Six jours plus tard, il repart pour la Dordogne avant de regagner finalement Paris le 23 juillet.
Le lendemain, Louis Renault rencontre l’un des trois commissaires allemands qui occupent l’usine de Billancourt, Karl Schippert, et un spécialiste du matériel blindé, Sieburg. Ce dernier exige que l’entreprise prenne en charge la réparation des chars français saisis par la Wehrmacht pendant la bataille de France. Louis Renault se retranche derrière les décisions du gouvernement français : un décret-loi interdit la fabrication de matériel de guerre pendant toute la durée de l’Armistice. Pour le reste, c’est-à-dire la fourniture de pièces détachées, Louis Renault temporise afin d’obtenir des instructions officielles. D’après une source allemande, Hotchkiss a déjà réparé six chars français le 26 juillet. Or la même source constate que Renault et Panhard refusent de collaborer, entraînant ainsi les réticences des autres entreprises. Les autorités d’occupation souhaitent que Billancourt se charge du montage complet des chars d’assaut, et non pas seulement des réparations. Car si Renault cède sur ce point, c’est toute l’industrie française qui cédera. Louis Renault est donc convoqué par le général allemand Zuckertort le 31 juillet, mais il répète “que tout arrangement à intervenir devrait être agréé par le gouvernement français“. Les Allemands sont à bout de patience. Le lendemain, 1er août, Louis Renault est une nouvelle fois convoqué par le général qui lui remet une lettre-ultimatum : “Vous êtes invité à confirmer par écrit, sans aucune restriction, et jusqu’au 2 août, que vous êtes disposé à faire des travaux de réparation de chars et la fabrication des pièces de rechange“. Il s’agit d’une lettre-type envoyée aux autres constructeurs. Dès le lendemain, Panhard cède à l’ultimatum, tandis que Louis Renault réclame un délai de 10 jours. En l’absence de Léon Noël, représentant du gouvernement français à Paris, il s’entretient avec son fondé de pouvoir qui invite l’industriel à “trouver un accord” et à entreprendre “un simulacre de fabrication“. Ce simulacre, Louis Renault envisage de le faire loin de Billancourt, dans l’usine de Pontlieue, mais seulement “si le gouvernement français donnait son accord“. Renault rencontre enfin Léon Noël le 2 août 1940. Voulant éviter le pillage en cours de l’industrie française, ce dernier déclare qu’il est licite de réparer des chars (mais pas d’effectuer le montage et la finition), ainsi qu’il l’écrit le jour même au maréchal Pétain et contrairement à ce qu’il affirmera devant la Haute Cour de justice après la Libération. Renault ne signe toujours pas l’ultimatum. Alors qu’il s’est rendu à Herqueville, il est convoqué à l’hôtel Majestic par le Dr Elmar Michel qui dirige la section économique du commandement militaire allemand en France. Louis Renault décline cette convocation expresse d’un émissaire d’Hitler qui avait le rang de ministre. L’entrevue a finalement lieu au Majestic, le 4 août, entre le Dr Michel, le baron Petiet, président de la Chambre syndicale des constructeurs d’automobiles et François Lehideux, administrateur-délégué des usines Renault. A l’issue de cette réunion, il est décidé que les autorités allemandes prendraient directement en charge la réparation des chars français avec des ingénieurs allemands et du personnel recruté par eux. Il est intéressant de constater que, pour un tel compromis, François Lehideux fut félicité à la fois par les autorités allemandes et par… Alexandre Parodi qui allait bientôt devenir l’une des plus éminentes figures de la Résistance française !

Inauguration du Salon technique et industriel français (réplique du salon allemand). Au centre : le docteur Michel, Fernand de Brinon (1885-1947), Jean Bichelonne, secrétaire d’Etat à la Production industrielle, le général allemand Barckhausen et M. Magny, préfet de la Seine. Paris, Petit Palais, avril 1941. © LAPI / Roger-Viollet – Paris en images
François Lehideux profite de cette période troublée pour tenter d’évincer son oncle par alliance de l’entreprise. Il déclare à qui veut bien l’entendre que Louis Renault est un homme vieilli et malade, incapable de diriger. Pire, il va jusqu’à prétendre devant Léon Noël, Alexandre Parodi et plusieurs ministres que Louis Renault avait accepté de réparer des chars pour les Allemands et souhaitait revenir sur la mensualisation de la maîtrise. Informé par Alexandre Parodi qu’il est convoqué à Vichy, Louis Renault se rend auprès du maréchal Pétain pour plaider sa cause et conserver la direction de l’usine. Mais, à la suite de ce nouvel incident, François Lehideux, ainsi que son alter ego, Bonnefon-Craponne, et son secrétaire Armand, sont renvoyés des usines Renault. La brouille sera définitive. Lehideux entame alors une carrière à Vichy : Directeur du comité d’organisation de l’automobile (COA), délégué à l’Equipement national, commissaire au Chômage et secrétaire d’Etat à la Production industrielle dans le gouvernement Darlan. En application de la loi du 26 novembre 1940, René de Peyrecave, qui est un ami du maréchal Pétain, devient le premier P-DG des usines Renault.
Pour l’entreprise, la difficulté consiste à répondre aux multiples demandes d’embauche du personnel revenu de l’exode tout en employant ces effectifs pléthoriques à des fabrications civiles. “Dans les divers centres d’hébergement de nos ouvriers repliés en province, constate Louis Renault le 14 août 1940, nous avons fait une propagande très active pour les engager le plus possible à s’embaucher sur place et à s’aiguiller sur divers travaux possibles en province. Mais nous avons rencontré chez tous les ouvriers parisiens un désir réel de retourner à Paris”. Reprendre le travail, oui, mais pour quelle production ? Tenaces, Louis Renault et son directeur A. Mégret, parviennent à récupérer des ateliers réquisitionnés au Mans par Junkers afin de pouvoir y fabriquer du matériel agricole. Mais la réaction des Allemands est rapide et brutale. Le commandant de la Ortskommandantur du Mans investit avec ses hommes les usines d’Arnage puis de Pontlieue. Les sentinelles en armes bloquent toutes les issues tandis que les cadres sont consignés dans leurs bureaux. Le téléphone est coupé, les armoires fracturées, “tous les documents intéressant les fabrications de guerre… systématiquement déménagés, y compris la correspondance générale et tout ce qui concerne les inventaires“. Le directeur refuse de quitter l’usine malgré l’injonction des feldgendarmes.
La situation est similaire à Billancourt où, fin août, les Allemands exigent que tous les véhicules industriels produits par l’entreprise soient destinés à l’armée d’occupation. Louis Renault refuse pourtant d’abandonner ses fabrications civiles. Il rédige une demi-douzaine de notes sur le sujet au cours des quinze derniers jours de septembre, en vain. Fin novembre, il réclame encore l’autorisation de pouvoir fabriquer des véhicules de 6 et 14 cv. Mais le le major Schippert s’en tient au programme fixé par Berlin. De même, le 9 juin 1941, Louis Renault apprend qu’il lui est “interdit de monter des voitures de tourisme” et “que la part de ses constructions réservées au secteur civil serait, à la suite des plaintes de la société Citroën, réduite de façon assez importante“. Un mois plus tard, le programme fixé par le Reich ne comporte plus un seul véhicule de tourisme.

Camion léger gazogène Renault type AHRH – 1942 © Renault communication / PHOTOGRAPHE INCONNU (PHOTOGRAPHER UNKNOWN) DROITS RESERVES
Quelle attitude adopter vis-à-vis des commandes allemandes ? Dans une note composée le 9 septembre 1944 et remise au juge Martin, Louis Renault et René de Peyrecave résument la politique suivie par la direction : celle-ci consistait à décliner toutes les demandes de fabrication d’armes et de munitions (bombes aériennes, grenades, éléments de fusée, culasses de canons légers, et de mitrailleuses…) mais aussi celles qui ne relevaient pas de la construction automobile (pièce d’aviation à tolérances spéciales, pièces destinées à la marine, outillage de précision…). Enfin, lorsqu’une commande n’avait pu être éludée, l’entreprise s’appliquait à en retarder au maximum l’étude et la réalisation sous divers prétextes (bombardements, difficultés d’approvisionnement, déportation de la main-d’oeuvre…). Les documents contemporains des faits confirment les affirmations de cette note rédigée après la Libération. Renault refuse ainsi de réparer les blindés R35 saisis par une compagnie de Panzer à Gien, de construire des gazogènes pour la Kriegsmarine, des pièces de rechange pour char, des plaques de blindages, des douilles, des jeux de fusées, des carters d’aviation… Le 6 juin 1941 encore, une dizaine de commandes allemandes est déclinée sous divers prétextes (non conformité technique, absence de précision, absence de fournitures…). L’année suivante, les autorités d’occupation exigent que des collaborateurs de l’usine se rendent en Allemagne pour y étudier des fabrications militaires. La direction de Renault s’y oppose.
Contrairement à Renault et à Citroën, des entreprises françaises se proposent de fabriquer des munitions pour le Reich : ainsi la société Brandt accepte-t-elle un commande allemande de trois cent mille coups de 25 mm pour canon d’artillerie (licence délivrée le 15 décembre 1940) ; les établissements Luchaire se réservent la fourniture de quatre cent mille douilles (licence du 17 mai 1941) et Alsthom de quatre-vingt-dix mille corps d’obus (munition de 75 modèle 28 DCA). Avant même d’avoir reçu une autorisation officielle, la société Billant (ateliers d’estampage de la Vence) commence la fabrication de trois cent dix mille corps d’obus de 75 DCA tandis que Delaunay-Belleville sollicite du COA, dès l’été 1941, l’autorisation de produire vingt mille têtes de gaînes pour obus de 75. Pendant ce temps, les Allemands se fournissent en Suisse et continuent, jusqu’en mai 1941, à placer des commandes soviétiques auprès des constructeurs français.
Pendant l’Occupation, la réparation de chars Renault fut réalisée directement par les sociétés allemandes Daimler-Benz et M.A.N. dans deux centres distincts : l’atelier d’Issy-les-Moulineaux, nationalisé par le Front populaire en 1936 – qui n’avait donc plus aucun lien avec Renault – et les ateliers Fiat et Astra, situés au Pont-de-Sèvres, eux aussi réquisitionnés par l’armée allemande et sous le contrôle direct de la firme Daimler-Benz. Lorsque l’on voit une photographie des chars Renault utilisés par des troupes allemandes, non seulement cela ne signifie rien sur l’origine de leur réparation, qui pouvait être assurée par divers ateliers réquisitionnés appartenant à l’Etat avant-guerre (AMX, Rueil, Bourges, Roanne, Tarbes), mais cela en dit encore moins sur la fabrication de ces chars français que les Allemands eux-mêmes n’ont jamais effectuée à notre connaissance dans leur totalité. La dénomination exacte du service allemand qui dirigeait les ateliers du Pont-de-Sèvres est Instandsetzungs kommando, ce qui veut dire commando de réparation et non pas de fabrication. Les Allemands procédèrent toutefois à des modifications de matériel dans l’atelier AMX, notamment pour transformer des chenillettes Renault UE en canons automoteurs. En 1939, dix mois avant que l’Allemagne ne s’empare du matériel blindé français, la Wehrmacht avait déjà saisi les chars Renault R35 et FT-17 appartenant à l’armée polonaise. Les vieux chars Renault de la Grande Guerre (FT-17) furent utilisés pour l’essentiel à la garde des aéroports de la Luftwaffe.

Chars Renault FT-17 utilisés en Pologne par la Wehrmacht ; ces chars appartenaient probablement à l’armée polonaise avant septembre 1939 © Bundesarchiv
Les usines Renault ont passé au banc d’essai et réparé des moteurs de chars FT-17, B1 et R35 ; elles ont en outre fabriqué des pièces détachées pour matériel blindé (Panzers et semi-chenillés), à l’instar de Peugeot et de Citroën. Aucune fabrication ni montage de chars complet n’a été effectué par leurs soins. Le commissaire du gouvernement constate à la Libération que « toutes les commandes (de pièces et organes pour chars et chenillettes, ndla) n’ont été satisfaites qu’après de très longs retards ; bon nombre n’ont pu être exécutées et durent être annulées ».
Il était plus difficile de décliner ou de retarder les fabrications de véhicules industriels pour lesquelles l’usine était parfaitement outillée. Pourtant, le 6 juin 1941, alors que la Wehrmacht s’apprêtait à envahir l’Union soviétique, Louis Renault écrivait à Raoul Dautry : “Vous savez sans doute que nous faisons des camions dont les deux tiers sont réquisitionnés par l’armée d’occupation et un tiers destinés aux besoins civils ; nous travaillons à environ 40% de nos moyens, avec dix-huit mille ouvriers travaillant 35 heures“.
Lire la 5ème partie de la biographie de Louis Renault
Dernière mise à jour : 19 décembre 2012

Meeting du travail, Paris, Magic City, février 1942. Délégation de Renault-Citroën sous un portrait géant de Jacques Doriot entouré d’insignes du P.P.F. LAPI-6425 © LAPI / Roger-Viollet/Paris en Images

Résistants fusillés à Billancourt près des usines Renault. RV-364536 © Roger-Viollet/ Roger-Viollet/Paris en Images

Les moniteurs du camp de vacances Renault de Saint-Pierre-lès-Nemours. Paul-Henri Détrie est au centre. Légèrement sur la droite, les deux jeunes hommes de grande taille sont, au premier plan, Bernard Vernier-Palliez (avec la corne en bandoulière), futur P-DG des usines Renault et, un peu en retrait, Jean Myon (celui qui sourit), futur cadre dirigeant de l’entreprise © Paul-Henri Détrie

La colonie Renault de Saint-Pierre-lès-Nemours pendant l’Occupation allemande. Gaston Keledjian est au dernier rang,le troisième en partant de la gauche © Gaston Keledjian

Le camp de vacances Renault de Saint-Pierre-lès-Nemours – Gaston Keledjian est au 2è rang, le troisième en partant de la gauche © Gaston Keledjian

Saint-Pierre-lès-Nemours 1942 ou 1943- Gaston Keledjian est au premier rang, le second en partant de la droite © Gaston Keledjian

Saint-Pierre-lès-Nemours 1942 ou 1943- Gaston Keledjian est au premier rang, le second en partant de la droite © Gaston Keledjian

Saint-Pierre-lès-Nemours 1942 ou 1943- Gaston Keledjian est au premier rang, le premier en partant de la gauche © Gaston Keledjian