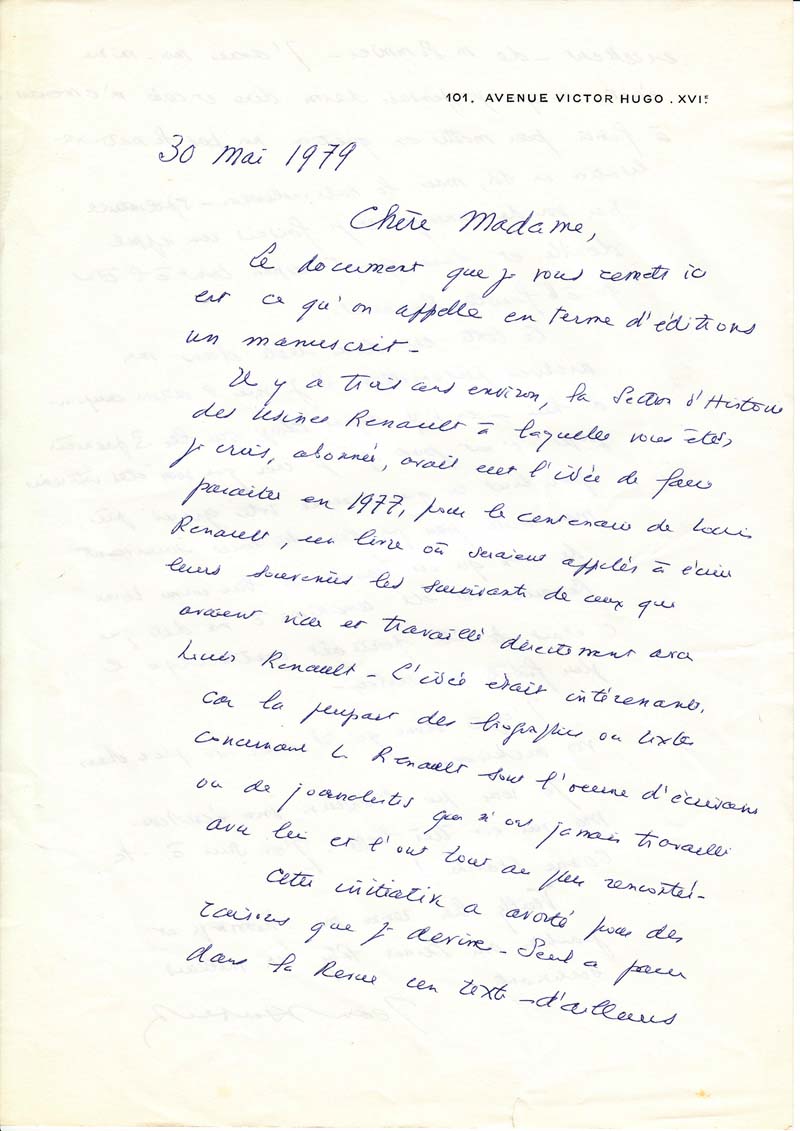

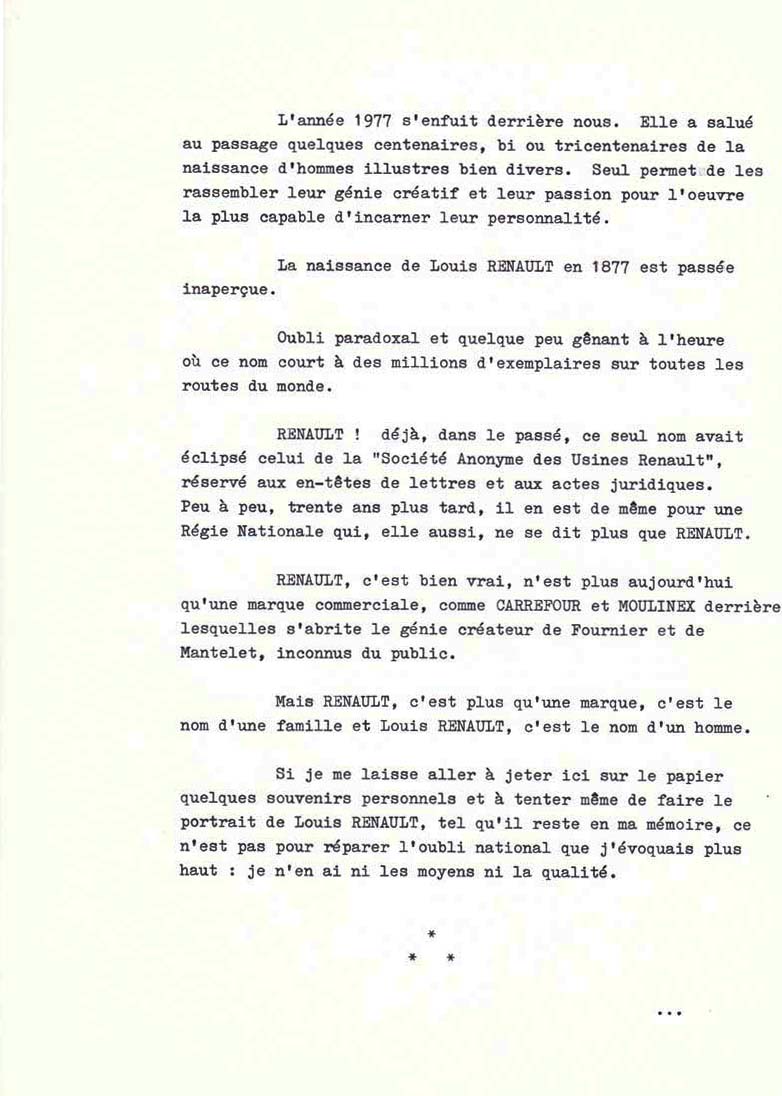
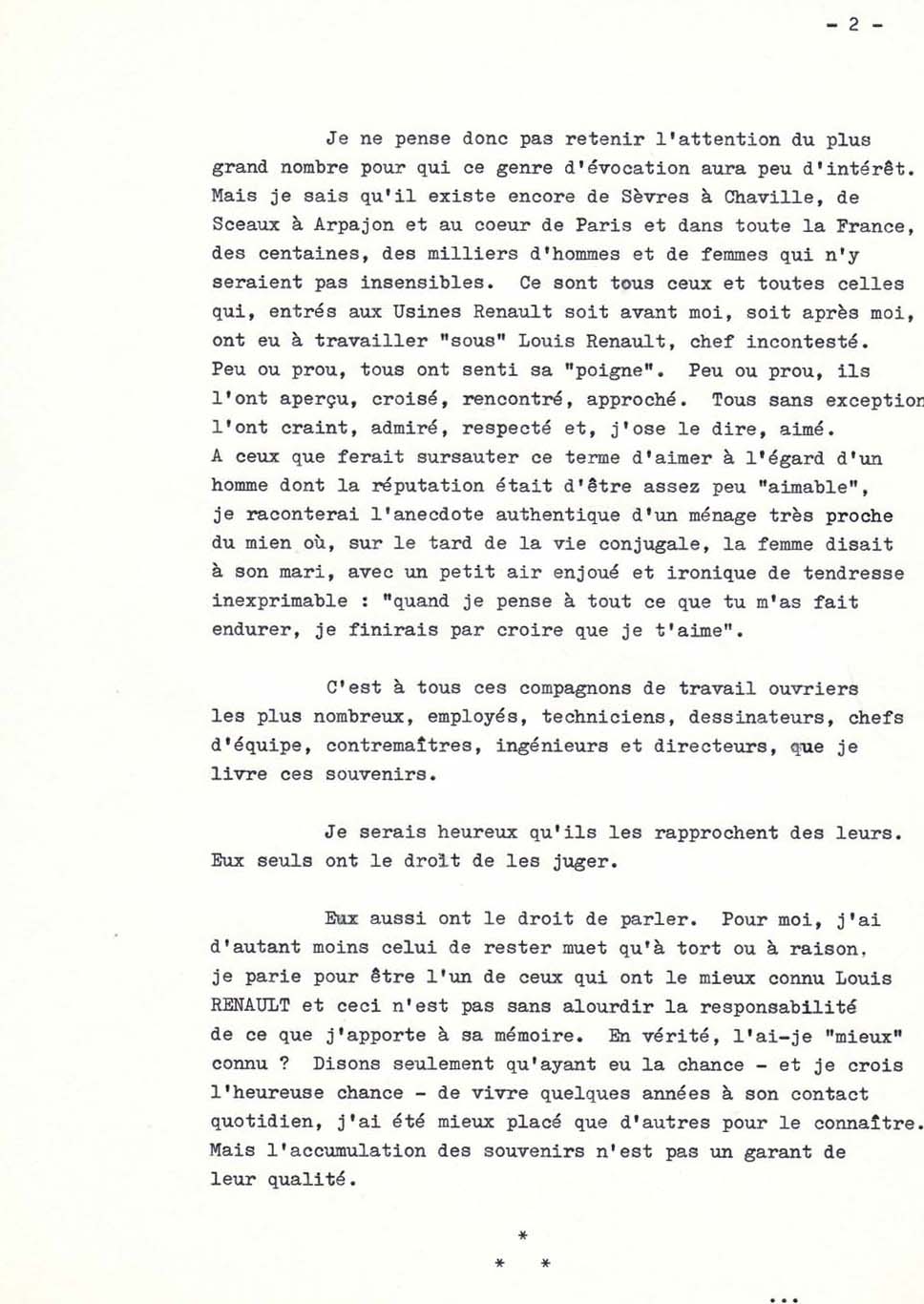 Jean Hubert à Annick Fabry, 30 mai 1979
Jean Hubert à Annick Fabry, 30 mai 1979
Témoignage de Jean Hubert (Seul le début n’a pas été publié par Gilbert Hatry)
Louis Renault, tel que je l’ai connu
Si forte qu’ait pu être la personnalité de Louis Renault, si marquante sur ceux qu’il rencontrait, plus de trente ans écoulés risquent bien de nuire à la netteté des souvenirs, d’en ternir les couleurs et faire naître la tentation de les enluminer par l’imagination romancière. Le temps est irréversible. N’est-il pas trop tard pour revenir sur le “vif”, surtout quand ce vif est Louis Renault ?
Mais ne pas répondre au nom d’une prétendue honnêteté, n’est-ce pas refuser un concours à l’Histoire, l’Histoire des hommes, jamais achevée, jamais impartiale, appelant à son carrefour des témoignages, dont la divergence la passionne, l’Histoire toujours exigeante, toujours curieuse, toujours avide de combler ses lacunes, l’Histoire que jamais ne fatigue la poursuite d’une inaccessible Vérité ?
Ceux qui ont connu Louis Renault sont chaque jour moins nombreux. Dois-je m’écarter d’eux qui rassemblent aujourd’hui leurs souvenirs et garder les miens au fond de ma mémoire ? De ces survivants, j’ai connu bon nombre ; ce furent de solides compagnons de travail.
J’ai d’autant moins le droit de rester muet qu’à tort ou à raison, je passe pour être l’un de ceux qui ont le mieux connu Louis Renault et ceci n’est pas non plus sans alourdir la responsabilité de mon apport. En vérité, l’ai-je “mieux” connu ? Disons seulement qu’ayant eu la chance – et je crois l’heureuse chance – de vivre quelques années à son contact quotidien, j’ai été mieux placé que d’autres pour le connaître. Mais l’accumulation de souvenirs n’est pas un gage de qualité.
J’ai donc ouvert ma boîte aux souvenirs. Elle était pauvre de ces “faits divers”, mais “vécus” dont l’Histoire est friande. Certains en seront surpris ; je ne le suis pas car je connais ma mémoire et je la sais allergique à enregistrer tout ce qui est anecdote. Oublieuse ? non, mais filtrante. Bien mauvaise disposition congénitale pour évoquer un personnage comme Louis Renault, car ses comportements, faits et gestes, étaient une source inépuisable d’anecdotes, dont l’ensemble finit par dresser effectivement un portrait.
Mais au fond de cette boîte aux trois quarts vide de “bonnes histoires”, je savais que j’allais trouver, sortant peu à peu de l’ombre, quelque chose qui allait se dégager lentement, se préciser et qui, ma foi, ressemble à un portrait. En le voyant réapparaître, j’ai bien ce sentiment d’unité que donne un portrait, quand le peintre disparaît derrière le sujet. Mais je m’interroge. Dans quelle mesure, comment et où suis-je intervenu dans cette reconstitution ? Est-ce là “le vrai” Louis Renault ? Je ne puis l’affirmer.
En tout cas, c’est bien Louis Renault “tel que je l’ai connu”.
— I —
Pauvreté du détail et richesse du portrait s’expliquent aisément par ce que le langage administratif appelle un “curriculum vitae“. Il s’agit ici du mien et plus précisé¬ment des quinze années – 1929-1944 – que j’ai vécues à Billancourt “sous” Louis Renault. Carrière bien imprévue pour un ingénieur de trente ans, débarquant aux usines Renault en 1929. L’époque n’était pas à la evendication d’un “plan de carrière” ; elle eût suffi à assurer un demi-tour à droite instantané à l’audacieux impétrant. Au surplus, quelle madame Soleil aurait pu me prédire que 7 années passeraient sans que j’aie à rencontrer Louis Renault, et 7 autres années à le voir tous les jours ? Eussé-je consulté cette voyante extralucide, qu’ayant entendu de-ci, de-là parler de Louis Renault, j’aurais de moi-même effectué le demi-tour.
Première rencontre
Elle remonte à 1929. Je travaillais au service d’une belle administration d’État, les P.T.T., belle, mais lente, bonne technicienne du téléphone, mais déjà incapable de suivre la demande du public, ni en quantité, ni en qualité. Heureux et tranquilles, bien abrités des coups du sort par un bon statut, les gens des P.T.T., du facteur à l’ingénieur et au directeur, étaient bien attachés à leur grande maison.
Un matin du printemps, je fus appelé par un ami qui travaillait au bureau d’études de Renault ; il m’informait qu’un administrateur-délégué de la société cherchait un ingénieur, doté bien entendu des meilleures qualités possible, mais en outre, et de préférence, un ancien élève de l’École polytechnique. A défaut d’autres, je remplissais cette condition, le reste étant à prouver. J’étais donc requérable et, par curiosité plus que par attraction, j’allais avec d’autres vers le demandeur, M. Samuel Guillelmon. Ceux qui se souviennent de lui n’ont pas oublié l’accueil réfrigérant de cet homme, en réalité très sensible, mais qui s’enfermait dans une rigueur d’attitude assez fréquente chez les protestants. Nos entretiens avortèrent. Je n’avais que peu d’enthousiasme à l’idée d’abandonner une profession agréable, mais stable, si mal payée fût-elle, pour me parachuter dans l’industrie dont je ne connaissais pas le premier mot et, de surcroît, chez Renault dont je n’entendais pas que des éloges, qu’il s’agisse du constructeur ou de ses voitures. Quand on est jeune, on ne maîtrise pas très bien son langage et je m’étais laissé aller à répondre à mon interlocuteur que, quitte à entrer dans l’industrie automobile, j’aimerais mieux partir vers Javel que vers Billancourt. C’était l’époque où Citroën illuminait chaque soir le ciel de Paris et proclamait sa vocation de constructeur de grande série. Je fus durement contré. “Vous êtes bien mal informé” me coupa net Samuel Guillelmon. “Sachez qu’en entrant chez Renault, vous entrez dans une maison solide et que, si l’un des deux constructeurs doit un jour tomber, ce sera Citroën”. Cinq ans plus tard c’était chose faite. On en resta là et je ne pensais plus à rien lorsque, trois mois passés, je reçus, fin juillet, un appel m’invitant à revenir. “Alors ? ” dit mon interlocuteur.
“Alors ?” répondis-je. Très vite, on conclut. Je contresignais une lettre où les usines Renault m’engageaient à leur donner “toute mon activité” en échange de telle rémunération. C’était simple : ni fioriture, ni bavure.
Nouvelle surprise deux jours plus tard. “Venez, je veux vous présenter à M. Renault”. Je dirai plus loin le vraisemblable motif de cette présentation. Sur le moment, elle me parut aussi flatteuse qu’insolite car je mesurais son inexplicable disproportion avec le peu – pour ne pas dire le rien – de ce que M. Guillemon m’avait dit attendre de moi. Et voilà comment le dernier jour de juillet 1929, je fus introduit dans le bureau de Louis Renault.
Assis derrière un grand bureau rectangulaire, le dos à la fenêtre, un peu à contre-jour, Louis Renault téléphone. Il fait un signe de la main vers les sièges. M. Guillelmon s’assied au bout de la table et m’indique une chaise sur le grand côté, face à Louis Renault. L’entretien téléphonique me donne le temps de saisir l’essentiel de ce visage coloré et buriné de rides ; la voix est sourde ; l’homme n’est manifestement pas content. Je crois comprendre qu’un alternateur est en panne… mais pourquoi ?… 3 000 ampères ?… appelez un tel… et un grognement achève la communication. Au moment où je suis pris dans le collimateur de deux yeux perçants, j’entends une voix blanche qui s’élève sur ma gauche, c’est S. Guillelmon : “Je vous présente M. Hubert, dont je vous ai parlé et qui doit venir travailler avec moi “. Les yeux ne bougent pas. Un petit silence et Louis Renault enchaîne : “Oui, Guillelmon m’a dit… oui… vous êtes po… vous êtes poly… poly… vous êtes polytech… ” Silence.
Un mouvement des lèvres, qui me paraît bien ressembler à une moue. La main prend le menton, l’index monte le long du nez, légère élévation des épaules et soupir à la retombée : “Y-en-a qui sont bien… ” Silence. Nouvelle petite moue, moins accusée. “Dautry, bien ! Dautry, gentil garçon… travailleur “. Silence. Nouvelle moue, plus marquée. “Detoeuf, très intelligent, Detoeuf… mais pas un industriel… Detoeuf, un poète !… “. Silence. Très légère rotation des épaules que suit en souplesse le veston bleu marine. Guillelmon a compris et me fait signe. Je me lève. Louis Renault : “Quand venez-vous ?” J’ouvre la bouche: “1er octobre “. ” Bon ! “. Une poignée de main. Je laisse les deux hommes en tête-à-tête et je sors assez perplexe. Une chose est certaine : Louis Renault n’est pas un orateur. Sa pensée galoperait-elle devant sa voix ? Bégaiement ou aphasie, je n’ai jamais su. Autre certitude : il n’a aucune attirance particulière pour les polytechniciens. J’ai assez vite compris pourquoi. Que signifiait cette entrevue ? Il a fallu des années pour que je le sache.
Louis Renault et les polytechniciens
Ils étaient séparés par ce qu’on appelle communément la “tournure d’esprit”. Il était naturel qu’un tempérament de constructeur comme celui de Louis Renault s’accommodât au mieux avec les hommes “du tas”. C’est avec de bons professionnels de la mécanique qu’il avait usiné et monté ses premières voitures. C’est d’eux qu’étaient peu à peu sortis la maîtrise, puis les cadres des usines. Quand il lui fallut recruter, on conçoit que sa préférence l’ait dirigé vers des ingénieurs praticiens tels que ceux qu’il trouvait dans des écoles comme celle des Arts et Métiers, qui s’amalgamaient sans peine aux hommes sortis du tas. Les ingénieurs de formation plus abstraite comme les centraux et surtout les polytechniciens pénétraient plus difficilement dans un milieu si compact qu’il était susceptible de les rejeter comme “corps étrangers”.
Quarante ans plus tard, les choses ont bien changé, car les exigences du “management” ont justifié l’appel à des hommes de formation scientifique élevée et, de son côté, une école comme l’École polytechnique a su infléchir ses programmes en vue de rendre moins rude l’entrée de ses élèves dans l’industrie. Mais, en 1929, pourquoi un homme aussi proche et aussi respectueux de son chef que l’était M. Guillelmon avait-il pu rechercher un polytechnicien ? La seule explication qu’on ait pu me donner de cet apparent défi est que ce cher homme avait un gendre polytechnicien qu’il tenait en grande estime. Admettons cette familiale motivation, mais cela n’explique pas l’entrevue insolite qui m’avait été ménagée avec Louis Renault. Sur ce point, je mettrais ma main au feu que les choses se sont passées comme suit.
Au printemps de 1929, Louis Renault vient de franchir la cinquantaine. Il est encore en pleine force et son activité semble sans limites. Elle est aiguillonnée par l’émulation sur lui-même, le besoin de se dépasser et aussi par le goût de la compétition qui ne l’a pas quitté depuis ses premières courses. La France compte encore plusieurs dizaines de constructeurs automobiles, chevronnés par vingt et trente ans d’expérience, mais le peloton de tête se voit “tiré” par le dernier venu, André Citroën. Il y a à peine dix ans que celui-ci s’est lancé dans la construction automobile. Il a des idées neuves. Mieux que tous ses concurrents, il sait vendre. Son ascension inquiète Louis Renault qui part aux États-Unis pour une nouvelle tournée de visites d’usines et rentre en 1928 avec un grand programme d’extension et de modernisation. La réalisation suit immédiatement, bâtiments et équipements nouveaux se multiplient, les ateliers de l’île Seguin en sont le couronnement.
Pour tenir ce rythme, Louis Renault mène une vie très dure, à lui-même d’abord qu’il n’a jamais ménagé, et à ses collaborateurs en commençant par les plus proches. Deux hommes apparaissent immédiatement derrière lui, au sommet de la hiérarchie, les deux administrateurs-délégués, Paul Hugé et Samuel Guillelmon. Celui-ci couvre la fabrication et celui-là vend et tient la caisse. Paul Hugé, contemporain, ami et associé de la première heure (1899) a plus de liberté avec Louis Renault que Samuel Guillelmon, plus âgé que Louis Renault, mais moins “ancien” à Billancourt. Ce ne sont d’ailleurs là que des nuances, car pour les deux administrateurs, Louis Renault n’est pas le président, il est le patron. Constructeur avant tout, Louis Renault se passionne pour la fabrication des voitures. La vente ne l’intéresse que dans la mesure où il faut bien les vendre. Il reste donc très vigilant sur l’écoulement de sa production, mais il ne fait que des incursions dans le domaine commercial ; ses interventions parfois brutales y jettent le désarroi, mais elles réveillent. La fabrication reste donc l’objet dominant de ses préoccupations. A travers mille obstacles, écueils et barrages divers, elle descend comme un grand fleuve. Louis Renault est à la source, seul. Là, au bureau d’études, pas d’administrateurs. C’est le domaine réservé, le jardin préféré. Il y rassemble les meilleurs jardiniers et quand les fleurs ne poussent pas aussi belles qu’il le voudrait, il a tendance à s’en prendre à eux. De la conception aux moyens de réalisation, du moteur et des châssis aux bâtiments qui abriteront les équipements, des rues à percer aux ponts sur la Seine, des centrales de puissance à renforcer, des machines enfin, des machines surtout dont aucune ne sera achetée ou fabriquée à Billancourt sans son accord formel et, de là, aux méthodes de fabrication les plus capables, à ses yeux, d’assurer la qualité et le meilleur coût, Louis Renault traite tout, voit tout, contrôle tout. A tout le moins le veut-il et dire qu’il le veut, c’est tout dire. Ainsi éprouve-t-il le besoin, à toute heure, revenant des ateliers où il va généralement seul ou en toute petite compagnie, d’appeler Alfred ou Émile qu’il dénomme “le grand” ou “le barbu” (à l’huissier de comprendre) ; ce sont les responsables qu’ils ne veut pas “court-circuiter” et devant qui il va réagir. Au sommet de la pyramide, Samuel Guillelmon n’échappe à aucune de ces réunions ; au sortir de l’une d’elles, il est à peine revenu à son bureau qu’il est rappelé par une autre et après toutes ces séances, les décisions prises, le voilà chargé de rassembler, d’achever les arbitrages, de “suivre” l’exécution, panser quelques blessures, dans la foulée des notes plus ou moins achevées que Louis Renault fait prendre à la volée par sa secrétaire, Mlle Maille. Ces notes, c’est du brut, pas toujours limpide, il faut les décanter avant emploi.
De cette façon de travailler de Louis Renault, je ne savais naturellement rien en débarquant à Billancourt et cette ignorance fut longue à se dissiper, car j’étais bien loin des rares personnes appelées à travailler directement avec Louis Renault. Mais il y avait la rumeur que créaient leurs propos, leurs conférences ou leurs propres éclats. Le seul qui aurait pu m’informer, mon chef direct, M. Guillelmon était trop discret pour le faire. L’eût-il voulu qu’il ne l’eût pu, car je ne le voyais pratiquement jamais. A mon arrivée, le 1er octobre 1929, il m’avait dit : “Allez, tout vous est ouvert, usines, ateliers, bureaux. Ma secrétaire vous introduira. Voyez, écoutez, vous apprendrez”. En bon français : “Je n’ai pas le temps de m’occuper de vous ; débrouillez-vous !”. Quelles méthodes ! et pourtant c’en était une, celle qui consiste à jeter les bébés dans une piscine. Ils se noient parfois, mais il arrive qu’ils nagent.
Quant à cette étrange entrevue de fin juillet, Guillelmon m’avait dit dès mon entrée : “Je vous ai présenté à M. Renault. Cela fait, vous êtes libre de chercher à le rencontrer. Je ne m’y opposerai pas mais je ne le vous conseille pas. C’est un comportement risqué pour ceux qui ne sont pas solidement en place, qui ne connaissent pas bien la maison, ni surtout ses hommes”.
J’eus d’autant moins de peine à suivre ce conseil que ce comportement de prudence était absolument général. Je fis donc “comme tout le monde” car tout le monde ou à peu près connaissait la silhouette de Louis Renault, jusqu’au fond des usines.
Tout le monde ? Pas tout à fait. La légende anecdotique raconte que Louis Renault, s’étant un jour arrêté devant une machine qui tournait mal, avait un peu secoué l’ouvrier et, l’ayant écarté, avait pris la machine en main pour redresser le travail. Il s’éloignait quand l’ouvrier demanda quel était ce chef inconnu. “Louis Renault” dit le voisin. La légende rapporte que l’ouvrier prit ses jambes à son cou et court encore. Pour éviter ce sort funeste, moi qui avais eu la chance de voir Louis Renault durant quelques minutes, j’étais donc très apte, dès qu’il apparaissait à l’horizon, à me rendre aussi transparent que possible et chacun d’en faire autant. Dès lors, n’est-il pas étonnant qu’en sept ans je ne le rencontrai pas sept fois. Depuis ma présentation, Louis Renault avait naturellement tôt fait de m’oublier. Je m’en aperçus à deux reprises dans les années suivantes. Une première fois en m’étant probablement occupé de ce qui ne me regardait pas – mais personne ne m’avait dit ce qui me regardait – j’avais un peu dérangé l’ordre des choses dans le domaine d’un féodal et celui-ci, voulant écarter quelques reproches sur sa gestion, avait jeté mon nom à la table patronale, autour de laquelle je n’étais naturellement pas, mais où je pouvais parfaitement jouer les boucs émissaires. Louis Renault n’avait pas paru réagir à mon nom et Samuel Guillelmon me rapportant l’incident beaucoup plus tard avait délicatement écarté la pelure d’orange où j’allais glisser innocemment. L’autre fois, c’était dans le bureau même de M. Guillelmon qui recevait deux dirigeants de Châtillon-Commentry. Louis Renault entre à l’improviste, s’assied dans le fauteuil que lui cède Guillelmon et se lance dans une longue et très technique diatribe sur la qualité de ces nouvelles tôles “Armco” qui étaient atteintes d’une terrible maladie, la “vermiculure”. J’étais là avec un bloc et un crayon, mais sans prendre aucune note, ce qui n’empêcha pas Louis Renault de jeter vers moi un regard aussi noir que peu aimable. Samuel Guillelmon m’expliqua, quand nous fûmes seuls : “M. Renault n’aime pas qu’on prenne des notes quand il parle. Il vous a pris pour un des fournisseurs”.
La présentation de 1929 était donc bien loin. Mais alors, pourquoi ? Voici l’explication la plus plausible. Son seul intérêt est de faire revivre Louis Renault au travail. Pour bien tenir le “suivi” de tous les sujets qu’il abordait, grands ou petits, professionnels ou privés, Louis Renault faisait tenir par sa secrétaire, pour chacun de ses cinq, six ou sept collaborateurs directs, un carnet à feuilles quadrillées et détachables, dit “Carnet Walker”. M. Guillelmon avait donc le sien, établi, comme tous les autres, en deux exemplaires, l’un que gardait Mlle Maille et l’autre Mlle Flageolet, secrétaire de M. Guillelmon. C’était une époque où les secrétaires étaient, avant toute autre qualité, “secrètes” et ces carnets étaient jalousement gardés par ces demoiselles, à l’abri des regards curieux. Il me fallut un coup de chance pour en apercevoir les colonnes date d’entrée, question à traiter, date de sortie. Quand la question était traitée, la ligne était fortement barrée. Sinon, c’était le “suspens”. Toutes les semaines, les secrétariats échangeaient les deux carnets. Mlle Maille avait, au jour le jour, ajouté les questions nouvelles. Très simple méthode de travail, comme les aimait Louis Renault. Allant et venant, en éventail, autour de lui, ces carnets faisaient, pour lui-même et leurs titulaires, un véritable et très utile travail de “ratissage”. Rien n’était oublié. Mais aussi bien – je ne devais le savoir que plus tard – quand Louis Renault considérait qu’une question était traitée et qu’il en avait lui-même acquis la certitude – il l’évacuait de son horizon.
Je parierais donc gros que depuis des mois, au prin-temps de 1929, une case du carnet de Samuel Guillelmon portait la mention : “Embaucher collaborateurs”. Car, malgré sa puissance de travail, Samuel Guillelmon, assisté d’une secrétaire-sténodactylographe et d’un secrétaire à tout faire, était incapable de suivre toutes les questions qui pleuvaient sur lui et Louis Renault ne cessait de lui répéter : “Faites-vous donc aider, Guillelmon”. Mais cela même, Guillelmon en avait à peine le temps. Au printemps, le carnet Walker ayant transformé le conseil en injonction, Guillelmon avait amorcé sa recherche, mais sans conclure. Et depuis des semaines, la petite question, noyée et dépassée par beaucoup d’autres plus fraîches, moisissait dans le carnet Walker quand, tout à coup, arriva le mois de juillet, annonçant le mois d’août qui ouvrait les vacances montagnardes de Samuel Guillelmon. Fin juillet Mlle Maille ratisse le Walker. “Collaborateur de M. Guillelmon, pas embauché ?” Guillelmon se hâte. Il faut que tout soit réglé dans les jours qui viennent ; à ma surprise, je suis rappelé et tout s’arrange.
Mais ce n’est pas tout. J’ai dit et j’ai appris plus tard que Louis Renault avait à coeur de contrôler lui-même – de visu – l’exécution de ses ordres. Cela, Guillelmon le savait bien avant moi. Question réglée, annonce le Walker. “Alors, ça y est, dit Louis Renault, vous l’avez, votre homme ?” et Guillelmon, connaissant son vis-à-vis, de répondre : “Quand voulez-vous le voir ?”. C’est ainsi que Louis Renault put voir, en chair et en os, celui qui allait permettre à Samuel Guillelmon de partir en vacances avec la satisfaction du devoir accompli. Pour Louis Renault, la question était évacuée de son esprit et moi avec.
Flagrante injustice
Ce ne fut pas une rencontre avec Louis Renault, mais ce que je vais raconter m’avait aussi fortement frappé que l’onde de choc déclenchée par la chute toute proche d’une bombe.
J’étais “en place” depuis un an environ. En place, mais mal placé et même pas placé du tout. Sans directive précise, tâtant de-ci, de-là, je m’orientais vers les services d’approvisionnements. C’était une magnifique plate-forme d’observation : bien connaître les matières premières et les produits qui s’incorporent dans la voiture automobile, avoir quelque lumière, au moins une nomenclature sur les outillages et les machines, répertorier les fournisseurs, jauger les prix, suivre les produits vers les magasins qui les stockent et les ateliers où ils vont être transformés et montés, et faire tout cela en toute liberté, c’est une école sans pareille.
J’avais ainsi fait la connaissance de la plupart des employés des services d’achat et, parmi eux, d’un brave
homme nommé Goujet. Il était “l’homme des pneumatiques”. Pour un produit d’importance capitale, toutes les décisions, tant de technique que de prix, étaient prises à ce qu’on appelle aujourd’hui le plus haut niveau et donc à Billancourt par Louis Renault. Tout cela passait très au-dessus de la tête de Goujet. Son rôle consistait à recevoir les programmes de fabrication, à préparer et chiffrer les bons de commandes aux fournisseurs. Mais sa responsabilité personnelle se trouvait bien engagée sur un point clé, car c’est lui qui, tous les jours, notifiait aux fournisseurs les cadences de livraison pour le lendemain. Les stocks de pneumatiques, encombrants et coûteux, étaient très surveillés. Chaque soir donc, après rassemblement de tous les éléments immédiats : production réalisée, retard à combler, montages du lendemain, des employés des ateliers du montage téléphonaient à Goujet les besoins du lendemain ; Goujet, toujours par téléphone, répartissait tout cela sur chaque fournisseur, chez qui d’autres employés attendaient l’appel de Goujet pour ordonner les livraisons du dépôt parisien. Toutes ces transmissions s’écoulaient vers 19 heures 30 et n’étaient pas terminées avant 20 heures. Tout le personnel des bureaux était parti.
Mais Louis Renault n’était pas parti et c’est l’heure où il circulait du bureau d’études au bureau central de fabrication, arrachant les chefs planificateurs à leurs obsédants programmes pour les entraîner vers les ateliers, leur montrer autre chose que du papier quadrillé, leur faire toucher quelques défaillances ou quelques réussites qu’il se flattait d’avoir découvertes quelques heures plus tôt.
Ainsi advint-il qu’un soir, accompagné de Samuel Guillelmon, Louis Renault passa à cinq ou six mètres de Goujet. Celui-ci était un bel homme d’une cinquantaine d’années, avec une bonne tête rose, dominée d’un crâne bien rond et bien chauve ; il était vêtu d’une longue blouse blanche. Assis à sa table, un cornet téléphonique à la main, l’écouteur collé à l’oreille et l’autre main complétant la conque microphonique, les yeux rivés aux feuillets alignés sur sa table, Goujet opérait : les usines Renault donnaient leurs ordres à Michelin, Dunlop et autres seigneurs de moindre rang.
Le service d’approvisionnement au milieu duquel se détachait ainsi l’infortuné Goujet était loin, à l’époque, d’être un modèle d’ordre. Son directeur donnait le ton en ayant à gauche et à droite de sa table deux piles de lettres et papiers divers dont la hauteur dépassait 25 cm. C’était un délice, quand il était obligé de retrouver un de ces documents, de voir ses doigts grimper au long de la pile et s’arrêter miraculeusement au bon niveau – il avait le génie de la stratification. Qu’on ne s’étonne donc pas si le spectacle offert par son service, au soir d’une longue journée de travail, n’était pas édifiant. Peut-être le capharnaüm avait-il, ce soir-là, été particulièrement réussi. Toujours est-il que Louis Renault se bloqua devant ces tables aux papiers en désordre, aux tiroirs trop pleins pour avaler leur contenu et surtout devant ces corbeilles de papiers qui dégorgeaient sous l’afflux de brouillons et de ce long papier carbone dont des machines spéciales capables de multiplier les copies de commandes faisaient une consommation dévorante.
Pour Louis Renault qui avait le gaspillage en horreur, un tel spectacle était intolérable. Passant du rose au pourpre, il se tourne vers le seul Goujet qui était à l’horizon, l’apostrophe de la voix et du geste. Guillelmon double l’appel, mais la température va monter trop vite pour lui permettre d’intervenir. Car Goujet qui a reconnu le patron, s’est levé, mais il est en prise avec une communication peu audible, il articule des chiffres : 7, 4 et 3, etc. Oui, il vient, mais il ne peut lâcher son cornet… N’est-ce pas le devoir professionnel ? Fatale hésitation ! Louis Renault, devenu violet, montre du doigt les corbeilles de papier carbone, tristes serpentins abandonnés, et Goujet s’interrompt pour s’excuser, regardant lui aussi les corbeilles : “Ce n’est pas moi, M. Renault, cela ne me regarde pas”, et c’était vrai, Goujet n’était pour rien dans ce débordement de cauchemar. Que comprit Louis Renault ? “Ah ! cela ne le regarde pas… eh bien moi, ça me regarde ! Guillelmon, je n’ai plus besoin de ce garçon “. La carrière de Goujet aux usines Renault était terminée.
Quand Goujet vint me raconter la chose, le lendemain matin, je n’y pus croire, mais ce n’était que trop vrai. Tous les camarades de Goujet confirmaient le renvoi. Tout cela me dépassait, l’innocence et la maladresse de Goujet, l’absence d’intervention de Samuel Guillelmon pour remettre les choses en place et la sévérité de la sanction. Je ne pus me retenir d’aller trouver M. Guillelmon et lui faire part de mon trouble devant cette flagrante injustice.
Sa réponse me donna à comprendre qu’il était intervenu sans succès, mais je l’entends encore me dire : “Il faut que vous sachiez que lorsque M. Renault a pris une décision, celle-ci est irrévocable”. Goujet partit donc et fut recasé par S. Guillelmon. Mais cet irréparable dommage moral était bel et bien fait sur un homme totalement dévoué à son entreprise.
L’autorité
Dans sa brutalité, cette histoire menait à une et même deux leçons. Dans l’immédiat, elle renforçait mes comportements de prudence à l’égard d’un chef aussi volcanique. Bien plus tard, une fréquentation quotidienne m’a montré qu’effectivement Louis Renault ne revenait jamais quand sa décision était prise. Mais j’ai appris aussi qu’à part certains éclats comme celui que je rapporte où la colère, l’orgueil ou l’incompréhension déclenchaient un réflexe parfois bien maladroit ou bien mauvais, Louis Renault mûrissait ses décisions. Il tâtait le terrain, en parlait à l’un ou à l’autre, pas toujours de la même façon, il affinait son projet et réglait son cap. Dans cette période préparatoire et à condition de ne pas trop attendre, l’expérience devait m’apprendre qu’on pouvait aborder Louis Renault en tête-à-tête, sinon il aurait cru à un coup monté, à une coalition ! Alors Louis Renault écoutait. Mais la décision prise, il n’était plus question d’y revenir. Samuel Guillelmon ne m’avait pas trompé.
Sur le tard de la vie, je puis bien dire qu’après avoir vu tant de responsables se montrer incapables de maintenir leur décision devant les critiques qu’elle provoque et les amender pour tenter de détourner ces assauts, après avoir vu ces responsables ruiner leur autorité dans de tels comportements, j’apprécie la fermeté des décideurs.
Le roi juste, saint Louis, ne prenait jamais une décision à chaud ; il disait : “Je verrai” et sa justice n’était rendue qu’après réflexion.
Louis de Billancourt n’était pas saint Louis. Il devait lui-même subir l’injustice des hommes.
Années de crise
Ouverte aux États-Unis le 1er octobre 1929 – date du krach de la bourse de New York… et de mon entrée chez Renault – la grande dépression économique n’atteignit la France qu’un an plus tard. Encore notre pays confiant dans une indépendance économique assise sur sa forte structure agricole espérait-il n’être pas touché aussi profondément que l’Angleterre et l’Allemagne plus industrialisées. Il n’en fut rien ; nous plongeâmes, nous aussi, dans le marasme.
En quelques années, on vit disparaître de très vieilles marques d’automobiles, chargées d’un glorieux passé. Citroën, menacé par une trésorerie aux abois, se lançait dans la fuite en avant ; il empruntait, il construisait de nouveaux ateliers, il espérait devancer la tempête. Louis Renault descendait de la voile, serrait les écrous et parait aux voies d’eau. Réduction des programmes de fabrication ajustés à la demande fléchissante de la clientèle, réduction des prix de vente, réduction des effectifs, licenciements sans indemnité de chômage qui portaient en eux le choc en retour de 1936, pression accrue sur les fournisseurs : c’était bien la tempête.
Plutôt comique au milieu de ces heures difficiles, la petite histoire suivante évoque l’un des plus vigoureux coups de boutoir de Louis Renault et d’ailleurs l’un des plus salutaires.
La crise asséchait les trésoreries. A Billancourt, Paul Hugé, administrateur chargé des finances de la maison, se désespérait en voyant apparaître le fond de ses tiroirs et ne cessait d’alerter Louis Renault sur l’approche des dangers. Tournant et retournant, Louis Renault s’aperçut que, contrairement à ce qu’il souhaitait, ses usines étaient remplies de stocks de matières premières et de produits de toutes sortes. Sur des ordres anciens ou mal contrôlés, les fournisseurs livraient plus qu’il n’était nécessaire. Pour des cadences réduites, les stocks représentaient un écoulement d’autant prolongé. Plus grave encore, Louis Renault remarquait qu’ici et là des surplus s’étaient accumulés, destinés à des modèles retirés de la vente. Queues de programmes, erreurs diverses, fournisseurs en litige, tout cela avait été peu à peu repoussé par le flot montant des approvisionnements et était venu s’enfouir – plus ou moins sciemment – loin des regards du passant. Et c’est précisément en “fouinant” que Louis Renault faisait ces découvertes. Dès le jour de ces trouvailles et sans quitter son terrain de chasse, il fait appeler son ami Paul Hugé, qui ne mettait jamais les pieds dans les ateliers, vers un magasin un peu à l’écart où une soupente était bourrée d’appareillages divers, câbles électriques, tableaux de bord, etc. Pour y accéder, il fallait commencer par un escalier étroit et finir par une échelle. Escalade peu engageante pour un petit bedon cinquantenaire et des jambes peu entraînées à l’escalade. Paul était au bas de l’échelle, levant la tête vers Louis qui, du plancher supérieur, se penchait vers lui, tout goguenard. “Allons, Paul, monte, monte vite ; ta galette ! elle est là, ta galette !”. La ronde dura jusqu’au soir.
Le lendemain matin, une giclée de notes de Louis Renault s’abattait sur la table des quelques responsables de leur exécution. Mais, là encore, la rumeur allait plus vite que les notes. Toute l’usine, à partir du témoignage d’un chef d’atelier, connaissait la scène du magasin. Elle faisait rire, mais elle percutait. Chacun savait maintenant que la caisse était vide et que l’heure était venue d’être vigilant. Mieux que par les notes patronales, si impératives fussent-elles, la mobilisation des esprits se faisait par cette sorte de bande dessinée qui se colportait dans la bonne humeur : le petit Paul soufflant et grimpant à l’échelle avec, au-dessus de lui, le visage écarlate de Louis Renault.
Ainsi dramatisé, ce branle-bas fut salutaire. En quelques mois, les stocks s’infléchirent et, en deux ans, leur niveau baissa de plus de moitié. La trésorerie passait le cap et les usines conservaient leur indépendance.
Présence du chef
Ainsi les allées et venues de Louis Renault dans les ateliers et les bureaux – comme d’ailleurs dans le réseau commercial – laissaient-elles toujours dans leur sillage des trains d’ondes diffusantes.
Passages imprévus, parfois rares, mais toujours possibles, passages renouvelés deux et trois jours de suite au même point, quand le premier arrêt n’avait pas réglé la difficulté – ou pour un contrôle rapide. A ceux qui auraient peine à concevoir qu’un seul homme pût maintenir en état de tension un ensemble humain aussi important, je peux apporter la preuve par le contraire.
En fait, Louis Renault n’était pas toujours à Billancourt. Il avait, quand je l’ai connu, renoncé aux lointaines vacances de sa jeunesse, avant la guerre de 1914 ; mais il s’absentait encore régulièrement, soit pour pratiquer le ski en hiver, soit pour partir en mer durant l’été. Ces absences étaient tenues, par son entourage immédiat, aussi secrètes que possible. Le mythe de la présence invisible était soigneusement entretenu. J’étais moi-même trop loin des sommets pour être informé de ces départs, mais assez près pour en observer assez vite les effets. Il suffisait de voir mon propre chef Samuel Guillelmon organiser son travail, tenir des réunions, visiter des ateliers et même me donner quelques minutes d’audience. Je ne pouvais pas ne pas remarquer son comportement plus décontracté qu’à l’ordinaire. Et voici que, jour par jour, de proche en proche, le climat changeait, venant confirmer à l’observateur attentif que quelque chose se passait. Les directeurs et chefs de service qui venaient alors au bureau de l’administrateur-délégué et que je commençais à connaître, me semblaient moins tendus. De toute évidence, on “soufflait”.
Beaucoup plus facile que l’épreuve des départs, la contre-épreuve du retour était un jeu d’enfant. A l’aller, il me fallait environ deux jours pour percer le mystère ; mais dans l’heure, je connaissais le retour et je m’amusais à dire à la toujours secrète Mlle Flageolet : “Je crois que M. Renault est revenu”. Elle rougissait en souriant.
Lire la suite du témoignage de Jean Hubert
